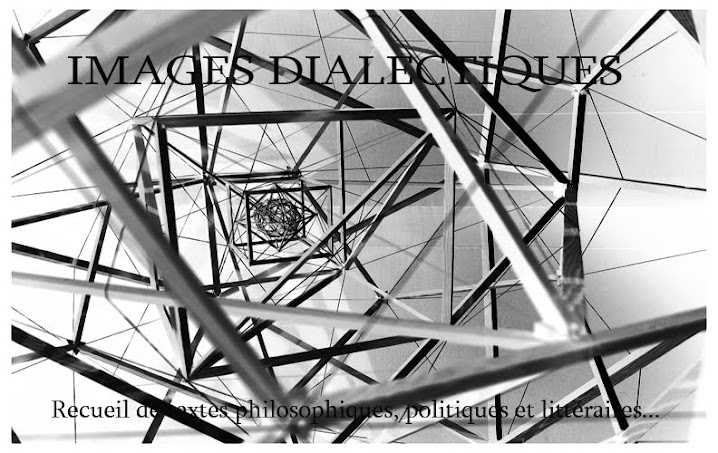Présence de Saint Thomas d'Aquin
Tome 91 2003/3
http://www.cairn.info/search.php?WhatU=francisco%20de%20vitoria&Auteur=&doc=N_RSR_033_0397.htm&ID_ARTICLE=RSR_033_0397&DEBUT=#HIA_1
La « Somme théologique » de Thomas d’Aquin aux xvie-xviiie siècles
Philippe Lécrivain, Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris
Résumé de l'article
On discerne habituellement trois grands moments dans l’histoire du thomisme : les cent cinquante années qui suivirent la mort de Thomas d’Aquin (1274), les efflorescences des xvie-xviiie siècles, et le temps qui suivit l’encyclique Aeterna Patris de Léon XIII. A quoi s’ajoute un quatrième moment, celui des dernières décennies, dont rend compte dans ce dossier J.-P. Torrell. La contribution de Ph. Lécrivain s’en tient à ce moment où, poussés par l’humanisme et l’« évangélisme », les théologiens souhaitent une authentique rénovation de leur discipline. Pour cela, ils abandonnent les jeux subtils de la dialectique décadente pour en revenir aux sources, la Bible et les Pères. Le parcours historique se fait ici en trois parties : l’avènement de la « Somme théologique » comme texte classique chez les Dominicains aux prises avec la Renaissance et la Réforme ; les grandes heures des écoles salamantines et leur enfermement ; enfin, la désagrégation de la théologie sous les assauts d’une nouvelle rationalité.
Plan de l'article
• L’entrée de la Somme dans l’enseignement
— Une lente opération dans l’ordre des Prêcheurs
— Cajétan, maître général et cardinal
• Thomas d’Aquin dans les efflorescences espagnoles
— Les écoles salmantines
— Une querelle qui ne s’est point finie
• Désagrégation de la théologie ou spécialisations ?
— Jean de Saint-Thomas, l’ultime « commentateur »
— Les chemins nouveaux de la théologie positive
On discerne habituellement trois grands moments dans l’histoire du thomisme : les cent cinquante années qui suivirent la mort de Thomas d’Aquin (1274), les efflorescences des xvie-xviiie siècles, et le temps qui suivit l’encyclique Æterni Patris de Léon XIII (1879). Il faudrait sans doute ajouter un quatrième moment et qualifier d’une manière nouvelle les récentes décennies et l’effort fait pour retrouver la pensée thomasienne. Nous nous en tiendrons ici à la seconde période, c’est-à-dire à celle de la Contre-Réforme et du Baroque.
À cette époque, poussés par l’humanisme et « l’évangélisme », les théologiens souhaitent une authentique rénovation de leur discipline. Ils abandonnent les jeux subtils de la dialectique décadente pour en revenir aux auteurs dont la réflexion, appuyée sur la Bible et les Pères, vise aussi à la systématisation conceptuelle. La Somme théologique de Thomas d’Aquin acquiert ainsi un grand prestige chez ceux qui, tel Francisco de Vitoria, Melchior Cano ou Francisco Suárez, tentent d’honorer les problèmes de leur époque. Mais cette théologie, produit d’une activité d’école et création de religieux attachés aux traditions de leur ordre, ne tarde pas à devenir une scolastique. Des querelles sans fin s’ensuivent et tandis que les Jésuites cèdent à un moralisme pratique, les Dominicains s’ankylosent dans un thomisme conservateur. À Salamanque même, le siège de l’orthodoxie thomiste, l’originalité régresse et l’enseignement devient monotone. Jean de Saint-Thomas enseigne d’ailleurs à Alcalá. Mais voici que, face à Thomas d’Aquin, se dressent Augustin et ses nouveaux interprètes, et il devient urgent de retourner une fois encore à l’Écriture, aux Pères et aux Conciles. Denys Petau et Louis Thomassin s’y exercent.
Voici très rapidement esquissé ce que l’on voudrait traiter ici : l’avènement de la Somme théologique comme texte classique chez les Dominicains aux prises avec la Renaissance et la Réforme ; les grandes heures des écoles salmantines et leur enfermement ; la désagrégation de la théologie sous les assauts d’une nouvelle rationalité.
1. L’entrée de la Somme dans l’enseignement
Après avoir subi, comme leurs contemporains, un fléchissement dans leurs productions théologiques, les Dominicains retrouvent, au tournant des xve et xvie siècles, une réelle vitalité. Alors, partout en Europe, les universités sont établies ou achèvent de s’établir, et l’ordre des Frères prêcheurs y est associé. Mais d’autres fondations exercent une action profonde sur les Dominicains : la création de grands studia pour la formation de leurs maîtres. Une double transformation dans la méthode d’enseignement s’ensuit : la substitution de la Somme théologique aux Sentences du Lombard, et l’apparition d’une longue lignée de commentateurs.
Une lente opération dans l’ordre des Prêcheurs
Deux courants s’affrontaient jusqu’alors dans les universités : la via antiqua des thomistes et des scotistes et la via nova des nominalistes et des terministes [1]. Mais un troisième courant, l’albertisme, est apparu bientôt à Paris avec Jean de Maisonneuve (+ 1418), et à Cologne avec son disciple, Heimeric Van de Velde (+ 1460) qui s’opposaient, l’un et l’autre, à Thomas d’Aquin et à Guillaume d’Ockham. Face à eux, s’est dressé Jean Cabrol (1380-1444) [2], le « prince des thomistes ». Mais si, dans ses Defensiones theologiœ divi Thomœ Aquinatis (1433), il reprenait ses disputes menées contre les scotistes, les occamistes et même certains thomistœ jugés égarés, il ouvrait aussi la voie aux théologiens à venir en classant, dans son commentaire systématique du Livre des sentences, les grands thèmes thomistes.
Mais alors, chez les Dominicains et ailleurs, on prend mieux conscience de l’importance de la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Certains Prêcheurs avaient même voulu l’enseigner dans leur province romaine, mais un chapitre général avait suspendu l’expérience et cette interdiction avait souvent été réitérée. Un siècle se passa donc jusqu’à ce que Henri de Gorcum rédige, à Cologne, un Compendium de la Somme mais qui ne sera publié qu’en 1473, après sa mort. En fait, c’est avec un de ses disciples, un séculier, Jean Tinctor (+ 1469), qu’un pas décisif est franchi et que sont commentées la prima et la prima secundœ. Les événements alors se précipitent.
En 1480, tout professeur dominicain de l’université de Pavie est nommé avec cette clause : « qu’il lise les œuvres du bienheureux Thomas d’Aquin [3] ». Trois ans plus tard, le 14 février, dans ses ordonnances pour le studium général de Cologne, le maître général de l’ordre, Salvo Cassetta, ordonne : « que, inlassablement, une fois par jour qui n’est pas festif, celui qui est à la tête de tous ou l’un des maîtres à sa place, à moins que la maladie ou une autre cause raisonnable ne s’y oppose, lise des extraits de saint Thomas [4] ». Cette consigne sera entendue et, quelques années plus tard, en 1512, Conrad Köllin (+ 1536) publia un remarquable commentaire de la prima secundœ.
De Cologne, la pratique se répand dans les universités germaniques, à Vienne, à Rostock, à Trèves et à Fribourg-en-Brisgau. En ce dernier lieu, ce ne fut pas sans difficulté puisque le Dominicain Gaspar Grünwald de Colmar eut affaire avec le sénat universitaire parce qu’il lisait la Somme théologique au lieu de la Bible. Mais l’œuvre thomasienne gagne du terrain et prend de l’importance en France aussi avec Pierre Crockaert (+ 1514) dont la carrière illustre bien les remous de l’époque.
Venu à Paris pour suivre à Montaigu les cours de Jean Mair, ce bruxellois ne tarde pas à y enseigner l’occamisme. Entré en 1503 chez les Dominicains à Saint-Jacques, il devient thomiste et est bientôt consacré à l’enseignement. Il commente les Sentences jusque vers 1509 où il décide de lire la Somme théologique [5]. En 1512, à son initiative et sous sa direction, Francisco de Vitoria, son élève, édite la Secunda Secundœ. C’est le premier texte thomasien publié à Paris. Une dizaine d’années plus tard, en 1523, le chapitre général de Valladolid confirma, pour Saint-Jacques de Paris, ce recours à la Somme théologique, allant même jusqu’à demander que l’on y donne à tous les étudiants dominicains « au moins trois leçons par jour prises de saint Thomas [6] ».
Mais alors que l’Aquinate s’impose à Paris et que la manière de l’enseigner se renouvelle, l’humanisme s’y répand aussi. Pour nous en tenir à Érasme qui, comme Crockaert, fréquenta Montaigu, il n’y demeura pas ne parvenant pas à s’adapter à tant d’austérité. Il voyage alors en Europe et notamment en Angleterre où il compose son Éloge de la folie (1509) qu’il dédie à Thomas More. Dans cet ouvrage, il manifeste son peu de sympathie pour les « tortueux et ténébreux » arguments prônés par les scodstes, les thomistes, les albertistes et les occamistes. Quelques années plus tard, il revient à la charge et, dans ses Annotationes in novum Testamentum, commencées à Cambridge et poursuivies à Bâle (1515), il n’hésite pas, tout en reconnaissant son intelligence, à critiquer Thomas d’Aquin qui ignorait le grec et l’hébreu.
Le désaccord entre les humanistes et les scolastiques n’est pas nouveau puisqu’il existait déjà au temps de Pétrarque (+ 1374), mais, dans les deux siècles qui suivirent, il n’a cessé de se radicaliser [7]. On s’en rend compte aisément et l’on ne s’étonne pas qu’invité le 7 mars 1512 à prêcher à Saint-Jacques le traditionnel panégyrique de saint Thomas, Clichtowe déplore « la misère de la théologie contemporaine, qui néglige la très fructueuse doctrine de saint Thomas, pour se tourner vers des voies captieuses et sophistiques, sans valeur théologique ». Pierre Crockaert et ses disciples — on l’a dit — s’y exerçaient alors. Mais pouvaient-ils aller plus loin ? Comme le remarquait déjà M. Grabmann à propos de Jean Cabrol, des trois lignes suivies par Thomas d’Aquin, la mystique, la positive et la spéculative, n’ont-ils pas été portés à privilégier la troisième ? Et puis, en s’engageant surtout dans la voie des commentaires n’ont-ils pas perdu quelque chose de l’esprit conquérant de l’Aquinate ?
Ces questions sont classiques, mais des travaux récents et érudits invitent à des réponses plus nuancées que parle passé. P.O. Kristellar n’hésite pas à souligner l’influence positive exercée par le thomisme dominicain de Padoue et de Bologne pendant la Renaissance italienne [8]. Pierre de Bergame est une figure importante de ce groupe à qui il donne une Concordance et surtout un index fort bien fait des œuvres thomasiennes, la Tabula aurea. Mais, dans la péninsule, on trouve encore, assez éloigné des cercles thomistes traditionnels, un intérêt porté à Thomas d’Aquin et à ses commentaires d’Aristote : ainsi un Pierre Pomponazzi, qui, après avoir étudié sous le Dominicain François Sicuro de Nardo, devint averroïste et rationaliste. Ce courant était fort à Padoue comme l’était aussi l’enseignement scotiste d’André Trombetta. Laissons cela, sans quitter cependant les milieux padouans que fréquente Jacques de Vio (1468-1534).
Cajétan, maître général et cardinal
Plus connu en effet sous son surnom de Cajétan — de Gaète, le lieu de sa naissance — Jacques de Vio entre chez les Dominicains en cette ville et choisit le prénom de Thomas. Il étudie à Naples, Bologne et Padoue où il prend connaissance des œuvres de Jean Cabrol. En 1493, il lit, en cette ville, les Sentences du Lombard. L’année suivante, au chapitre général de Ferrare, il soutient une si brillante dispute avec Pic de la Mirandole qu’il reçoit, sur le champ, le bonnet de docteur. Revenu à Padoue, il compose un De Ente et Essentia contre Trombetta puis, en 1497, il est envoyé à l’université de Pavie pour y enseigner la Somme théologique de Thomas d’Aquin.
En 1501, une nouvelle carrière commence pour le jeune Prêcheur. Il est appelé à Rome comme procureur général de son ordre. Malgré les occupations de cette charge, qui l’oblige à demeurer à la cour romaine, augmentée encore de celle de Vicaire qu’il exerce lorsque le maître général est en voyage, il poursuit son œuvre intellectuelle. En mai 1507, il achève son commentaire de la prima pars de la Somme théologique. L’année suivante, il est élu maître général de son ordre. Deux consignes rempliront désormais ses lettres circulaires à ses frères : « Chassez sévèrement de vos couvents la vie privée et l’ignorance… » (1515).
Non seulement, sous son magistère (1508-1518), il multiple les Studia generalia (Salamanque, Séville, Cordoue et Lisbonne) et menace de déclarer déchus de leur grade les Maîtres oisifs ou incapables, mais lui-même paye d’exemple. Ainsi il termine, en décembre 1511, c’est-à-dire en pleine administration de l’ordre, son commentaire sur la prima secundœ. De 1512 à 1517, il participe au 5e concile de Latran et, qu’à cela ne tienne, en février 1517, il achève son commentaire sur la secunda secundœ.
Créé cardinal en juillet, il est envoyé, l’année suivante, en 1518, comme légat du Saint-Siège en Allemagne où il se rendra trois années durant. C’est à ce titre qu’il eut à connaître des activités de Luther qu’il reçut en octobre 1518. Bien qu’il ait été nommé également évêque de Gaète en 1519, il trouve encore le temps d’achever son commentaire sur la Somme théologique, — il publia en effet la tertia en 1522. Au cours des années suivantes, jusqu’à sa mort le 9 août 1534, il occupe son temps non seulement à sa légation en Hongrie mais encore à ses ouvrages sur la Bible et à d’autres écrits.
Revenons rapidement sur le séjour de Cajétan à Augsbourg en 1518 où la Diète germanique avait été convoquée. C’est là donc que Luther comparut devant le cardinal, les 12, 13 et 14 octobre. Ces rencontres furent un échec comme on le sait : en présence de Staupitz, le vicaire de son ordre en Saxe, le frère augustin déclara en substance que jamais, à sa connaissance, il n’avait enseigné aucune doctrine contraire à l’Écriture, à l’enseignement de l’Église, aux décrets du Saint-Siège et à la saine raison, qu’il acceptait d’être jugé par les docteurs des universités de Bâle, Fribourg, Louvain ou Paris. Ce faisant, Luther se dérobait en faisant de sa position un simple question d’École. Cajétan ne pouvait l’accepter. Il tenta d’amener à résipiscence le frère augustin mais en vain puisque celui-ci quitta Augsbourg dans la nuit du 21 au 22 octobre pour rentrer à Wittemberg.
De retour à Rome, Cajétan fut mis à la tête d’une commission qui devait s’occuper de l’affaire de Luther. Elle prit de jour en jour des proportions plus grandes car bon nombre d’humanistes qui, jusque là, se tenaient sur la réserve, plus par peur que par conviction, s’unirent au frère révolté. Ulrich von Hutten fut un des plus acharnés. Dès lors, Luther se fait plus violent. Ce n’est plus une question d’École, contre le pape, « l’hydre de l’hérésie », il ameute les princes et les peuples. À Rome, les consistoires se multiplient et, le 15 juin 1520, est signée la fameuse bulle Exurge Domine qui déclarait hérétiques les œuvres de Luther. Celui-ci ne se soumettant pas, il fut excommunié le 3 janvier 1521 par Léon X (Decet Romanum Pontificem). À la fin de cette année-là, ce pape mourut et Cajétan fut de ceux qui contribuèrent à faire élire Adrien VI, un austère réformateur à qui il dédia son commentaire de la tertia pars.
Aux dires de ses contemporains, Cajétan est un grand théologien. Assurément, c’est un penseur, et il ne manque pas d’originalité. À plusieurs reprises, nous avons parlé de ses « commentaires » ; peut-être cette expression est-elle indue à propos de son travail sur la Somme théologique ? En effet, tout en se soumettant à la forme d’une explication de texte, article par article, il n’hésite pas à introduire des changements de termes et de contenu. Certaines de ses positions sur l’être, l’analogie, le surnaturel, l’immortalité de l’âme et la notion de personne sont sans doute dues aux options durcies qu’il fit siennes lors de ses polémiques avec les scotistes et les averroïstes padouans. Il s’exprime aussi d’une manière particulière sur la justice originelle, le sacrifice de la messe, la causalité des sacrements et la grâce sacramentelle. Quant à son interprétation personnelle du désir naturel de voir Dieu, elle lui fait élaborer une théorie de puissance obédientielle fort éloignée de celle de Thomas d’Aquin. Mais, sur ce point, les auteurs contemporains divergent.
Cajétan est aussi exégète mais il le devint surtout après ses débats avec Luther et les humanistes. À ce titre, il est partisan d’un sens littéral rigoureux et fait sienne, d’une certaine manière, la méthode critique inaugurée par les humanistes. Toutefois cet apport demeure extrinsèque à son activité spéculative. En tant que moraliste, il prolonge son exposition sur la prima secundœ par une Petite somme des péchés à l’usage des confesseurs — où il traite de la justice et du mariage selon un ordre alphabétique —, mais, ce faisant, il renoue avec une pratique que voulait dépasser l’Aquinate.
Cajétan tient assurément une place importante dans l’histoire du thomisme, et son commentaire de la Somme théologique, introduit en partie en 1570, à la demande du pape dominicain Pie V, dans l’édition des œuvres de Thomas d’Aquin, la Piana, fait sans doute sa célébrité [9]. Cependant si, face à la montée du luthéranisme, l’Église catholique s’est largement appuyée sur ses interprétations, et si, après le concile de Trente (1545-1563), on a pu dire qu’elles servirent de voie d’accès à la pensée thomasienne [10], nous ne devons pas oublier les autres héritiers de Jean Cabrol.
Notons Silvestre de Prierio (+ 1524), un Dominicain qui s’opposa à Luther dès 1518 et qui avait publié en 1497 un Compendium Capreoli. Quelques années plus tard, en 1522, fondé lui aussi sur Jean Cabrol, paraît un autre manuel signé par Isidore des Isolani (+ 1527). De tels ouvrages montrent qu’au moment de la Réforme protestante, existait déjà une littérature thomiste.
Un autre exemple nous est offert par François Silvestre de Ferrare ( 1474-1528), qui fut élu maître général des Prêcheurs en 1525, sans doute à l’instigation de Cajétan. Les deux hommes s’estimaient beaucoup. Ainsi quand, après avoir rédigé un commentaire de la prima pars de la Somme théologique, François Silvestre de Ferrare eut lu celui de Cajétan, il en fut si émerveillé qu’il refusa de publier le sien et se mit à travailler sur le Contra Gentes. De cet ouvrage, Cajétan fit à son tour le plus grand éloge, et lors de son passage à Bologne en 1518 — il se rendait alors en Allemagne —, il supplia les frères de le faire imprimer [11].
Pour conclure cette première approche, rappelons rapidement qu’au tournant des xve et xvie siècles, les thomistes, déjà nombreux, tendent à mettre en valeur certains thèmes qui les distinguent de leurs collègues théologiens. Ils tiennent ainsi qu’au-delà de la nature, il existe la grâce que Dieu révèle aux croyants. Ils affirment aussi que la distinction de ces ordres n’est pas seulement « modale » mais s’étend à la « substance » même des choses, de sorte que, sans la grâce offerte dans le Christ, les hommes ne peuvent atteindre à la communion trinitaire. Selon eux encore, si ce sont la foi et la grâce seule qui créent, dans la personne humaine, une réelle participation à la vérité et à la vie de Dieu même, elles le font sans violence, puisque, de manière intrinsèque, il existe une harmonie ordonnée entre la nature et la grâce, d’une part, et la foi et la raison, de l’autre. Il s’ensuit qu’aucune contradiction ne peut surgir entre ce à quoi l’on croit par la foi, et ce que l’on connaît par la raison, sans oublier que, selon le fameux adage thomiste, « la grâce parfait la nature ». Néanmoins, le caractère pleinement théologal de la vertu de la foi fait que personne ne peut être persuadé par une argumentation humaine de confesser les articles de la foi chrétienne puisque la vérité des mystères divins qu’ils incarnent ne peut être vérifiée qu’en Dieu seul. Les thomistes sont conscients qu’il y a certains « préambules » que la raison peut démontrer ; mais, selon eux, ce genre de raisonnement ne va pas très loin.
Les thomistes maintiennent, en anthropologie, que la personne agit comme agent libre et comme seconde cause car il est impossible, selon eux, que la causalité universelle de Dieu ne respecte pas la nature créée libre. Quant à la prédestination, ils insistent, sans tergiverser, sur la primauté de la toute-puissance et de la miséricorde divines, en affirmant que le libre choix de Dieu explique que certains soient prédestinés à la grâce et à la gloire. Mais le fait de se réclamer de cette interprétation pour impliquer que Dieu est capricieux et sans pitié ne trouve aucun appui ni chez Thomas d’Aquin ni chez ceux de ses disciples qui, comme lui, soulignent la bonté surabondante de Dieu. En conséquence, les thomistes ne font pas appel à une prescience divine quant à la façon dont l’homme répondrait à la grâce. En fait, ils considèrent que toute explication qui nécessiterait la mise en parallèle de la coopération humaine et de la puissance divine s’oppose à une saine compréhension de l’amour de Dieu.
En insistant ainsi sur la bonté divine, les thomistes ne cherchent pas d’autre raison à l’Incarnation que la Rédemption. Ils tiennent par conséquent avec Thomas que, si l’homme n’avait pas péché, le Christ n’aurait pas eu à s’incarner. Cette logique s’étend aux sacrements qui, en même temps qu’ils sont signes, servent d’instruments véritables à la grâce. En tant que causes instrumentales séparées, ils effectuent ce qu’ils signifient ex opere operato. Dans la même perspective, les thomistes ont tendance à voir d’abord l’Église comme une réalité spirituelle constituée par la grâce capitale du Christ, expression que Thomas d’Aquin utilise pour exprimer la notion paulinienne de « chef » — de sorte qu’ils sont peu disposés à considérer l’ecclésiologie comme un sujet théologique à part dont on pourrait avoir pleine connaissance en dehors de la grâce du Christ.
Ces thèses qui, bien évidemment, ne sont qu’une reconstruction, n’ont pas été partagées par tous les Dominicains : un Ambroise Catharin (1484-1553), par exemple, qui se veut polémiste à la manière de Savonarole. À propos de ses idées sur la prédestination et la prescience divine, il se vit reprocher en 1542 par le vicaire de l’ordre de n’être point scolastique, tandis que certains censeurs jésuites les accueilleront avec bienveillance…
2. Thomas d’Aquin dans les efflorescences espagnoles
Dans cette deuxième approche, nous nous intéresserons essentiellement à l’Espagne et, plus encore, à Salamanque. Ce choix est peut-être regrettable mais avant que Melchior Cano n’y prenne possession d’une chaire en 1543, Alcalá ne compte pas de prestigieux théologiens. En revanche ses humanistes se sont rendus célèbres dès 1527 en défendant Érasme dont on voulait expurger les écrits. Quoi qu’il en soit, cette université eut le mérite de rivaliser avec Salamanque. Les Dominicains s’y succédèrent mais sans se ressembler et, si leur opposition aux Jésuites demeure constante, elle varie quant à son objet.
Les écoles salmantines
La Salamanque dominicaine marqua l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la France et même l’Amérique. Coimbra devint l’héritière directe de Vitoria, à travers Bernard de la Cruz et Martin de Ledesma. C’est à Salamanque que se formèrent Francisco de Toledo, qui enseigna au Collège romain, Diego Alvarez et Thomas de Lemos, à la Minerve de Rome, Lessius à Louvain, Gregorio de Valencia à Ingolstadt et Juan Maldonado à Paris. On a souvent caractérisé la méthode de Salamanque en la comparant à celle de Cajétan. Mais ceci est plus vrai pour les Prêcheurs salmantins de la seconde génération.
Après avoir étudié à Paris sous Jean du Feynier et Pierre Crockaert, Francisco de Vitoria (1492-1546) rentre en Espagne en 1522 pour enseigner à Saint-Grégoire de Valladolid. Dès l’année suivante, il rejoint Saint-Étienne de Salamanque où, sans tarder, il commente la secunda, pars de la Somme théologique [12]. Ce faisant, il impose la méthode acquise à Saint-Jacques : l’élimination des excès dialectiques, une exposition habile et harmonieuse, le souci des questions contemporaines, un goût prononcé pour les considérations morales et le droit positif. Mais les circonstances ne cessent d’élargir ses champs d’intérêt, et de lui imposer un discernement délicat entre les espérances coloniales, le zèle intempestif des prélats et l’inviolabilité du droit naturel des peuples. Il n’hésite pas à soutenir Las Casas venu à la cour de Castille défendre la cause des Indiens.
En 1537, alors que le Prêcheur traite de « la tolérance » dans son commentaire de la secunda secundae, il dénonce la manière dont les indigènes sont traités. Les remontrances de l’empereur ne l’arrêtent pas et, deux ans plus tard, il donne ses célèbres leçons, Sur les Indiens ex. Le Droit de la guerre, considérées comme le fondement du droit international moderne. Désormais, ses idées sont prises en compte, et les lois nouvelles sur les Indes, promulguées en 1542, en portent la marque. Poignant dans sa dénonciation des abus, Vitoria n’en manie pas moins une argumentation serrée qu’il rapporte à Thomas d’Aquin en rappelant que le droit naturel ne saurait être considéré comme une loi positive puisqu’il est fondé sur la nature même d’une personne libre créée à l’image de Dieu et faite pour vivre en société. Comment, dès lors, ne pas respecter les Indiens comme personnes et comme peuples dans leurs propres institutions ? Nul donc ne peut leur faire la guerre sous prétexte qu’ils refusent la vraie religion, car la seule et unique cause d’une guerre juste serait une grave injustice. Imprimés et diffusés, les textes de Vitoria eurent une influence qui dépassa largement l’épisode tragique qui en avait été l’occasion.
Parmi les nombreux disciples de Vitoria, rappelons Domingo de Soto (1494-1560) et Melchior Cano (1499-1566). Le premier, formé lui aussi à Paris, est son compagnon à Saint-Étienne pendant une vingtaine d’années, Il participe au concile de Trente, d’abord comme théologien de Charles Quint, puis comme délégué du vicaire général de l’ordre, où ses interventions sur la justification sont remarquées. En 1551, il préside la controverse de Valladolid entre Las Casas et Sepúlveda. Avec Vitoria, Soto représente l’apport le plus décisif à la renaissance théologique hispanique et à son orientation juridique [13]. Après ses études, Cano enseigne à Alcalá avant de revenir à Salamanque en 1546. Il participe au concile de Trente mais, nommé évêque des Canaries en 1552, il doit renoncer à sa chaire où il avait succédé à Vitoria, et qu’il laisse à Soto. L’épiscopat ne lui convenant pas, il se retire au couvent d’Avila où il écrit son De loris theologicis.
Dans cette œuvre, malheureusement inachevée, Cano veut tenir compte de l’humanisme et de ses conquêtes. Il en appelle à l’épistémologie antique — à celle d’Aristote en particulier —, pour revigorer la scolastique et l’éprouver pour la controverse avec les Réformés. Selon lui, les dix lieux théologiques qu’il retient [14] devraient être utiles aux théologiens soucieux de trouver des arguments pour confirmer ou infirmer une démonstration théologique. Quoi qu’il en soit, s’inspirant de Thomas d’Aquin [15], le Dominicain propose une méthode de recherche et d’appréciation pour servir de base au travail de la théologie spéculative ; mais, ce faisant, il prépare, comme nous le verrons, le chemin à l’indépendance des disciplines positives.
H. de Lubac, évoquant la seconde génération dominicaine de Salamanque, a parlé d’un « thomisme conservateur » [16]. Il est vrai qu’elle se distingue de celle qui la précède par son adoption d’une interprétation rigide d’Aristote, de Thomas et de Cajétan. La réalité est peut-être plus complexe encore, et il faut sans doute considérer aussi les changements d’attitude à l’égard de l’humanisme et du protestantisme. N’est-ce pas ce qui a conduit les seconds salmantins à donner moins d’importance à l’anthropologie, et davantage aux aspects spéculatifs et métaphysiques ?
Les décisions du chapitre général, tenu à Salamanque en 1551, donnent très clairement les orientations qu’il désire voir suivies dans l’ordre des Prêcheurs :
Nous ordonnons que non seulement en théologie sacrée mais aussi en philosophie, on lise, explique et défende toujours la doctrine de saint Thomas comme cela a été commandé par nos pères dans plusieurs chapitres généraux ; en sorte que tous lisent Pierre d’Espagne dans les résumés et le comprennent bien, en rejetant les arguties sophistiques ; en logique qu’on lise le texte d’Aristote et en philosophie pareillement, avec le commentaire intégral de saint Thomas, en rejetant les arguments inutiles et sophistiques. En théologie sacrée, pareillement que tout article — bien entendu de saint Thomas — soit expliqué et élucidé à partir de Thomas lui-même et qu’on réponde aux difficultés comme cela se trouve dans Capreolus et dans Cajétan, laissant de côté leurs fantaisies et leurs inventions [17].
De la seconde génération des Dominicains de Salamanque, nous ne retiendrons que deux noms, Bartolomé de Medina (1528-1580) et Domingo Báñez (1528-1604). À la demande du maître général, le premier publie en 1577 ses commentaires de la prima secundae pars et, l’année suivante, ceux de la tertia. Mais c’est sa Brève instruction sur l’administration du sacrement de pénitence, publiée en 1580 en castillan puis traduite en latin et en italien, qui le consacra comme moraliste. Pour l’instant remarquons que, comme Cano qui recherchait une méthodologie théologique capable d’intégrer les données positives, ignorée par la réflexion médiévale, Medina a tenté d’unir, de manière cohérente, les nouveaux problèmes moraux à la tradition de Thomas d’Aquin. Mais, dans l’un et l’autre cas, nous sommes davantage en présence d’intuitions que de théories achevées.
Condisciple de Medina, Dominique Báñez est l’héritier de la tradition thomiste initiée par F. Vitoria et continuée par M. Cano, D. de Soto et P. de Sotomayor (+ 1564). Après avoir enseigné à Avila et à Alcalá, il revient à Salamanque en 1577 où il s’acquiert une réputation solide. Commentateur de la prima et de la secunda pars de la Somme théologique, il n’hésite pas à traiter les questions par les sommets. Sans être un théologien très original, il s’oppose à Cajétan pour souligner le rôle de l’esse dans la philosophie thomasienne. En revanche, il parle de la liberté et de la grâce en des termes nouveaux. Ce faisant, s’éloigne-t-il de saint Thomas ? Sur ce point les docteurs disputent, comme nous le verrons.
Alors que s’affirme cette seconde génération salmantine de Dominicains, d’autres orientations se font jour parmi les théologiens. Certains, soucieux selon le concile de Trente de voir instituer des chaires d’Écriture dans les facultés de théologie, écrivent sur la manière de lire la Bible [18] ; mais le livre le plus achevé — parallèle à l’œuvre de Cano pour la théologie systématique — est celui de Cantalapiedra, Libri decem hypotyposeon theologicorum, sive regularum ad intelligendum Scripturas divinas (1582). Dix ans plus tôt, cet auteur avait été mis en prison. Son tort, comme celui de Sigüenza et de Luis de León, était de « judaïser ». Mais ses adversaires — dont Bartolomé de Medina —, lui reprochaient bien davantage ses positions sur la Vulgate, son recours à l’exégèse allégorique et surtout ses critiques envers la scolastique. Un long procès s’en était suivi dont il était sorti blanchi, ainsi que Luis de León. Cette affaire fut malheureuse pour la scolastique, trop réservée par rapport à l’usage exégétique, et pour la Bible, qui ne put bénéficier librement des études juives. Durant ces débats, si les Jésuites étaient restés discrets, ils ne s’en étaient pas moins sentis très concernés.
Bien que disciples, pour la plupart, des professeurs dominicains de Salamanque, les théologiens jésuites s’étaient aussi appliqués à l’étude de l’Écriture, ainsi, par exemple, Juan Maldonado (+ 1583) durant son enseignement à Paris. Tenons-nous en ici aux Espagnols, à deux Andalous : Francisco de Toledo (1533-1596) et Francisco Suárez (1548-1617), et à trois Castillans : Luis de Molina (1536-1600), Gregorio de Valencia (1541-1603) et Gabriel Vazquez (1549-1604). Fortement inclinés vers la spéculation et la métaphysique, ces hommes peuvent être considérés comme de bons représentants de la scolastique baroque.
Francisco de Toledo, disciple de Dominique de Soto, après avoir enseigné la philosophie à Salamanque, apporta la réforme salmantine au Collège romain. Là, il donna des commentaires de l’évangile de Jean et de l’épître aux Romains, mais son ouvrage le plus important est son In Summam theologicam S. Thomœ enarratio où il se montre un auteur exigeant et critique de l’interprétation de Cajétan. Selon H. de Lubac cependant, ses positions sont archaïques : « Ce solide esprit manque de l’envergure nécessaire pour reconstituer l’ancienne atmosphère de pensée, ou pour exposer de manière inédite les arguments qui justifieraient, en face des problèmes nouveaux et des difficultés nouvelles, le maintien des anciennes positions […] En soi, le conservatisme de Toledo était légitime. Trop purement défensif, il ne pouvait être efficace ». Devenu le premier cardinal jésuite, il fut toutefois présent dans la majorité des conflits théologiques de son temps.
Tout autre est Francisco Suárez, le Doctor eximius de la théologie moderne. D’une grande acuité pour les problèmes spéculatifs, il enseigna durant plus de quarante ans et produisit une œuvre importante [19]. Ses Disputaliones metaphysicœ (1597) sont vigoureuses, et leur bon accueil, en Allemagne notamment, s’explique par leur séparation d’avec la théologie. Nous reviendrons sur ce point. Certaines de ses positions sont assez peu thomistes : ainsi sur la distinction de l’essence et de l’existence ou à propos de l’individuation où il montre sa préférence pour l’empirique. Dans son De legibus (1612), un autre de ses écrits très célèbres, il s’éloigne aussi de l’Aquinate dans sa manière de concevoir la loi. Il rejette ainsi l’opinion selon laquelle elle exprimerait une ordonnance de la raison ; mais insiste sur le fait qu’étant donné son rôle dans la société, elle ne peut provenir que de la volonté du législateur, et trouve par là sa réalité déterminante. À propos enfin des relations de la liberté humaine et de la toute-puissance divine, Suárez rejette encore le point de vue thomiste, selon lequel une praemotio physica de la part de Dieu pourrait donner forme aux actions libres de l’homme. En revanche, il pose en principe une congruence de l’œuvre divine et de l’effort humain qui, dans la grâce efficace pour accomplir des actes salutaires, met l’accent sur l’effort humain. Notons, pour terminer, que, dans son commentaire de la tertia pars, Suárez, à la différence de beaucoup, accorde beaucoup d’importance à « la vie du Christ ».
Sous l’influence d’un de ses compagnons, Pedro de Fonseca, dont il avait suivi les cours, Luis de Molina, bien avant Suarez, avait tenté de concilier la grâce et la liberté. Pour fonder la doctrine tridentine de l’intégrité fondamentale du libre arbitre de l’homme, même sous la grâce efficace, il avait développé l’idée d’une scientia media, et publié en 1588 sa Concordia liberi arbitrii cum gratiœ donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione qui provoqua, comme on va le voir, l’une des batailles les plus passionnées de l’histoire de la théologie. Son nom devint célèbre à cette occasion bien qu’alors, Gregorio de Valencia et Gabriel Vásquez le soient bien davantage, le premier par sa tentative pour harmoniser la scolastique et la théologie spéculative, et le second, qui est un débatteur consommé, par son souci de revaloriser la théologie positive sans renoncer à la spéculation.
Avant d’en venir à la querelle de Auxiliis, nous devons évoquer encore les Carmes et les Augustins qui surent garder à Salamanque leur indépendance entre les Jésuites et les Dominicains. Lors de leur chapitre de Naples de 1539, les Augustins avaient décidé que ce que Gilles de Rome n’avait pas exposé serait expliqué d’après Thomas d’Aquin, et Seripando, élu supérieur général à ce chapitre-là, avait étendu cette norme à toutes les provinces [20]. Mais, dans les années suivantes, les Augustins — notamment Diego de Zúñiga (1536-1598) [21] — avaient promu aussi l’étude de l’Écriture. C’est dans cette école que Luis de León (1527-1591) s’imposa par son œuvre biblique et théologique, centrée sur le Christ et ouverte aux nouveaux problèmes, mais aussi comme poète et comme mystique [22]. Quant aux Carmes, dont nous présenterons ultérieurement les cours connus sous le nom de Salmanticenses, évoquons seulement Juan de Guevara (1511-1600) qui sut se montrer fidèle à l’enseignement de Thomas, non seulement dans ses commentaires de la Somme, mais encore dans ses traités originaux, ou quand, en raison des exigences de sa chaire, il devait expliquer les commentaires de Durand sur le Lime des sentences.
Une querelle qui ne s’est point finie
Les hostilités entre l’Ordre des Frères prêcheurs et la Compagnie de Jésus, ouvertes en Espagne, se poursuivirent à Rome, de 1594 à 1607, avec les Congrégations romaines De auxiliis divinœ gratiœ. Contre les Jésuites, champions de l’intellectualisme thomiste, qui croient à la nécessité intrinsèque de la création et à la nature raisonnable en tant que raison, les Dominicains sont devenus des interprètes vigoureux d’Augustin, et les défenseurs du volontarisme théologique. Mais pour bien comprendre les enjeux du débat, il faut en préciser davantage le point de départ [23].
Œuvre de Dieu et de l’homme, le salut s’accomplit en trois temps. Au premier, l’homme ne participe que par son néant sur lequel Dieu verse sa grâce. Au second, aidé de cette grâce, il concourt par le libre exercice de ses facultés. Au troisième, il apporte le mérite de l’acte vertueux, que la justice divine couronne. Ainsi, Dieu commence sans l’homme l’œuvre de son salut, la continue avec lui et l’achève à cause de lui. Œuvre gratuite dans son ensemble, car rien ne se serait fait si Dieu n’avait pas pris une initiative à laquelle rien ne l’obligeait ; œuvre de justice dans son terme, puisque la gloire est la récompense gagnée par la vertu. Sur ces points fondamentaux, les Jésuites et les Dominicains sont d’accord, et c’est par là qu’ils se séparent et des pélagiens qui soutiennent le libre arbitre contre la grâce, et des luthériens qui privilégient la grâce aux dépens du libre arbitre.
Les difficultés surgissent dès qu’ils veulent cerner le rôle des acteurs : comment la grâce divine influe-t-elle sur la volonté libre de l’homme ? Comment Dieu prévoit-il de toute éternité l’usage libre que l’homme fera de cette grâce ? Comment, par elle, Dieu peut-il amener infailliblement la liberté humaine, sans la violenter, à ses fins providentielles ?
Báñez [24] adopte la théorie dite des décrets divins prédéterminants. Par ces décrets, Dieu détermine, de toute éternité, que tel homme, dans telle circonstance, agira de telle manière, et que, dans ce but, il recevra, au moment voulu, la grâce irrésistible qui le déterminera à n’agir que de cette manière et, toutefois, ajoute-t-il, librement. Ces décrets apportent une réponse aux questions posées. L’efficacité de la grâce sur la volonté lui vient de ce que sa vertu propre est telle qu’elle ne peut produire que l’effet voulu par Dieu, à l’exclusion de tout autre. Mais ce système ne donne-t-il pas trop à Dieu et pas assez à l’homme, et ne fait-il pas de ce dernier un simple instrument mû par une impulsion irrésistible ? Où donc est la liberté de l’homme ? Pourquoi le dit-on responsable de l’acte causé par la grâce, puisqu’il n’a pas dépendu de lui d’avoir ou de ne pas avoir cette grâce, et que, cette grâce reçue, il ne dépend pas davantage de lui d’en empêcher l’effet ?
Sentant le piège, Molina [25] et quelques autres ont cherché la solution de ces problèmes dans la liberté de l’homme et la science moyenne de Dieu. La créature libre, même placée sous l’influence de la grâce, doit, selon eux, conserver le pouvoir de se déterminer elle-même. Sans ce libre choix, la liberté n’est qu’un vain mot. Il faut donc exclure tout secours de Dieu qui déterminerait la volonté sans lui permettre de choisir. D’ailleurs, pense-t-on parmi ces théologiens, Dieu, à qui rien n’échappe, pas plus le futur que le présent, pas plus le possible que le réel, pas plus le conditionnel que l’absolu, sait de toute éternité à quoi chaque homme se déterminerait dans chaque circonstance et avec chaque grâce possible : c’est la science moyenne de Dieu.
De là découle la solution des difficultés proposées. En effet, d’où la grâce tient-elle son efficacité ? De sa vertu sans doute, mais considérée comme unie au consentement que la volonté, aidée par elle sans être nécessitée, lui donne, alors qu’elle pourrait ne pas le lui donner. Comment Dieu sait-il si l’homme acquiescera à cette grâce ou lui résistera ? Parce que, de toute éternité, par sa science moyenne, il sait que cet homme, s’il se trouve placé dans ces conditions, agira de telle manière. Comment Dieu conduit-il à ses fins la créature libre, sans la violenter ? Comment, par exemple, s’il veut absolument le salut d’un homme, peut-il l’assurer sans léser la liberté ? En choisissant, dans son immense miséricorde, les grâces auxquelles il prévoit que, librement, cet homme consentira, sachant que, ce faisant, celui-ci parviendra au salut, non pas irrésistiblement, mais infailliblement.
Les théologiens de la Compagnie de Jésus ont largement soutenu ces positions. Tous s’accordent sur les deux points qui, aux dires du P. de Scoraille, constituent la substance même du molinisme : coexistence réelle de la grâce et de l’exercice de la liberté, science moyenne de Dieu. Ils se divisent sur des points secondaires. Prenons un exemple. Dieu, souhaitant le salut de l’homme, désire les trois choses qui le préparent : la grâce, l’acte vertueux, la gloire. Mais dans quel ordre les veut-il ? Quel est l’élément sur lequel se porte tout d’abord sa volonté, et d’une manière absolue ?
1) D’après le molinisme pur, Dieu, en vue de sa gloire, a déterminé les grâces qu’il veut faire à tous les hommes et à chacun d’eux. Ces grâces sont inégales sans doute, mais suffisantes pour que chacun puisse se sauver. Par la science moyenne, Dieu prévoit les actes bons ou mauvais que chaque homme fera en usant de ses grâces ou en leur résistant ; et, d’après cette prévision, il destine chaque homme à la gloire ou à la réprobation, que celui-ci a librement choisie. C’est le système de la prédestination et de la réprobation dépendantes de la prévision des mérites et des démérites (post praevisa merita et demerita). Parmi les partisans de cette position, on trouve Toledo, Molina, Vásquez, Valencia, Petau et Lessius que François de Sales a chaudement recommandé.
2) Selon le système dont le P. de Scoraille dit qu’il fut improprement appelé congruisme pur, Dieu de toute éternité a de lui-même choisi les élus qui doivent composer sa cour céleste et fixé le degré de gloire de chacun. Pour la leur faire mériter, il choisit pour chacun des grâces adaptées à cette fin, c’est-à-dire celles auxquelles, par la science moyenne, il sait que l’élu acquiescera. Celui-ci, par son libre acquiescement, mérite ce que Dieu lui avait gratuitement destiné. « Quant aux réprouvés, ils n’ont reçu que des grâces avec lesquelles ils auraient pu se sauver, avec lesquelles toutefois Dieu prévoyait qu’ils ne se sauveraient pas, des grâces suffisantes mais non efficaces. » Il dépendait d’eux qu’elles le fussent, et dès lors leur perte est leur œuvre. Ce système de la prédestination et de la réprobation antérieures à la prévision des mérites et des démérites (ante praevisa merita et demerita) fut celui suivi par Suárez et Bellarmin.
3) Enfin, d’après le congruisme mitigé, Dieu détermine par quels actes vertueux de l’homme il veut être glorifié sur la terre. Cela fait, il lui choisit des grâces convenables, c’est-à-dire celles que, dans sa science moyenne, il prévoit devoir, par le libre acquiescement de l’homme, amener ces actes. À ces actes, dès lors prévus, il réserve pour récompense la gloire. C’est là en apparence un système de prédestination post praevisa mérita ; en réalité, c’est plutôt le contraire. Il fut, à la suite des controverses de Auxiliis, imposé par Aquaviva à toute la Compagnie [26]. Mais cet ordre ne survécut pas à celui qui l’avait donné puisque son successeur, le P. Vitelleschi, le mitigea dès 1616.
Tout bien considéré, les systèmes présentés sont moins différents qu’il n’y paraît. Dans les trois, tout élu est sauvé, parce qu’il a coopéré à une grâce à laquelle il pouvait ne pas coopérer, et tout réprouvé est perdu, parce qu’il a résisté à une grâce à laquelle il pouvait ne pas résister. Dans les trois, pour tout élu, le premier choix de Dieu se porte, indépendamment de l’homme, ou sur le terme, la gloire, ou sur ce qu’il sait devoir infailliblement y conduire. Mais, selon le P. de Scoraille, le molinisme pur sauvegarde mieux l’universelle bonté de Dieu, son impartialité envers les réprouvés, son respect de la liberté des élus. Finalement, dans ces controverses, comme on l’a vu, la question la plus importante — et qui amena toutes les autres — est celle de la grâce efficace : « de la grâce ayant une efficacité voulue et causée par Dieu, ou de la grâce n’ayant qu’une efficacité prévue et aidée de Dieu ».
Si telle est, dans son fond, la querelle de Auxiliis, une question demeure : faut-il attribuer à Molina la doctrine soutenue par les Jésuites, et à son De concordia l’origine des luttes qu’ils soutinrent ? Sans hésiter, il faut répondre négativement. La vérité est que les Jésuites n’ont pas suivi Molina, mais que celui-ci a précisé et coordonné une théologie de la grâce communément reçue. Les Jésuites, comme le reconnaît Báñez lui-même dans son Apologia Fratrum Prœdicatorum, enseignent à Salamanque la doctrine qu’ils ont reçue de leur maître, Soto, qui écrivait en 1551 au chancelier de l’université de Louvain sur l’accord de la grâce et du libre arbitre :
« Je suis frappé de voir la plupart des catholiques, notamment ceux qui se sont fait un nom en combattant les hérésies, affirmer qu’il n’est possible de sauvegarder à la fois, comme ils le veulent tous, le libre arbitre et la nécessité de la grâce, qu’à ces deux conditions : d’abord, que Dieu donne sa grâce, sans laquelle les cœurs ne sauraient se convertir, à tous les hommes et ne la refuse à personne ; ensuite, que, la grâce ainsi donnée, il reste au pouvoir de l’homme, en vertu même de l’activité naturelle de la volonté libre, de correspondre à cette grâce ou de lui résister. Ils sont d’avis qu’il faut admettre ces deux points pour pouvoir maintenir, autrement qu’en paroles, le libre arbitre dans la vérité de sa nature. J’ai su aussi par de nombreux témoignages qu’une grande partie des docteurs d’Italie sont très fermement attachés à cette doctrine. De plus, un docteur de Paris, qui peut inspirer pleine confiance, m’a affirmé que cette faculté même de théologie partage cette opinion et qu’elle condamne comme hérétiques luthériens ceux qui la rejettent. Il semble donc que toute l’Église déjà se soit jetée de ce côté. Il en est même qui, interprétant dans ce sens les paroles du concile de Trente, veulent y voir une définition [27] ».
Ce sont ces principes que Toledo et Lessius opposent à Louvain aux erreurs de Baius (1585-1588) ; ceux qu’avant eux, Bellarmin avait défendus, au début de sa carrière, dans cette même université (1573), et que Fonseca, au Portugal, avait clarifiés par sa théorie de la science moyenne (1565). Mais, en s’attachant à ces opinions, les théologiens jésuites entendaient bien suivre aussi Les règles pour sentir avec l’Église données dans les Exercices Spirituels :
« Bien qu’il soit tout à fait vrai que personne ne puisse se sauver sans être prédestiné et sans avoir la foi et la grâce, il faut faire très attention dans la manière de parler et de s’exprimer sur toutes ces questions. (Règle 14)
Nous ne devons pas, habituellement, parler beaucoup de la prédestination. Mais si en quelque manière, on en parle parfois, qu’on en parle de telle façon que les gens simples n’en viennent pas à quelque erreur, comme cela arrive parfois, en disant : « Que je doive être sauvé ou condamné, c’est déjà décidé ; et que j’agisse bien ou mal, il ne peut plus en être autrement. » Et ainsi, se relâchant, ils négligent les erreurs qui conduisent au salut et au progrès spirituel de leurs âmes. (Règle 15)
De même, nous ne devons pas parler si abondamment de la grâce, ni y insister tellement, que cela engendre le poison qui supprime la liberté. C’est-à-dire qu’on ne peut parler de la foi et de la grâce autant qu’il est possible avec le secours divin, pour une plus grande louange de sa divine Majesté, mais non de telle façon ni de telle manière que, surtout à notre époque si dangereuse, les œuvres et le libre arbitre en subissent quelque préjudice ou soient comptés pour rien. (Règle 17) [28] »
Commentant ces textes, Suárez écrit :
« On le voit, le zèle avec lequel notre Ordre s’attache aujourd’hui à donner au problème de l’accord de la liberté et de la grâce une solution qui satisfasse et qui puisse servir à réfuter les hérétiques de ces derniers temps, ce zèle anima tout d’abord Ignace notre Père. De lui il a passé à ses fils, et l’Esprit de qui la Compagnie a reçu la mission de combattre les hérésies fut aussi le maître de qui elle reçut la doctrine qu’elle leur oppose [29]. »
Bref, quant à la théologie de la grâce, la Compagnie de Jésus était pour l’essentiel moliniste, avant que Molina ne parût, et cette opinion était celle de la grande majorité des catholiques. Mais pourquoi Rome refusat-elle de trancher ? Par peur de s’aliéner l’un ou l’autre camp ? Certainement. Mais ne doit-on pas lire aussi dans ce refus le constat qu’on ne pouvait le faire du fait de l’insoluble difficulté cachée au cœur de la conciliation tridentine ? Pour concevoir la séparation de Dieu, il n’y avait que deux voies possibles à l’époque que nous considérons : ou admettre que Dieu ne prédestine qu’un petit nombre à l’élection, ou reconnaître à tout homme la jouissance de sa liberté. Il fallait penser les deux, et il était alors impossible de les accorder. Rome faisait donc preuve de sagesse en demandant aux deux camps de se taire, mais c’était compter sans la passion des théologiens d’avoir raison de leur foi. D’autres questions se posaient à eux…
3. Désagrégation de la théologie ou spécialisations ?
Si, durant la période inaugurée par les Scholastica commentaria in primam partem Summœ theologiœ D. Thomœ Aquinatis de Domingo Báñez et les Commentaria ac disputationes in primam partem Summœ theologiœ S. Thomœ de Gabriel Vásquez, les commentaires de la Somme sont devenus le lieu principal de l’élaboration théologique, ceci ne doit pas nous abuser. En effet, au même moment, se dessine un mouvement plus important : la désagrégation de l’unité de la théologie. Si celle-ci est une caractéristique de l’époque moderne, elle peut, selon Y.-M. Congar, être considérée aussi comme la mise en place heureuse de nouvelles spécialisations [30].
Au cœur du xviie siècle, comme on le verra, on édita encore des cursus complets et bien des traités publiés portent déjà des épithètes qui accusent la spécialisation des objets ou des méthodes. Ainsi T. Lohner édite-t-il en 1679 des Institutiones quintuplicis theologiœ où sont traitées successivement la positiva, l’ascetica, la polemica, la speculativa, la moralis. Ne pouvant suivre ce savant Jésuite — ce qui nous entraînerait trop loin —, nous ne montrerons ici que la manière dont fut maintenue une apparence d’unité puis nous montrerons ce qui était enjeu dans l’avènement de la théologie positive.
Jean de Saint-Thomas, l’ultime « commentateur »
Jean Poinsot, né à Lisbonne, étudie à Coimbra et à Louvain. Sous le nom de Jean de Saint-Thomas, il fait profession chez les Dominicains, au couvent madrilène de Notre-Dame d’Atocha où il termine ses études et enseigne. En 1625, il est envoyé à Alcalá et, cinq ans plus tard, succède, dans la chaire de Vêpres, à son ami, Pierre de Tapia, devenu titulaire de celle de Prime. De 1631 à 1635, il publie en traités séparés ses cours de logique et de philosophie naturelle, avant d’en donner une édition complète, son Cursus philosophicus thomisticus en 1637. La même année paraît également le premier tome de son Cursus theologicus. Depuis 1633, en effet, Jean est Maître en théologie. En 1641, il succède de nouveau à son ami, mais à la chaire de Prime. Malheureusement, deux ans plus tard, il est appelé par Philippe IV pour devenir son confesseur et son conseiller. Ceci l’oblige à quitter Alcalá et à ralentir la publication de ses travaux.
Le Cursus theologicus comprend huit volumes : les trois premiers sur la prima, les deux suivants sur la prima secundœ, le sixième sur la secunda secundœ et les deux derniers sur la tertia [31]. Cet ouvrage suit l’ordre des questions de la Somme théologique ; celles qui offrent plus de difficultés sont développées sous forme de disputationes. Bien que Jean de Saint-Thomas soit aujourd’hui diversement apprécié par les historiens, ses contemporains n’ont pas hésité à le placer, en compagnie de Cajétan et de Báñez, aux côtés de l’Ange de l’École. Lui-même, alors qu’une fièvre ardente l’emportait, souhaita attester, devant le Saint-Sacrement, n’avoir jamais rien voulu écrire ou enseigner qui ne fût conforme à Thomas d’Aquin. Quelques années plus tôt, il avait lui-même précisé les qualités d’un authentique disciple : 1. Aimer, défendre et développer la doctrine de Thomas ; 2. Accepter ses conclusions et ses démonstrations sans les solliciter ; 3. Continuer l’œuvre des commentateurs en s’en tenant à l’interprétation commune [32].
C’est en disciple, doué de ces qualités, que Jean combattit Vazquez et Suárez plus encore, en s’efforçant de maintenir, contre leur interprétation éclectique, un thomisme plus pur. Contrairement à eux, par exemple, il compare la Présence divine dans l’âme du juste à l’expérience du goût ou du toucher, toutes deux entourées d’obscurité. Son exposé n’est pas une démonstration ; il ne veut être qu’une illustration de la Présence de Dieu par la grâce. Toute représentation, notion conceptuelle ou figure de l’imagination, est dépassée. Il ne quitte pas le champ de la comparaison, où l’analogie maintient la part de dissemblance. Dans son acte de connaître, l’âme se rend certainement compte de sa propre identité : elle ne peut douter que c’est elle qui réfléchit. Pour acquérir une image de sa propre personne, elle doit l’objectiver. Ainsi, dans la grâce, le juste atteint Dieu lui-même comme une autre personnalité, transcendante et immanente à la fois, dont elle ne peut fixer les contours. Elle n’a pas de cette Présence une certitude apodictique, comme l’avaient affirmé les grands scolastiques. Que le phénomène soit réel ou illusoire, seule la révélation peut nous en assurer.
Quoi qu’il en soit, citons, pour conclure, quelques lignes d’A. Gardeil :
« Jean de Saint-Thomas n’a pas tout commenté, mais ce qu’il a abordé il l’a longuement trituré et comme mâché, sans craindre les redites, parfois chez lui si éclairantes. Sans doute, venu l’un des derniers parmi les commentateurs, il a bénéficié des labeurs de tous… Mais, après tout, cela expliquerait aussi bien les Salmanticenses… Ce qui met à part Jean de Saint-Thomas, c’est la profondeur dans la synthèse [33]… »
Venons-en précisément aux Salmanticenses. En évoquant précédemment les Carmes de Salamanque, nous avions volontairement passé sous silence leur deux grandes œuvres collectives. L’une de philosophie, les Complutenses, comprend sept volumes publiés à Alcalá à partir de 1629 ; l’autre de théologie, les Salmanticenses, comprend, quant à elle, dix volumes publiés à Salamanque de 1600 à 1725.
Si les Complutenses, du nom du collège où les Carmes enseignent Aristote à Alcalá, ne sont pas très loin, dans le temps et l’espace, du Cursus philosophicus thomisticus de Jean de Saint-Thomas, ils s’en distinguent quant au fond et, en tout cas, ils ont une autre compréhension des liens qu’il convient d’instaurer entre la philosophie et la théologie. Prenons un exemple. Quand les Salmanticenses abordent l’étude de Dieu, ils la font précéder, non par une analyse des données bibliques ou patristiques, mais par une réflexion sur le principe d’individuation [34]. Par ailleurs, leur insensibilité à l’histoire, — déjà perceptible aussi chez Jean de Saint-Thomas — leur fait omettre assez naturellement certains traités, ainsi les mystères de la vie du Christ dans la tertia. Bref, salués pendant longtemps comme de véritables monuments thomistes, ces ouvrages sont davantage le reflet d’une époque.
Édités en plein xviie siècle, les Salmenticenses correspondent aux exigences d’une formation simple où la matière doit être bien répartie. Et là se perçoit la grande différence d’avec la Somme théologique. Si, dans leur contenu, les « traités » demeurent fidèles à la doctrine de Thomas, ils en ignorent l’unité et le dynamisme. Mais une autre innovation les éloignent davantage de l’Aquinate — et là encore sinon quant au fond du moins sur la forme —, la distinction du dogme et de la morale. Certes les Carmes ne sont pas les premiers à procéder ainsi — Pierre le Chantre parlait déjà de theologia duplex —, mais la pratique s’est clairement établie au xvie siècle sous l’influence des prescriptions du concile de Trente relatives à la confession et des Jésuites qui ont largement contribué à les répandre. Les Salmenticenses sont à l’image de la théologie de leur temps marqués par le primat donné à l’étude des cas de conscience et à la casuistique.
Pour nous en tenir aux « dogmaticiens », nommons Antoine de la Mère de Dieu (1583-1637), le véritable initiateur, Dominique de sainte Thérèse (1606-1654), Jean de l’Annonciation (1633-1701), Antoine de Saint-Jean-Baptiste (1641-1699) et Alphonse des Anges (1664-1737). S’ils furent célèbres en leur temps, on ne peut s’empêcher de trouver aujourd’hui que leurs disputationes abondent dans les détails et la systématique.
En contre-point des Salmanticenses, mais dans la mouvance de Jean de Saint-Thomas, évoquons quelques Dominicains qui tentèrent de rendre à la théologie sa valeur spirituelle. En 1647, dans La Croix de Jésus, où les plus belles vérités de la théologie mystique et de la grâce sanctifiante sont établies, Louis Chardon (1595-1651), en conjuguant la science du théologien et l’expérience du mysdque, apparaît comme l’un des grands spirituels du xviie siècle. Vincent Contenson (1641-1674) laisse, quant à lui, une œuvre inachevée, sa Theologia mentis et cordis. Dépendant de la tradition de Salamanque, il cite Soto, Medina et Cano, souligne fortement l’homogénéité de la foi et de la théologie, et souhaite réintégrer dans une unique théologie les éléments spirituels et les valeurs mystiques.
Ces cas sont isolés, et bien des théologiens d’alors se réfugièrent dans des commentaires de saint Thomas toujours plus érudits. On peut rappeler Jean-Baptiste Gonet (1616-1681) qui résuma avec une grande clarté les meilleurs commentateurs qui le précédaient, en même temps que, sur presque toutes les questions, il adoptait une position personnelle. Antoine Goudin (1639-1695), qui ne fut pas autorisé à publier son Tractatus theologici, parce qu’il n’acceptait pas la doctrine « officielle » sur la grâce et la prédestination. Mais celui qui exerça le plus d’influence dans l’école thomiste fut Charles-René Billuart (1685-1757). Dans sa Summa S. Thomœ hodiernis academiarum moribus accommodata [35], il sut, en effet, insérer dans la trame de Thomas les problèmes soulevés par les controverses protestantes et jansénistes. En 1754, il en publia un Compendium en six volumes qui ne tarda pas à devenir un grand classique.
Mais trois ans plus tard, en 1757, le maître général de l’ordre des Frères prêcheurs, J.T. de Boxadors invitait à nouveau ses frères à se remettre sérieusement à l’étude du Docteur angélique. Huit éditions de ses œuvres complètes parurent alors, dont, en 1775-1786, celle préparée à Venise par B. de Rossi. Et bientôt les Dominicains de la Minerve, à Rome, reprirent le texte de la Somme comme base de leur enseignement théologique.
Revenons en arrière pour évaluer rapidement, comme en guise de conclusion, l’autre voie suivie par la théologie au temps du Baroque.
Les chemins nouveaux de la théologie positive
La division entre théologie positive et théologie scolastique se trouve dans les Exercices spirituels (1548) d’Ignace de Loyola :
Louer la doctrine positive et scolastique. C’est en effet plutôt le propre des docteurs positifs, par exemple saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire, etc., de mouvoir les sentiments pour aimer et servir en tout Dieu notre Seigneur, et c’est plutôt le propre des scolastiques, par exemple saint Thomas, saint Bonaventure, et le Maître des Sentences, etc., de définir ou d’expliquer pour notre époque les choses nécessaires au salut éternel et pour mieux réfuter et expliquer toutes les erreurs et tous les sophismes. En effet, comme les docteurs scolastiques sont plus modernes, non seulement ils profitent de la véritable intelligence de la Sainte Écriture et des saints docteurs positifs, mais encore, étant eux-mêmes illuminés et éclairés par la grâce divine, ils trouvent une aide dans les conciles, canons et constitutions de notre sainte mère l’Église [36].
Dans ce texte, la théologie positive et la théologie scolastique répondent moins à deux fonctions qu’à deux finalités, ou plutôt à deux genres et comme à deux formes de la théologie. En deçà d’Ignace de Loyola, on peut remonter à Jean Mair qui, dans son Commentaire sur les Sentences, publié à Paris en 1509, nous met peut-être sur la voie d’un sens du mot « positif » qui, selon Y.-M. Congar, pourrait bien être le sens originel, désignant à la fois une matière et une méthode [37]. De là, deux conceptions se sont progressivement dégagées : l’une, littéraire, qui représenterait une manière de faire de la théologie, l’autre, méthodologique, qui exprimerait une fonction de la théologie.
La théologie positive prise du point de vue littéraire est la plus commune aux XVIe-XVIIIe siècles [38]. Sixte Fabri, le maître général des Frères prêcheurs, n’avait-il pas, dans une ordonnance du 30 octobre 1583, prescrit qu’au couvent de Pérouse, praeter lectionem theologiœ scolasticœ habeatur quoque lectio theologiœ positivœ ? En revanche, l’œuvre de Melchior Cano s’inscrit dans la seconde perspective. Il s’occupe essentiellement des principes et des fondements de la théologie, et c’est sur ce point que le rejoignent le Jésuite Denys Petau (1583-1652) et l’Oratorien Louis Thomassin (1619-1695).
Dans la lettre qu’il adresse en 1644 au P. Vitelleschi, le préposé général, en même temps que les premiers volumes de ses Dogmata theologica, Denys Petau déclare :
Je n’ai pas suivi, dans ce traité des choses divines, les sentiers battus de la vieille école, j’ai emprunté une voie nouvelle et, je puis le dire sans orgueil, où jusqu’ici personne n’avait encore posé le pied. Mettant de côté cette théologie subtile qui marche à travers je ne sais quels dédales obscurs de la philosophie, j’en ai fait une simple, agréable, jaillissant, tel un fleuve, de ces sources pures et originelles que sont l’Écriture, les Conciles et les Pères et, au lieu d’un visage hérissé et presque barbare qui fait peur, je lui ai donné une physionomie polie et aimable qui attire [39].
Dans ces propos, Petau oublie ce qu’il a reçu, au collège de Sorbonne, d’André Duval [40] (1564-1638), Philippe de Gamaches [41] (1568-1625) et Nicolas Ysambert [42] (1569-1642), et, à Pont-à-Mousson, de Bernard d’Angles et surtout Claude Tiphaine [43]. Il omet aussi de rappeler les maîtres éminents du collège de Clermont, parmi lesquels Juan Maldonado et Fronton du Duc (1558-1624) qui le précéda dans la chaire de théologie positive organisée selon les directives des Constitutions et, plus récemment, du Ratio Studiorum [44].
Denys Petau appartient donc au large réseau de ceux qui souhaitent une nouvelle manière de faire de la théologie afin de mieux se situer face aux humanistes et aux réformateurs [45]. Comment, remarque-t-il en effet, s’obstiner à parler le jargon scolastique devant les hérauts des bonae litterae, à élaborer de subtiles spéculations devant ceux qui attendent une philosophia Christi et une theologia sincera [46], ou à se satisfaire de raisonnements et de conclusions théologiques avec les tenants de la sola Scriptura [47] ? Épris de Pétrarque et de Boccace, Petau entend marcher sur des chemins nouveaux en assumant les ressources historiques et philologiques des humanistes [48]. Le résultat ne se fit pas attendre. Comme Fronton du Duc, il édita des textes anciens à la manière des Paraphrases in Novum Testamentumet in Novum Testamentum annotationes d’Érasme (1516-1517) [49], ou de la Bibliotheca du sorbonniste Marguérin de la Bigne (1575-1579) à qui il se réfère à plusieurs reprises. Nous le voyons, Petau ici relève clairement la « positive » littéraire mais nous devons faire un pas de plus et élucider sa théorie théologique.
Plus que dans sa lettre au Père Vitelleschi, c’est dans le Prologus galeatus, l’avant-propos de ses Dogmata theologica [50], et au début de leurs Prolegomena que Petau expose le mieux son point de vue [51]. Après avoir indiqué les trois sources des connaissances humaines : la raison où l’on puise la science en soi-même, l’opinion où on la puise dans autrui, et la foi où on la puise en Dieu, Petau ajoute, citant Hilaire de Poitiers, qu’il n’est pas difficile de voir laquelle des trois est la source propre de la théologie : « Il faut apprendre de Dieu lui-même la science de Dieu, qu’on ne peut bien connaître que par lui. Est-ce que nos esprits sont capables de pénétrer dans les profondeurs de cette science céleste ? Est-ce que notre infirmité est capable de saisir de ses propres mains l’Être inaccessible ? Il faut croire de Dieu ce qu’il nous dit de lui-même, et, quand il a parlé, il ne nous reste qu’à nous incliner devant sa parole [52]. » Mais, se demande alors Petau, comment apprendre de Dieu lui-même la science de Dieu ? Rien de plus simple : il n’y a qu’à lire l’Écriture, interroger la Tradition et écouter les décisions de l’Église, interprète nécessaire et infaillible de l’Écriture et de la Tradition. Ceci, cependant, ne doit pas se faire sans discernement : « On ne doit pas confondre dans l’Écriture, la Tradition et les décisions de l’Église, ce qui est accidentel à la foi avec ce qui lui est essentiel. Et si en usant de prudence on peut déployer ses ailes pour ce qui est essentiel à la foi, à combien plus forte raison peut-on les déployer pour ce qui lui est accidentel. » Par ailleurs, précise encore le Père, il ne faut pas rejeter totalement les deux autres sources des connaissances humaines : « Ce sont des moyens et des secours au service de la théologie. Et tout cela ne se trouve-t-il pas dans cet art et cette adresse de disserter, que nous appelons la Dialectique, qui est si fréquemment employée pour la science des choses divines, et qui est tellement mêlée et enchaînée partout à la théologie, qu’elle ne fait pour ainsi dire plus qu’un seul et même corps avec elle ? » Pourtant ici, comme dans tout le reste, il faut se tenir dans un juste milieu et ne point trancher d’une façon choquante et scandaleuse certaines questions qui, pour ne pas être de foi, n’en sont pas moins dignes de toute notre attention et de tout notre respect.
Ces principes bien posés, Petau présente alors la manière dont il entend qu’un point de doctrine soit traité, en distinguant le moment de la scolastique, celui de la positive et celui de la polémique : « Je ne saurais me contenter de déclarer et d’illustrer les vérités et les décrets tant de la foi que de la théologie, ni même d’examiner les controverses entre catholiques. Il est de mon devoir en outre de signaler chaque fois l’hérésie opposée au dogme en question et de livrer contre elle une guerre sans merci. » Dans la vie de Petau, la « théologie litigieuse » a tenu une très large place, et tout le monde s’accorde pour voir en lui un polémiste-né. Après avoir terrassé les protestants J. J. Scaliger et C. de Saumaise, il a pris position sans tarder contre l’Augustinus, en publiant en 1643 un De libero arbitrio, libri tres et un De pelagianorum et semipelagianorum haeresi, liber unus. L’année suivante, il répond vigoureusement au De la fréquente communion d’Arnauld. Dans son De la pénitence publique et de la préparation à la communion, après avoir concentré toute son attention sur le sens auquel se doit entendre la tradition vivante qui sert de base à la doctrine catholique, c’est sans pitié qu’il se moque de l’auteur qui accumule les textes des Pères, des papes et des conciles, relatifs à l’ancienne pénitence, pour aboutir à la privation de la Sainte Communion [53].
Après avoir été proche des milieux port-royalistes, Louis Thomassin évolua vers un ultramontanisme modéré qui lui valut des ennuis avec l’Oratoire. Au sujet de la grâce, tout en se disant augustinien, il défend contre Jansénius des « secours généraux » proches de la « grâce générale » de son ami P. Nicole : la grâce est donnée jusqu’aux païens et l’homme coopère à son action. Thomassin est dénoncé comme moliniste et déchargé de tout enseignement. Il n’en donna pas moins lui aussi des Dogmata theologica, en vue d’honorer la mémoire de Denys Petau. Mais la différence entre les deux auteurs est que le premier eut la gloire d’avoir traité cette matière importante en excellent historien, et le second d’avoir réussi à pénétrer en ce que les mystères avaient de plus caché et de plus sublime. Quoi qu’il en soit, avec ces deux auteurs, il semble que l’on mette un point final au salamanquisme baroque.
* * *
Nous voici parvenus au terme d’un long parcours. Nous avons croisé beaucoup de théologiens qui se sont dits les disciples de Thomas d’Aquin. Leur grandeur a été de l’avoir gardé présent en des temps qui n’étaient plus les siens et leur drame, peut-être, d’avoir projeté sur lui les catégories de ces époques. Mais bien qu’on ne puisse tenir pour négligeables les apports d’un Jean Cabrol, d’un Francisco de Vittoria, d’un Francisco Suárez, d’un Cajétan ou d’un Jean de Saint-Thomas, l’héritage de ces commentateurs n’est plus au premier plan et c’est avec plus d’aisance et moins d’acrimonie qu’on stigmatise leurs inflexions et leurs distorsions. Trop souvent étrangers à la perspective historique, ils se sont enfermés parfois dans un aristotélisme étroit et exclusif. Fort heureusement, les travaux thomasiens récents montrent que l’unité du savoir théologique est remise au premier plan. Ne s’efforce-t-on pas de renouer les trois lignes suivies par Maître Thomas : la spéculative, la positive et la mystique [54] ? ■
NOTES
[1] Ceux-ci furent censurés en 1474.
[2] K. White, Jean Capreolus en son temps, Cerf, Paris, 1997.
[3] Memorie e documenti per la storia dell’ università di Pavia, Pavie, 1878, p. 189.
[4] Analecta ordinis prœdicatorum, t. III (1895), p. 377.
[5] Script, ord. præd., t. II, p. 29.
[6] Acta cap. Gener., t. IV, p. 186.
[7] Cf. E. Rummel, The Humanist Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
[8] « Thomism and Italian Thought », Medieval Aspects of Renaissance Learning. Three Essays by Paul Oskar Kristellar, éd. et trad. Par E.P Mahoney, Columbia University Press, New York, 1992, p. 52.
[9] En 1879, Léon XIII fera incorporer la totalité du commentaire à la nouvelle édition dite Léonine.
[10] Notons ici avec A. de Libéra que sa doctrine de l’analogie de l’être, pensée pour faire pièce à la théorie du concept univoque de l’étant selon Duns Scot, est ainsi devenue, pour plusieurs siècles, la pierre de touche de l’interprétation scolastique et néo-scolastique de la multiplicité des sens de l’être selon Thomas.
[11] Ils seront plus tard intégrés eux aussi à l’édition léonine.
[12] Rappelons que dans l’édition qu’il en fit à Paris en 1512, il avait souligné, dans sa préface, deux des qualités de Thomas d’Aquin qui devraient le rendre agréable aux yeux des humanistes : ses fréquentes citations de l’Écriture sainte et ses recours nombreux aux penseurs de l’Antiquité. Ceci explique sans doute la lettre de 1527 adressée à Érasme par Vives, qui avait connu Vitoria à Paris : « Depuis son enfance, il a cultivé les belles lettres… Il t’admire et te respecte… ».
[13] Ses deux œuvres principales sont un De natura et gratia (Venise, 1547) et un De justitia et jure (Salamanque, 1553).
[14] Parmi ces dix lieux, il distingue les sept premiers comme propres au savoir théologique (Écriture, traditions du Christ et des apôtres, autorité de l’Église catholique, conciles, magistère romain, Pères de l’Église, théologiens et canonistes) et les trois derniers (la raison, la pensée des philosophes et l’histoire), qui ne procèdent pas de la révélation, et qui sont appelés extrinsèques. Il n’y a pas d’homogénéité entre les deux registres. L’observation des faits et des événements, dans le monde et dans l’Église, n’a pas de valeur décisive, pas plus que la raison.
[15] Cf. Somme théologique, la, q. 1, a. 8, ad 2.
[16] H. de Lubac, Augustinisme et théologie moderne, Aubier, Paris, 1965, p. 135.
[17] Cité dans « La théologie dans l’ordre des Frères Prêcheurs », D.T.C., t. VI, col. 907. La traduction est de nous.
[18] Cf. Les Regulae intelligendi Scripturas Sacras de Francisco Ruiz (1546), les Annotationes decem ad Sacram Scripturam de Pedro Antonio Beuter (1547), etc.
[19] L’édition vénitienne de ses œuvres complètes (1856-1878) compte vingt-trois volumes in-folio.
[20] Au xviie siècle, cette dévotion à saint Thomas diminua en Espagne et en Italie, à cause de la renaissance de l’ancienne école de Gilles de Rome, qui donna des figures aussi notables que Noris, Berti et Bellelli.
[21] Son De optimo genere tradente totius philosophiae et S. Scripturae explicandae a été édité en 1961 à Valence par I. Aramburu.
[22] Il avait été chargé par le conseil royal de publier les œuvres de sainte Thérèse de Jésus, et avait commencé d’écrire sa vie quand la mort le surprit.
[23] La présentation la plus claire de ces débats difficiles a été faite par Raoul de Scoraille, dans François Suarez, 1912, p. 349-478. Je la suis de très près.
[24] Dominique Báñez, rappelons-le, était titulaire de la chaire de Prime à la faculté de théologie de Salamanque. C’est en 1584 qu’il publia son Traité sur le système de la prédestination physique fondé sur les décrets divins préexistants.
[25] Luis de Molina, s.j. (+1600) publie à Lisbonne en 1588 son De concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divinan praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione.
[26] Le 14 décembre 1613, Aquaviva fit le décret suivant : « Nous statuons et ordonnons qu’en traitant de l’efficacité de la grâce, les nôtres suivent, soit dans les livres, soit dans les cours et les disputes publiques, l’opinion que la plupart des auteurs de la Compagnie ont enseignée, celle qui dans les controverses de auxiliis divinae gratiœ, tenues en présence des souverains pontifes Clément VIII et Paul V, a été proposée et soutenue comme plus conforme au jugement des Pères les plus graves, à la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas. Désormais donc les nôtres devront nettement enseigner qu’entre la grâce qui obtient son effet et qu’on appelle efficace et celle qu’on appelle suffisante, il n’y a pas seulement différence du côté du terme, en ce que par l’usage du libre arbitre agissant sous l’influence de la grâce coopérante, l’une obtient son effet et l’autre ne l’obtient pas, mais qu’il y a encore différence du côté du principe, en ce sens qu’étant données en Dieu la science des futurs conditionnels et l’intention ou volonté efficace de procurer en nous l’acte bon, il choisit lui-même à dessein tels secours, et nous les confère au moment et dans les conditions où il sait qu’ils obtiendront leur effet, disposé d’ailleurs à en employer d’autres s’il avait prévu que ceux-ci dussent être inefficaces ; c’est pourquoi dans la grâce efficace considérée même antérieurement à l’effet qui suit, il y a toujours plus, moralement et comme bienfait, que dans la grâce suffisante ; et c’est ainsi que Dieu fait que nous agissions réellement non pas seulement parce qu’il nous donne la grâce de pouvoir agir. La même chose doit se dire de la persévérance, qui est incontestablement un don de Dieu. »
[27] Cette lettre, Epistola prima R. Patris Petri de Soto confessarii Caroli quinti Imperatoris ad D. Ruardum Tapperum, universitatis Lovaniensis cancellarium, est donnée en appendice dans Antoninus Reginaldus Ord. FF. Praedicatorum. De mente concilii tridentini circa gratiam se ipsa efficacem. Antverpiae, 1706.
[28] Ignace de Loyola, Écrits, D.D.B., 1991, p. 252-254.
[29] De Institute Societatis Jesu, 1613, I. IX, c. v, n° 43.
[30] Y.-M. Congar, « Théologie », in D.T.C., t. XV, 1946, cc. 346 ss.
[31] Les quatre premiers volumes furent édités du vivant de l’auteur, les autres le furent par les soins de Diego Ramirez, son disciple. Une édidon générale parut à Lyon, en 1663, à l’exception du dernier volume qui fut édité en 1667 à Paris par François Combefils.
[32] Cf. De approbatione et auctoritate doctrinae Angelicae, disp. II, art. 5, publié sous le titre Speculum sine macula, par H. Hilden, en 1657 à Cologne.
[33] Cf. La Structure de l’âme et l’expérience mystique, I, Gabalda, Paris, 1927, p. XVIII-XX.
[34] Notons ici qu’à propos de la la, q. 14, art. 4 — Utrum ipsum intelligere Dei sit eius substantia —, les Salmanticenses donnent un commentaire où le « constitutif formel de la déité » est défini comme « l’intelligere subsistant, toujours actuel » là où l’« École thomiste » répond unanimement qu’il y va plutôt de « l’être même (ipsum esse) subsistant dans son aséité ». Cette thèse ne sera pas sans importance dans les débats du xxe siècle.
[35] Cet ouvrage, demandé par le chapitre général de Douai en 1733, fut publié en 19 volumes à Liège, en 1746-1751.
[36] Cf. La 11e « Règle pour sentir avec l’Église » dans les Exercices, in Ignace de Loyola, Écrits, DDB, 1991, p. 250.
[37] Cf. In IVum Sent., 1509, fol. 1-2, cité dans R.-G. Valloslada, Un teologo olvidado : Juan Mair, dans Estudios eclesiasticos, t. XV, 1936, p. 97 et 109. Jean Mair désapprouve ceux qui prolixe in theologia quaestiones inutiles ex artibus inserunt ad longum, opiniones frivolas verborum prodigalitate impugnant…. Quocirca, statui pro viribus materias theologicas ferme totaliter in hoc quarto nunc positive, nunc scholastice prosequi.
[38] Cité par Éd. Hugon, De la division de la théologie en spéculative, positive, historique, dans Revue thomiste, 1910, p. 652-656.
[39] Cité par I.-M. Tshiamalenga, « La méthode théologique chez Denys Petau », dans Eph. Theo. Lov. 1972, p. 427-428.
[40] André Duval publia en 1636 ses In secundam partem Summœ D. Thomœ commentarii Mais le manuscrit 164.39 de la Bibliothèque Nationale contient un In primam D. Thomœ partem annotata… dictata anno 1604. Petau a suivi ce cours au collège de Sorbonne.
[41] Philippe de Gamaches, chargé en 1597 de la deuxième chaire de théologie fondée au collège de Sorbonne par Henri IV. Il commenta la Somme théologique de Thomas d’Aquin.
[42] Nicolas Ysambert, le premier à occuper la chaire de controverse « créée, selon Amann, à l’imitation de ce qui se faisait chez les jésuites », a donné en 1639 un Commentarius in S. Thomœ summam en six volumes.
[43] Quand Petau arrive en 1607 à Pont-à-Mousson, y enseignent Bernard d’Angles et surtout Claude Tiphaine, auteur d’une belle Declaratio ac defensio scholasticœ doctrinœ sanctorum Patrum Doctorisque angelici de hypostasi et persona ad augustissima sanctissimœ Trinitatis et stupendœ Incarnationis mysteria illustranda (1634).
[44] Cf. Constitutions, 4e partie, 14e chapitre, dans Ignace de Loyola, op. cit., p. 507. Et Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, éd. Belin, Paris, 1997, p. 109-113. Dans chaque collège, trois chaires sont consacrées à la théologie. Dans la première — dite d’Écriture sainte, de théologie positive ou encore de théologie dogmatique — on enseigne la Bible, les Pères et les Conciles. Dans la seconde — dite de théologie scolastique — il s’agit de démontrer les vérités révélées par un enchaînement de raisons assises sur des prémisses solides et établies selon les règles de la logique. Dans la troisième enfin, — dite de théologie morale ou des cas de conscience —, on réfléchit essentiellement sur la manière de se conduire en chrétien.
[45] M. Hofmann, Theologie, Dogma und Dogmerentlwicklung im theologischen Werk Denis Petau’s. Regensburger Studien zur Theologie, I. Berne, Munich, 1976, p. 25-27, « Crise de la théologie scolastique en France, avènement de la théologie positive et mystique ».
[46] Cf. Érasme, Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam, Anvers, 1518-1519.
[47] Les positions de Luther et de Calvin sont connues, beaucoup moins celles de Jansénius : Augustinus, t. 2, De ratione et auctoritate in rebus theologicis liber proœmialis in quo limites humanae rationis in rebus theologicis indagantur et Auctoritas s. Augustini… declaratur (Louvain, 1640).
[48] Cf. Les « Écoles de langues d’Alcalá » (1512) fondées par le Cardinal Ximenès Cisnéros, le « Collège des trois langues » (1517) ouvert à Louvain par Busleijden sur les instances d’Érasme, le « Collège royal de France » (1531), créé à Paris par François Ier à la requête de Guillaume Budé (1467-1540) notamment.
[49] R. Guelluy, « L’évolution des méthodes théologiques à Louvain, d’Erasme à Jansénius », Revue d’histoire ecclésiastique, 1941, p. 105-117.
[50] Petau a travaillé vingt ans à cet ouvrage et l’a laissé inachevé. Les trois premiers tomes (1644) correspondent au De Deo uno, De Deo trino et De Deo creante. Un quatrième, publié en 1650, est consacré au De Incarnatione. Le Prologus galeatus se trouve dans Dogmata theologica Dionysii Petavii e Societatis Jesu, édition L. Vivès, 1865, t. 1, p. XIX.
[51] Cf. J.-C. Vital Chatellain, op. tit, p. 384-403.
[52] Cette citation, comme les suivantes, sont extraites (passim) des Prolegomena in quibus de theologia ipsa ejusque principiis ac natura disputatur, édition L. Vivès, t. 1, Paris, 1865, p. 1-59.
[53] L’édition originale du De la pénitence publique et de la préparation à la communion est en six livres. Dès la troisième édition, parue la même année, Petau ajoute deux autres livres. Le viie résume le livre d’Arnauld et sa réfutation, tandis que le viiie répond aux premières répliques à son propre ouvrage. La citation se trouve dans l’édition de Cramoisy, 1644, p. 401.
[54] J.-P. Torrell est l’un de ceux qui a sans doute le plus contribué à ce renouveau. Cf. La « Somme » de saint Thomas, Cerf, 1998, p. 121-144.