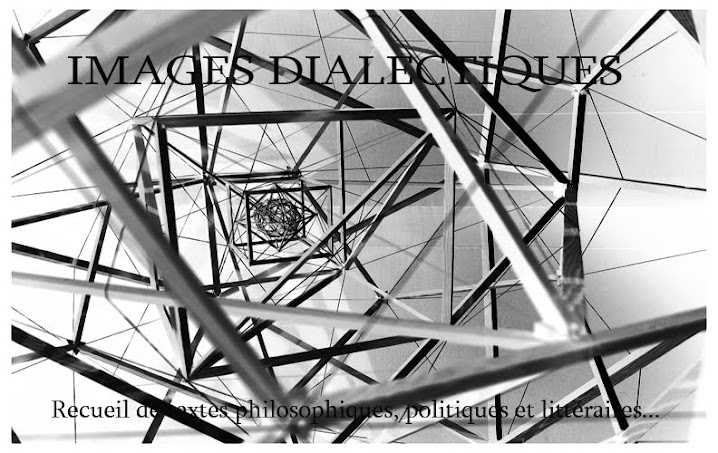Roberto MIGUELEZ, « Machiavel, Hobbes et Rousseau : Parole et Passion », in Les règle de l’interaction, Essais en philosophie sociologique, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2001, pp. 170 – 175.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/miguelez_roberto/regles_interaction/regles_interaction.html
MACHIAVEL, HOBBES ET ROUSSEAU :
PAROLE ET PASSION
On se souviendra que, chez Machiavel, la question des origines de la socialité occupe une place toute secondaire dans sa réflexion. Mais lorsqu'elle est traitée soit sous la forme stricte de question portant sur les origines de la socialité, soit sous celle portant sur les commencements des villes, la réponse à cette question se trouve toujours dans l'idée de résistance à l'attaque, de défense contre l'agresseur. Au début, pour Machiavel, fut la dispersion, « les premiers habitants furent peu nombreux, et vécurent pendant un temps dispersés à la manière des bêtes ». C'est alors que, le genre humain venant à s'accroître, « on sentit le besoin de se réunir, de se défendre ». La naissance des villes ne répond pas à un autre besoin : la dispersion affaiblit les forces et oblige à la réunion . Le conflit et la lutte se trouvent à l'origine même de la socialité ; ils en constituent la cause nécessaire et suffisante. Mais, il faut bien le souligner, ce n'est pas pour mettre fin au conflit et à la lutte que les hommes se rapprochent, mais pour se défendre, voire aussi pour attaquer, car l'attaque suppose encore le rapprochement des hommes. Le conflit et la lutte n'expliquent donc pas seulement les origines de la socialité, mais se trouvent toujours et encore au cœur de celle-ci.
Ce premier rapprochement décisif, rappelons-le, engendre l'ordre politique, c'est-à-dire, pour Machiavel, le jeu du commandement et de l'obéissance, l'ordre moral et l'ordre juridique. Le langage n'a pu ne pas être là, y compris lors du premier rassemblement, lorsqu'il a fallu, d'abord et avant tout, choisir un chef et lui promettre obéissance. L'absence du thème du langage dans cette exposition des origines renvoie, certainement, au fait que celui-ci a le statut d'une donnée. Le thème du langage apparaît, chez Machiavel, toujours pensé du point de vue de sa fonction dans le conflit et la lutte, dans son instrumentalité politique, c'est pourquoi la question des origines du langage est absente dans sa réflexion. Mais le point de vue de la fonction projette une lumière sur la nature du langage qui n'est pas dissociable, bien au contraire, de la question de la nature humaine.
Cette fonction politique du langage, on l'a vu, se laisse appréhender sous la forme d'une règle de lutte de manipulation. Dans ses rapports avec le peuple, le Prince se doit de créer une allégeance, non pas au moyen de la force – ou, en tout cas, de la seule force –, mais surtout en agissant sur l'esprit au moyen du langage. Afin de « circonvenir l'esprit », le discours du pouvoir crée de fausses apparences, et persuade. La persuasion tient à la capacité du langage de créer une adhésion ; la création d'une fausse apparence tient, elle, à la capacité du langage de présenter l'imaginaire comme réel, donc de créer un effet de vérité là où il n'y a que fiction. La manipulation qui s'exerce par le moyen du langage suppose donc l'articulation de la persuasion et d'une fiction qui cache sa nature imaginaire. Ou, pour mieux l'exprimer, la manipulation discursive consiste dans la création d'un effet de vérité, là où il n'y a que fiction, grâce à la persuasion. Dans la manipulation donc, la persuasion crée une adhésion au faux. Si la persuasion créait une adhésion au vrai, il n'y aurait pas de manipulation et l'on ne serait pas dans le registre de l'imaginaire, mais dans celui du réel.
Comment se fait-il que le langage possède cette redoutable propriété ? Machiavel ne cherche pas la réponse à cette question du côté du langage, mais du côté de la nature humaine. C'est que « le peuple cède aux impressions, aux influences », il est d'autant plus sensible aux images qu'il est incapable de mener une réflexion conséquente. D'où le rôle fondamental de la religion, qui s'adresse à l'imagination plutôt qu'à la réalité, aux images plutôt qu'à l'argumentation. Or, pourquoi les hommes céderaient-ils aux impressions, aux influences ? Où se trouve cette faiblesse qui rend possible la manipulation ? Pour Machiavel, les hommes se trouvent sous la domination de leurs intérêts, non pas de leurs vrais intérêts mais de ce qu'ils perçoivent comme étant leurs intérêts, et qui ne sont que ceux qui résultent de leurs besoins présents, plus exactement encore, de leurs passions . La manipulation, comme règle de lutte fondamentale dans les relations entre le Prince et le peuple, donc dans les relations de pouvoir qui sont constitutives de la socialité, introduit ainsi au cœur du politique une thématisation du langage axée sur la dimension perlocutoire de celui-ci. Mais cette dimension n'est appréhendée véritablement que lorsque le langage est montré dans sa capacité de créer des fictions, de jouer sur le registre de l'imaginaire et de provoquer, grâce à ces fictions, des effets de vérité qui ont plus de force que la réalité elle-même. En fait, lorsque, comme c'est le cas de Machiavel, on fait des règles de lutte le paradigme normatif de la socialité, il n'y a que cette dimension du langage qui compte, et que cette capacité du langage qui le définisse mieux que n'importe quelle autre.
Pour Hobbes, au début, ce ne fut pas la dispersion mais le conflit et la lutte, et si les hommes se rapprochent, ce n'est pas pour se défendre ou attaquer, mais pour mettre fin au conflit et à la lutte, et au besoin de se défendre et d'attaquer. La parole est alors condition de l'entente puisqu'elle est le médium par lequel les volontés particulières s'expriment et échangent. Mais elle n'est pas qu'une donnée, car dans l'examen de la parole on découvre le modèle même de l'entente. La conventionnalité qui régit le rapport entre le signe et la chose signifiée, et que l'on ne retrouve que dans le langage humain, est en effet modèle de toute conventionnalité, donc aussi de celle qui s'exprime dans le contrat de socialité mettant un terme au conflit, à la lutte et à la violence dans les rapports humains, et instaurant à leur place une compétition ordonnée et pacifique.
Le contrat de socialité, comme acte premier, suppose chez les hommes la possession de la parole, mais il suppose aussi chez chaque homme, comme dans tout contrat, un calcul des conséquences. Pour Hobbes, la parole ne sert pas qu'à l'expression et à l'échange entre les êtres humains, elle sert aussi, et d'un point de vue logique, au préalable, chez chacun, à l'enchaînement des pensées, elle est le moyen grâce auquel s'enregistre la consécution des pensées ; elle est discours de la réflexivité. Sans parole, donc, pas de raisonnement, mais ceci ne veut pas dire que tout discours est méthodique et raisonné. D'ailleurs, tout calcul des conséquences ne se réalise pas dans le discours. Pour Hobbes, on l'a vu, l'erreur en tant que mauvais calcul affecte autant l'animal que l'être humain, mais l'absurde n'est qu'une possibilité discursive, donc il n'affecte que l'être humain. Car l'absurde ne vient pas d'un défaut de consécution, il naît dans l'agencement des mots. L’erreur ne renvoie donc pas, à strictement parler, à un manque de rationalité, mais l'absurde définit une irrationalité strictement humaine.
Comment se fait-il que l'être humain puisse tomber dans l'absurde ? Où se trouve l'origine de cette irrationalité strictement humaine qui se réalise dans l'absurde ? Hobbes cherche la réponse à cette question et du côté du langage et du côté de la nature humaine. Du côté du langage, c'est, on vient de le voir, dans la forme discursive elle-même que se trouve inscrite cette possibilité de déchéance, car le discours est, avant tout, agencement, articulation de mots. Du côté de la nature humaine, c'est dans l'intérêt commandé par la passion qu'il faut trouver l'origine de l'irrationalité humaine. Dès lors, bien entendu, l'erreur et l'absurde ne seront pas étrangers à la dynamique du pouvoir ; au fait, ce sera au pouvoir d'intervenir dans la question même de l'erreur et de l'absurde, en la retirant du cognitif pour la subordonner au politique : « [...] je ne doute pas que s'il eût été contraire au droit de dominer de quelqu'un, ou aux intérêts de ceux qui dominent, que les trois angles d'un triangle soient égaux à deux angles d'un carré, cette doctrine eût été sinon controversée, du moins étouffée [...] ».
Hobbes rejoint ici Machiavel, car pour que les hommes puissent accepter l'erreur et l'absurde il leur faut une défaillance dans leur capacité de délibération. En fait, pour Hobbes aussi, l'usage politique de l'erreur et de l'absurde repose sur cette possibilité de tout imprimer dans un esprit qui ne délibère ni toujours, ni généralement. D'où encore, comme chez Machiavel, le rôle central de la religion dans le maintien de la soumission et de l'obéissance. De ce point de vue, nous l'avons vu, l'unicité de l'acte contractuel qui inaugure la socialité peut être comprise comme résultat de l'impossibilité de recréer, dans chaque acte de langage, les conditions possibles d'une entente. Mais si cette impossibilité, comme nous venons de voir, renvoie à la nature discursive de la parole comme condition d'effectuation, elle ne se réalise et ne s'explique donc que par la passion. Autant chez Machiavel que chez Hobbes, la passion sépare, et les intérêts qu'elle fait naître ne peuvent pas ne pas être contradictoires, conflictuels. Le langage de la passion transporte à l'intérieur même des individus cette séparation en soumettant la vérité à l'intérêt, rendant ainsi possible l'absurde et non simplement l'erreur. Le langage de la passion est celui de la dissimulation, de la manipulation.
Chez Rousseau, à l'origine fut encore la dispersion, mais le rapprochement n'est pas le résultat d'un calcul destiné à mettre fin à la lutte et au conflit, ou à mieux se préparer pour se défendre ou attaquer. À la rationalité du calcul qui conduit, dans l'art de la lutte, à regrouper ses forces, ou dans l'état perpétuel de guerre à substituer la compétition pacifique à la violence, Rousseau oppose, et c'est une opposition fondamentale parce que radicale, le rapprochement comme résultat de la passion.
Le chapitre IX de l'Essai consacré à la formation des langues méridionales est, à cet égard, décisif. Il commence par le thème de la dispersion des hommes :
Dans les prémiers tems [et Rousseau ajoute en note en bas de page : J'appelle le prémiers tems ceux de la dispersion des hommes, à quelque age du genre humain qu'on veuille en fixer l'époque] les hommes épars sur la face de la terre n'avoient de société que celle de la famille, de loix que celles de la nature, de langue que le geste et quelques sons inarticulés .
Or, et cette remarque de Rousseau a suscité bien des difficultés, à cette époque « ils attaquoient pour se deffendre ». Faut-il, en effet, penser que Rousseau rejoint ici aussi bien Machiavel que Hobbes ? Faut-il penser que l'Essai est en contradiction avec le deuxième Discours qui affirme, directement contre Hobbes, la « douceur naturelle » de l'homme ? Il n'y a point de contradiction, car à l'origine de l'attaque il n'y que la peur, et à l'origine de la peur, la méconnaissance de l'autre : « Ne connoissant rien, ils craignoient tout, ils attaquoient pour se deffendre ». La cruauté ne loge nullement dans la nature humaine, ses sources sont la crainte et la faiblesse . Et c'est ici que Rousseau introduit le thème de la pitié. Parce qu'il y a commisération chez l'homme, il se rapproche de l'autre surmontant sa crainte. Et c'est lorsqu'il se rapproche de l'autre qu'il peut l'appréhender comme un autre soi-même, et s'identifier à lui .
Mais le troisième moment ne repose plus sur la dialectique de l'effroi et de la pitié, sur le triomphe de la commisération sur la crainte, il voit la fête et le plaisir dans le rapprochement, le triomphe du plaisir sur la férocité qu'engendre la peur. C'est le moment de la naissance de la parole, mais c'est aussi celui de la naissance des peuples. Je transcris intégralement ces phrases décisives de l'Essai :
Sous des vieux chênes vainqueurs des ans une ardente jeunesse oublioit par dégrés sa férocité, on s'apprivoisoit peu à peu les uns avec les autres ; en s'efforçant de se faire entendre on apprit à s'expliquer. Là se firent les prémiéres fêtes, les pieds bondissoient de joye, le geste empressé ne suffisoit plus, la voix l'accompagnoit d'accens passionnés, le plaisir et le desir confondus ensemble se faisoient sentir à la fois. Là fut enfin le vrai berceau des peuples [...] .
À l'articulation du besoin et de la raison – à laquelle Rousseau ajoute le geste – qui est au cœur d'une socialité fondée sur des règles de lutte ou des règles de coopération compétitive, se substitue l'articulation du plaisir et de la passion – à laquelle Rousseau ajoute la parole –, au cœur d'une socialité pensée autrement que sous la forme de la domination et de la compétition. Certes, et le deuxième Discours est là pour l'examiner en profondeur, la domination, l'inégalité, la lutte, se sont imposées à la suite d'un pseudo-contrat arraché dans le besoin et par la manipulation. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'une logique du désir et de la passion, de la parole et de la poésie , mais aussi une logique du besoin et de la raison, de l'écriture et de la prose, et une dialectique historique qui a vu une logique se substituer à l'autre dans un processus qui n'est nullement celui du progrès – et c'est le thème central, nous l'avons vu, du premier Discours. Or, comment peut-on saisir dès lors le projet du Contrat social sinon comme celui d'une socialité qui ne pourrait jamais être instaurée dans la seule logique du besoin et de la raison – voire de l'écriture et de la prose ? À la différence de Hobbes, mais aussi de toutes les théories du contrat social fondées sur l'idée d'une entente qui ne reposerait que sur le calcul rationnel des conséquences, sur la rationalité discursive qui se forme à partir des besoins et des intérêts qu'ils commandent, Rousseau ne peut envisager la contractualité d'une socialité égalitaire qu'en présupposant l'attirance du désir, les passions qui rapprochent, et un langage « favorable à la liberté », c'est-à-dire imprégné de figures et de tropes, éloquent .
29 Ekim 2008 Çarşamba
« Machiavel, Hobbes et Rousseau : Parole et Passion »
23 Ekim 2008 Perşembe
Le moment machiavélien
Paul-loup Weil-Dubuc
M1 Philo politique

Fiche de lecture : Le moment machiavélien, J.G.A Pocock
En écrivant Le moment machiavélien en 1975, John Greville Agard Pocock entendait aller à contre-courant d’une histoire de la philosophie politique admise de tous. Dans cette histoire que Pocock critique, Locke règnerait en maître d’une « constellation théorique » (préface de Jean-Fabien Spitz) appelée « libéralisme ». Les hommes, unis en un contrat, accepteraient ensemble de se doter d’un régime leur assurant une protection maximale. La liberté ne consisterait pas dans la participation de chacun au pouvoir politique mais bien plutôt dans la jouissance de droits naturels garantis par l’Etat. L’objectif du livre de Pocock est d’abord de détrôner, non pas cette idée, mais une lecture de l’histoire qui lui donnerait le rôle d’une matrice de l’Etat moderne.
C’est par l’affirmation d’un « moment machiavélien » que Pocock réécrit une histoire de la philosophie politique. Il faut entendre cette expression de « moment machiavélien », nous rappelle-t-il dans son introduction, dans deux sens différents. Le « moment machiavélien » ne désigne pas seulement une période limitée dans le temps où est apparue la pensée de Machiavel. La description de ce moment serait alors la description des circonstances dans lesquelles les idées de Machiavel et de ses contemporains ont vu le jour. Or, Pocock a l’intention de faire émerger un « moment » de la réflexion politique. Attentif aux fluctuations du vocabulaire changeant selon le contexte temporel et spatial où elle s’exprime, Pocock discerne bien, dans tous les cas, l’essence d’une pensée républicaine qui se trouva exprimée pour la première fois chez Machiavel. Ce dernier et ses contemporains ont été confrontés à un problème : la république est un phénomène historique qui naît, maintient son existence et finalement cesse d’exister ; pourtant la république cherche à atteindre l’immuabilité. D’où l’opposition entre la vertu, action de l’homme individuel dont la fin universelle est de maintenir la république. Malgré les diversités sémantiques des notions de « vertu » et de « fortune » et les grandes marges d’interprétation que celles-ci impliquent, ce couple caractériserait l’idée républicaine.
Nous allons donc suivre, avec Pocock, les émergences successives du « moment machiavélien ».
C’est dans la philosophie du Moyen-âge qu’il faut chercher les germes de l’opposition entre la fortune et la vertu.
Elle fait surgir la distinction entre l’accidentel et l’immuable. Or, le particulier, l’accidentel ne peuvent être saisis que par un effort de perception et de réflexion pris dans le temps et dans l’espace qui n’a pas valeur de vérité. A l’inverse, l’immuable a valeur de vérité, dans la mesure où la vérité se reconnaît. Une telle répartition des valeurs du particulier et de l’immuable est incompatible avec l’existence d’une histoire à proprement parler. Pour être validé en tant qu’événement qui s’est réellement passé, l’événement particulier doit être rattaché à une idée universelle. Autrement dit, les hommes n’ont pas le sentiment d’être pris dans une histoire sacrée qui les dépasse. Une histoire séculière existe et pouvait donner à identifier des événements, des symboles, des personnages mais ceux-ci acquéraient une validité lorsqu’ils pouvaient être attachés à une histoire transcendante, c’est-à-dire « interprétés ». Autrement, il n’y avait pas d’intelligibilité des événements. Aucune place n’est donc laissée à la spontanéité de l’action humaine dans le temps.
Dans ces conditions, comment une pensée de la politique, de l’action humaine a-t-elle pu émerger à l’époque de Machiavel? L’évolution vers la naissance d’un temps humain est progressive. Pocock montre que c’est avant tout la considération du politique qui a permis le dépassement de cette subordination des événements particuliers aux universaux, notamment par la réhabilitation dans le domaine politique de la notion aristotélicienne de prudence, accompagnée de celle de coutume et d’expérience. Pocock donne l’exemple de Sir John Fortescue ( env. 1390-1479), juriste anglais, qui définit la prudence comme la capacité à formuler des statuts qui résisteront au temps pour acquérir l’autorité dont jouissent déjà les coutumes. En somme, le particulier peut être articulé à l’immuable par la médiation de la coutume : le particulier est sédimenté dans la coutume, qui, par l’intermédiaire de la prudence, connaissance du particulier, est érigée au statut de loi éternelle, immuable. Il y a bien ici la place pour une connaissance autonome du particulier par la prudence, ce qui est relativement nouveau, selon Pocock. Mais, à certains égards, la pensée du politique reste tributaire d’une vision providentielle du monde. Cela se remarque à l’incapacité que Fortescue semble avoir à rendre compte, autrement que par le mystère, des décisions du Roi dans les moments d’urgence. Le Roi prend des décisions instantanées qui, répétées, prendront force de coutumes. Mais ces décisions recèlent, pour Fortescue, une force mystérieuse.
Le véritable dépassement de cette conception de l’histoire, où l’horizon de la décision et de l’action politique est réduite, reconduite à son insertion dans un ordre théologique, a pu être réalisé grâce à un courant d’idées qui prend une importance toute particulière à Florence : l’humanisme civique. Avant de définir celui-ci, il convient de l’insérer dans le cadre plus général de l’humanisme. Pour l’humaniste qui est un philologue à l’origine, la rhétorique est la rivale de la philosophie, entendue au sens d’une contemplation de la vérité, de même que la « vita activa » est rivale de la « vita contemplativa », distinction héritée de Platon et d’Aristote. La vérité est moins un système de propositions qu’un système de relations auquel l’esprit venait à participer. On insistait donc davantage sur la participation de l’esprit à la vérité, vue comme la condition de la vérité, que sur une vérité transcendante posée à l’extérieur de l’esprit. Pocock voit dans cette humanisme premier les racines de l’humanisme civique. En effet, cette attention nouvelle à l’esprit humain prit un tour sociale, dans la mesure où elle fit naître le souci de comprendre le particulier humain, donc la société. Dans cette mesure, le niveau de connaissance politique atteint un degré maximal lorsque la participation aux décisions politiques est accrue. Aussi l’humanisme civique est-il au cœur de l’idée républicaine.
Si l’humanisme civique permet le dépassement d’une compréhension religieuse du monde dans l’idée de participation, c’est Aristote qui donne à cette dernière un contenu conceptuel. Le problème est, en effet, celui-ci : comment établir un régime qui permette à tous les citoyens de participer au bien public ? Cette solution ne peut être le don absolu de tous les citoyens à un souverain, solution hobesienne qui sera critiquée plus tard. La recherche du bien commun ne peut pas abolir la recherche par chaque individu de son bien particulier. Autrement dit, comme le souligne Pocock (p.76), l’individu engagé dans la quête universelle du bien commun est solidaire de l’individu privé. Il fallait que l’exercice du pouvoir d’un individu soit fondé sur sa vertu particulière . D’où la tentative d’Aristote, dans le livre IV de la Politique, de discerner les différentes catégories de citoyens afin de déterminer leur vertu propre. Aristote distingue alors l’homme seul, le petit nombre et le grand nombre et cherche l’équilibre de ces catégories dans une politeia, que Tricot, le traducteur de l’édition Vrin de la Politique, et Pocock traduisent tous deux par « république ». Pocock parvient donc, de manière convaincante, à mettre en lumière un lien intime entre la pensée politique aristotélicienne et la pensée républicaine. Il montre que, dès lors que l’on cherche la participation de tous les citoyens au pouvoir, idée qui tire sa source, comme nous l’avons vu, de l’humanisme civique, on en arrive nécessairement à une théorie de la répartition du pouvoir qui cherche l’équilibre entre l’homme seul, le petit et le grand nombre. Nous nous approchons là à grands pas des théories de l’époque de Machiavel.
On peut alors, pour mieux saisir le fil de la réflexion de Pocock, rappeler succintement la trame de fond du moment machiavélien : d’abord, affirmation de l’histoire séculière et indépendance progressive de celle-ci par rapport à l’histoire sacrée ; à cela s’ajoutent, à la fois comme cause et conséquence de ce premier élément, l’humanisme civique et son idée de participation du citoyen au pouvoir politique ; enfin, à partir de cette idée de participation, le problème du mode de gouvernement qui fait naître à son tour le problème de la stabilité entre trois composantes du pouvoir.
Or, ce problème de la stabilité ne peut que se poser dans l’histoire pour les théoriciens de la renaissance florentine. Formulé dans des termes qui sont propres à cette époque, il devient : quel régime devons-nous instituer pour que la République survive aux assauts de la fortune ?
Il est clair pour tous les penseurs florentins que la coutume, la deuxième nature des individus, ne peut pas être, comme le pensait Fortescue cité plus haut, un socle assez solide pour un gouvernement républicain. Ce que font émerger les penseurs florentins est une véritable sociologie de la liberté. Quelles que soient leur théorie, la possibilité d’une décision politique est l’objet privilégié de leur attention.
Cette conscience d’un conflit entre la vertu et les accidents de l’histoire étaient particulièrement fortes à Florence pour des raisons qui tenaient à l’histoire politique de cette cité. En 1434, l’avènement des Médicis au pouvoir suscita un renouveau de la pensée politique qui se caractérise par une insistance accrue sur les rapports de la « vertu » et de la « fortune ». Jusqu’en 1494, le régime à Florence n’a alors de république que le nom. Ceci explique l’efflorescence d’une pensée où la fortune l’emporte sur la vertu. Que ce soit chez Cavalcanti ou chez Savonarole, on remarque le recours à une force échappant au contrôle de l’homme justifiant ou légitimant ultimement le cours des choses. Pour Cavalcanti, cette force est la fantasia (personnifiée sous le nom de « Fantasia ») qui « a autorité sur chacun pour exercer toute souveraineté qui m’est accordée par tout l’ordre des étoiles » ( Cavalcanti cité par Varèse). La fantasia diffère de la « fortuna » machiavélienne dans la mesure où elle a une emprise totale sur les affaires humaines. Pour Machiavel, le pouvoir de la fortune s’arrête là où commence la vertu, seule arme susceptible d’instaurer la république. L’histoire, en somme, s’arrête aux portes de la république. Pour Cavalcanti ou pour Savonarole, selon lequel la vertu doit être élevée au rang de grâce pour restaurer, à la fin des temps, la République, la conception d’une vertu rationnelle est impossible. Le passage à des thèmes de réflexion proprement machiavéliens, autrement dit l’avènement du « moment machiavélien » à Florence doit beaucoup aux circonstances politiques. De 1494 à 1512, règne une véritable république. Trois groupes se partagent le pouvoir conformément au modèle vénitien: un Grand Conseil, un groupe d’aristocrates et un homme seul, le Gonfaloniere. En 1512 toutefois, une loi diminue le pouvoir du Grand Conseil. Après le changement de 1512, la nouvelle génération de penseurs, dont les plus éminents sont Guichardin et Machiavel, sait ce que c’est qu’une république, à l’inverse de leurs prédécesseurs pour qui celle-ci n’a jamais été qu’un mythe alimenté par le modèle vénitien.
Il convient de s’arrêter sur les pensées de Guichardin et de Machiavel. Les deux hommes fournissent deux conceptions alternatives de la république, toutes deux élaborées et complexes, qui constitueront des outils féconds pour la pensée républicaine anglo-saxonne que Pocock étudie en troisième partie. Le problème de Guichardin et de Machiavel est commun : sous la menace permanente d’un changement dans l’histoire dont ceux qui connaissent la politique sont de plus en plus conscients, de quel régime le gouvernement doit-il être doté pour rester stable ? Aussi s’éloigne-t-on de la recherche absolue du meilleur régime telle qu’elle avait été entreprise par Aristote. Guichardin était un optimate et, note Pocock, comme tous les optimates, il se trouvait dans une position ambiguë à l’égard de Laurent de Médicis. Les optimates l’admiraient et craignaient à la fois que ce dernier les traitent en serviteurs de leurs intérêts. Les opimates ne savaient pas très bien s’il fallait saluer la mesure de 1512 réduisant l’accès au Grand Conseil et se résoudre, par là, à n’être que les serviteurs de Laurent de Médicis dans cette entreprise anti-républicaine ou agir pour un retour à l’ancien Grand Conseil, au risque de susciter une hausse de popularité de Laurent de Médicis chez les citoyens et de perdre leur poids dans la constitution. La participation à la vie politique était dans tous les cas leur préoccupation. Sur ce sol d’intérêts communs à tous les optimates s’enracine une conception du pouvoir propre à Guichardin. C’est la dépendance à l’égard des intérêts particuliers des hommes qui menace le plus la république. Un citoyen n’est pas libre quand les intérêts privés d’un autre l’en empêchent. Guichardin en conclut que la poursuite d’un bien universel n’est possible que si les citoyens sont unis dans une participation égale au gouvernement. Plus précisément, les intérêts particuliers des magistrats doivent être assouvis sans interférer avec le gouvernement politique. Aussi, les fonctions électives doivent être dissociées des fonctions exécutives, ce qui signifie que l’attribution des magistratures ne doit pas être une prérogative de la souveraineté. En outre, le Grand Conseil doit être large et changer souvent de composition, de sorte que les affinités entre magistrats et membres du Conseil soient dissoutes dans l’anonymat d’une grande masse d’électeurs siégeant au Conseil à tour de rôle. Enfin, le petit nombre doit rechercher la gloire, mais une gloire politisée ayant intérêt à susciter l’adhésion des gouvernés. Ce qui caractérise le mieux la politique prônée par Guichardin est, davantage que l’ambition, la prudence aristotélicienne qui consiste ici à faire reposer l’action politique sur une attention permanente à la reconnaissance du régime par les citoyens. L’enjeu devient donc la seconde nature des individus. C’est cette seconde nature qui détermine la marge de manœuvre du gouvernant. Or, Guichardin et ses contemporains sont tous d’accord pour dire que la participation politique est bien enracinée dans les habitudes des citoyens. En tant qu’optimate, c’est surtout ce problème sociologique qui intéressait Guichardin. Il y avait toutefois une autre question que pouvait soulever le régime de Laurent le Magnifique : celui de l’innovation politique dans le contexte de la décision brutale de réduire la participation populaire. C’est Machiavel, parce qu’il était conseiller du prince, qui explora le plus profondément cet aspect.
Dans Le Prince, Machiavel s’emploie donc à l’élaboration d’une théorie de l’innovation et de ses conséquences. Le prince est engagé dans une sorte de fuite en avant. Il doit toujours agir et devancer ce que lui apporte le temps. S’il laisse le temps gouverner à sa place, il s’expose au seul changement possible : le renversement de son pouvoir. C’est dans ce cadre que prend sens l’opposition de la « virtu » et de la « fortuna ». La virtu est le pouvoir instinctif du prince à faire face aux circonstances. L’issue finale dépend de la manière dont le prince réagit aux conditions que la nécessité a engendré. On peut se demander pourquoi Pocock consacre au Prince un chapitre entier alors même que le point de vue du Prince est anti-républicain. Ce que Pocock entend nous présenter est la complexité et la richesse de l’opposition entre la virtu et la fortuna dans le Prince. Cette opposition est selon lui au cœur du « moment machiavélien » et de l’idée républicaine. Elle gagne d’ailleurs en épaisseur dans les écrits républicains de Machiavel. Comme ses contemporains, Machiavel fonde la possibilité du maintien de la république sur la « vertu civique ». L’homme est un « animal politique » et s’il exerce sa qualité vertueuse au sein de la cité, il poursuit le bien commun et évite le principal écueil, la corruption qui ronge la seconde nature de l’homme. L’originalité de Machiavel ne se situe pas là mais dans l’idée que la vertu civique se confond avec la vertu militaire. On retrouve là le lien étroit entre la « virtu » et la vertu civique. C’est précisément de cette volonté tenace de vaincre l’adversité, de cette « virtu » que le citoyen tient sa vertu civique. Si la vertu civique s’oppose davantage à la corruption qu’à la fortune, le couple « virtu »/ « fortuna » a un sens particulier dans l’esprit de Machiavel. Le destin de la « virtu » est de se manifester à l’extérieur et donc de s’exposer à la fortuna. Pocock écrit « Florence ne pouvait pas être une république si elle ne pouvait pas conquérir Pise ; mais les Pisans ne pouvaient pas être vertueux s’ils ne pouvaient pas l’arrêter ». Ainsi, rien ne peut arrêter la virtu dont le destin est de courir vers un affrontement qui la met en péril.
Il ressort de cette confrontation entre Guichardin et Machiavel deux conceptions profondes et opposées de l’idée républicaine. Pour tous deux, la fortune est un danger contre lequel il faut se prémunir. Mais, d’un côté, on ne peut y parvenir que par des voix constitutionnelles, dans un régime harmonieux. La vertu civique est alors considérée comme une seconde nature indéracinable. Nous avons vu qu’il importait pour tous ces florentins de connaître les conditions de la naissance d’une république. Il fallait que cette naissance soit atemporelle pour qu’indépendante de la fortune dès son commencement, la république puisse le rester pour l’éternité. Venise offrait, pour Guichardin et bien d’autres, le modèle d’une république née dans le calme de la vertu. De ce côté-ci, on peut voir apparaître un conservatisme qui prend Venise pour modèle. La république, peut-on penser alors, n’est pas un régime choisi pour ses qualités propres. C’est l’habitude que les citoyens en ont qui commande et rend souhaitable son maintien. Mais il existe une autre voie du républicanisme proprement machiavélienne. On ne vient à bout de la fortune qu’à l’aide d’un volontarisme instinctif. La vertu civique est alors le prolongement de la virtu. Cet instinct pousserait chaque citoyen à lutter pour la sauvegarde de sa république. Le modèle de Machiavel n’est pas Venise, mais Rome. Machiavel avait l’originalité par rapport à ses contemporains de concevoir qu’une république ait pu devenir telle grâce à la fortune. Cela tenait à sa notion de « virtu » qui n’excluait pas purement et simplement la fortune mais l’intégrait dans un mouvement dynamique. A l’opposé du conservatisme, un volontarisme républicain qui prend Rome pour modèle.
Pocock ne porte pas davantage attention à cette ligne de fracture au sein du républicanisme dans la suite de son livre. C’est qu’il essaie avant tout de dégager une unité de la pensée républicaine, de voir comment le « moment machiavélien », ce moment de la réflexion qui met aux prises la vertu et la fortune, apparaît sous des formes différentes selon le patrimoine lexical et sémantique des divers espaces et époques que Pocock évoque. C’est à la mise au jour du moment machiavélien dans le monde anglo-saxon que Pocock travaille dans la troisième partie.
La troisième partie s’ouvre sur la paradoxe d’une incompatibilité entre la pensée anglo-saxonne et la pensée républicaine qui permet à Pocock, par contraste, de réaffirmer la spécificité de la pensée républicaine. Il ne peut y avoir d’idées républicaines que là où il y a une « vita activa », un vivre-ensemble. Or, l’Angleterre avant la guerre civile dispose d’un vocabulaire qui l’empêche de penser le changement du monde par l’homme. Il manque à la triade « coutume, grâce, fortune », sol sur lequel le républicanisme avait pu croître, un élément décisif dans la possibilité d’une naissance de l’idée républicaine : la fortune et, par conséquent, la vertu. Cette absence s’explique, selon Pocock, par la configuration hiérarchique du pouvoir qui rend impossible la conscience d’une fortune dont les effets pourraient être contrecarrés par la vertu. Certes le peuple y existe comme intelligence, raison et expérience. Mais son champ d’existence politique se réduit à ses droits garantis par le pouvoir royal et intériorisés dans une seconde nature. La société anglaise peut être modélisée de la sorte : à sa base, le peuple constitue un « stalagmite d’intelligence » capable de s’élever jusqu’au « staglatite de l’autorité » lui assurant cohésion et rationalité. Dans ce système hiérarchique, il apparaît évident qu’il n’y a pas de place pour un partenariat entre des vertus civiques.
Ce système est perturbé par la guerre civile anglaise. En 1642, la Grande-Bretagne est déclarée « gouvernement mixte ». Elle est censée être un mélange de monarchie absolue, d’aristocratie et de démocratie. On repère les prémisses d’une pensée républicaine chez deux philosophes de cette période trouble. Philip Hunton, qui publie en 1643 un Traité de la monarchie, exprime la nécessité d’un appel au glaive. Pocock remarque que cette idée qui a pu faire penser à Locke ne doit pas être interprétée du point de vue libéral. L’appel au glaive de Hunton est lancé par une conscience individuelle, non, comme chez Locke, par un ensemble de consciences uni dans un désir rationnel de sécurité. Cette philosophie fortement influencée par la guerre est aussi loin des problématiques lockiennes que machiaveliennes. Hunton a le volontarisme de Machiavel mais pour lui, l’homme, dans ses combats pour la liberté, est livré à la volonté de Dieu. Enfin, l’appel au glaive est individuel, non pas collectif. C’est particulièrement intéressant pour le développement de Pocock car la philosophie de Hunton atteste d’une conscience politique irréductible à un corps de citoyens. On retrouve là un point de désaccord fondamental entre le républicanisme et le libéralisme juridique. Pour le second, l’individu n’est pas politique. Il est alors intéressant de constater que le naturalisme hobbesien nous apparaît seulement comme une des réponses possibles à la question, particulièrement préoccupante en ces temps de guerre civile, de la souveraineté du peuple. Bien plus, le libéralisme juridique est présenté par Pocock comme une voie parmi d’autres d’une prise de conscience plus large proprement républicaine. Le libéralisme serait logiquement et chronologiquement postérieur au républicanisme. Le moment de Hunton, caractérisé par l’appel de la conscience à Dieu, peut évoluer vers une soumission totale à la Providence divine telle que la conçoit John Wallace. Au contraire, la raison d’état, telle que Henry Parker, contemporain de Hunton, la voit, peut se muer sous la plume de Hobbes en naturalisme radical ne laissant là encore plus de place à la possibilité d’une conscience politique individuelle.
On remarque par ailleurs que la grâce est encore le fondement de l’action humaine que ce soit dans l’instinct de corps des hommes, en période de guerre civile, ou dans l’appel désespéré au glaive dont l’issue n’a de source que la volonté divine. C’est l’époque qui correspond à Savonarole à Florence. Une nouvelle étape vers le républicanisme est à franchir : l’idée d’un « vivere civile » et, par conséquent, d’un gouvernement mixte. C’est très précisément en 1677, après une période de conservatisme consécutive à la guerre civile, que cette idée tend à émerger à travers l’opposition de deux partis, « la Cour » et le « Pays ». La « Cour » est stigmatisé par la « Pays » comme le parti de la corruption. Le grand représentant du « Pays » est Harrington. C’est le véritable avènement du moment machiavélien, exprimé dans des termes qui sont propres à la Grande-Bretagne de la fin du 17ème siècle. Pour Harrington, la possession des armes est cruciale. Or, la liberté des armes est fondée sur la liberté de propriété, qui est elle-même le fondement de la personnalité politique. La corruption n’est pas comme chez Machiavel un défaut de vertu mais une mauvaise répartition de la propriété. On remarque que le vocabulaire et les idées républicaines ont évolué. La fortune tend à disparaître derrière la corruption. Les conditions de la vertu sont désormais explicables par un vocabulaire technique et économique. Cette tendance se confirme ensuite dans la tradition britannique et américaine.
Dans leur moment machiavélien les penseurs américains ont développé une nouvelle version de la théorie classique de la corruption qui était hostile au capitalisme. Des relations particulières entre le gouvernement, la guerre, la finance, les relations avec l’extérieur et l’empire naît une menace pour la liberté et la vertu. D’un point de vue constitutionnel, l’emprise républicaine est très visible. En fondant la république américaine, les Fédéralistes ont tenté de réconcilier le principe de la représentation et le paradigme de la vertu. Pour caractériser ce nouvel essor du moment machiavélien, Pocock parle d’un conflit entre la valeur qu’il faut à tout prix maintenir et l’histoire qui engendre la corruption. Alors qu’en Europe ce conflit a pris la forme d’une perception dialectique de l’histoire incarnée par Hegel et Marx, cela s’est manifesté aux Etats-Unis dans le mythe de la frontière qui s’est ensuite étendu à la conquête de l’Asie. De manière plus générale, Pocock affirme que la pensée politique américaine est déchirée entre la valeur et la pratique politique qui suppose une sophistication des rapports humains où peuvent se loger des facteurs de corruption.
Pour conclure l’exposé des principaux thèmes du Moment machiavélien, nous pouvons d’abord évoquer une remarque lumineuse dont Pocock nous fait part dans les dernières pages. Selon lui, « le conflit entre la vertu civique et le temps séculier est restée l’une des principales sources de la conscience occidentale de l’historicité ». De là, deux traditions s’opposent : la tradition républicaine et la tradition socialiste-révolutionnaire, chacune luttant contre la spécialisation. Mais cette dernière échoue puisqu’elle entend « forcer les hommes à être libres ». Au contraire, la tradition républicaine rejette l’activisme. Elle n’accepte pas, faut-il penser que la liberté et la vertu soient retrouvées au prix d’avoir été d’abord sacrifiées. Dans ce tableau, on peut regretter que la tradition libérale soit stigmatisée et un peu négligée par Pocock, réduite à l’idée de spécialisation corruptrice.
Enfin, on peut reconnaître que Pocock s’efforce de tracer une histoire objective du républicanisme. Il ne défend pas les thèses républicaines mais entend écrire une histoire de l’idée républicaine qui veut faire pendant à une histoire libérale qui monopolise la recherche historique. N’y a-t-il pas toutefois dans l’exposé de Pocock une tendance à lire l’histoire à la lumière de ses convictions républicaines ?