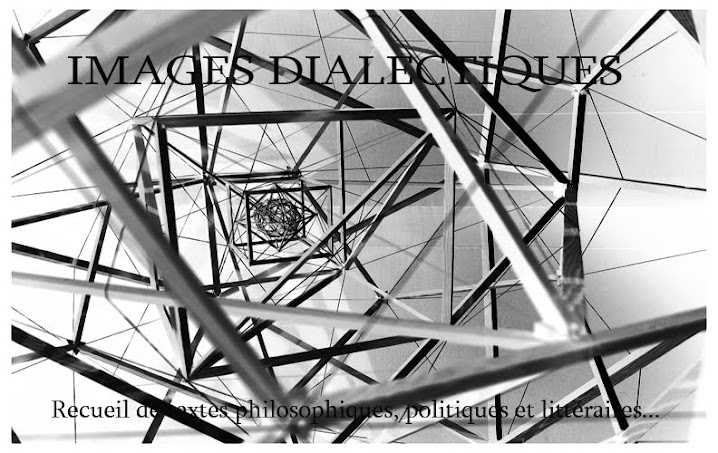Autorité
par Katia GENEL
Le terme d’autorité date du début du XIIe siècle. Il est emprunté au latin classique auctoritas, dérivé de auctor, qui provient du verbe augere (« augmenter ») et signifie « celui qui accroît ». Auctor a donné le terme auteur, mais désigne aussi le fondateur, le conseiller ou encore le garant (Rey, 2005). Au sens le plus général, l’autorité désigne une certaine puissance, une supériorité par laquelle on se fait respecter sans recourir à la contrainte ni à la persuasion ; c’est également le crédit accordé à un texte ou à un écrivain. Au plan institutionnel comme au plan énonciatif, elle est ce « surcroît », indiqué par son étymologie, qui permet d’obtenir l’obéissance volontaire ou l’adhésion de l’esprit. L’autorité est une notion très vaste, qui couvre différents domaines « pré-politiques » (l’éducation ou la famille) et politiques. Elle concerne des personnes ou des institutions (autorité d’un père, d’un professeur, d’un prince, d’un auteur, de l’Église), mais peut être entendue en un sens plus large : on parle de l’autorité de la loi, de la chose jugée, des Écritures ou encore de la raison. Enfin, l’autorité suscite l’adhésion en toute liberté, mais elle peut être asservissante ou libératrice, usurpée ou mise au service des autres. On ne peut déterminer facilement si l’obéissance ou la croyance qu’elle suscite sont dues à la reconnaissance de la légitimité du pouvoir ou du discours, ou si elles sont extorquées sans violence – ce qui pose le difficile problème des formes idéologiques de l’autorité. On s’interrogera notamment sur les transformations de l’autorité dans la modernité, qui ont pu conduire à parler de crise.
1. La spécificité de la notion d’autorité
Auctoritas et potestas
La place spécifique de l’autorité, notamment par rapport au pouvoir, est manifeste dès la source latine de la notion : l’auctoritas est usuellement distinguée de la potestas. Selon la célèbre formule de Cicéron, « cum potestas in populo, auctoritas in senatus sit », le pouvoir est dans le peuple, l’autorité réside dans le Sénat (Cicéron, 2003). Le Sénat a par conséquent une puissance de conseil et non d’action. Le récit de Tite-Live (Grimal, 2002) indique qu’après la mort de Romulus, premier roi de Rome qui tenait les pouvoirs du fait même de la fondation (par conséquent des dieux eux-mêmes), s’est ensuivi une discussion sur l’instance qui pouvait dès lors choisir le roi. Il fut convenu que le roi serait nommé par le peuple et que cette nomination serait ratifiée par le Sénat. Selon le commentaire de Grimal : « Ce compromis est de grande conséquence : en fait, l’apparente générosité du Sénat conférait aux Pères le privilège d’accorder l’investiture au personnage désigné par le peuple – en d’autres termes, les Pères seraient les garants (auctores) de l’imperium royal ; le peuple devrait se borner à émettre un souhait. » (Grimal, 2002 : 112). Grimal relativise ce « mythe juridique » datant de la période où le Sénat avait acquis la prééminence dans l’État et désirait la justifier par des précédents, en rappelant le rôle bien plus important qu’avait pu avoir l’acclamation populaire. Reste qu’elle était considérée comme l’expression de la volonté des dieux, qui usaient de ce moyen pour faire connaître leur choix. La fonction constitutionnelle du Sénat, ce conseil permanent, était en pratique assimilable à beaucoup des prérogatives considérées comme relevant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans les États modernes. Le Sénat se prononçait sur les lois après leur vote par les assemblées populaires, mais l’ordre de la consultation fut ensuite renversé. Si légalement rien n’obligeait les magistrats à s’incliner, la coutume et même le bon sens les invitaient à suivre l’avis des sénateurs. Leur influence s’exerçait dans tous les domaines de la vie politique, dans les affaires intérieures et étrangères (conseil du Consul, relation aux ambassadeurs, maîtrise du budget).
La notion d’auctoritas est complexe et rassemble des « éléments fort divers » que la « mentalité moderne a quelque peine à rassembler en un seul concept » (Grimal, 2002 : 121). L’historien Dion Cassius souligne qu’on ne peut traduire le terme d’auctoritas par un terme unique qui lui serait équivalent dans la langue grecque. Il désigne une expérience proprement romaine – les Grecs utilisant plutôt le modèle de la domination, du commandement et de l’obéissance, même s’ils approchent l’autorité par le biais de la relation entre médecin et malade par exemple. L’auctoritas renvoie à l’efficace nécessaire à un commencement. Elle contient la double dimension, morale et religieuse, de la gravitas (le sérieux du sénateur) et de la religio de cette assemblée, qui permet de commencer une entreprise. Dans son article « Qu’est-ce que l’autorité ? », Arendt (1989) précise que ce trait de l’autorité (le fait de renvoyer au fondement et au conseil plutôt qu’au commandement) introduit un rapport au passé, dans lequel l’autorité est solidaire de la tradition et de la religion : les précédents, les actions des ancêtres ou les coutumes sont liantes et exemplaires. La vie politique romaine tire sa force d’une tradition liée elle-même au commencement, à la fondation de la ville de Rome (comme l’indique la formule canonique « ab urbe condita », qui évalue le temps en fonction de cette fondation). Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut conserver la fondation.
Si le modèle de l’autorité est l’expérience politique romaine, l’Église catholique constitue un prolongement de ce modèle : par la référence du pape Gélase (Ve siècle) à l’auctoritas spirituelle du prêtre, par rapport à la potestas temporelle du roi ou de l’empereur, l’Église s’approprie le rôle directeur du Sénat, et confie le souci de l’ici-bas au pouvoir temporel. Hannah Arendt mentionne en outre deux exemples d’expériences politiques qui correspondent selon elle à l’autorité, car le concept de fondation y est central : un penseur politique, Machiavel, et un type d’événement, les révolutions (notamment la Révolution américaine). Machiavel crut possible de répéter l’expérience romaine par la fondation d’une Italie unifiée. Il a pu être considéré comme l’ancêtre des révolutions, qui sont moins des ruptures radicales que des événements où les actions des hommes tirent leur vigueur des origines de la tradition, des « tentatives gigantesques » pour réparer les fondations et renouer le fil rompu de la tradition. Selon Mommsen, l’autorité est « plus qu’un conseil et moins qu’un ordre ». Elle est cette étrange « puissance nulle » (expression empruntée par Arendt à Montesquieu), distincte du pouvoir et qui lui donne son poids.
Autorité, pouvoir et domination
L’autorité est souvent rapprochée de la domination, qu’on ne distingue pas toujours clairement du pouvoir. Lorsque Hannah Arendt les distingue (et s’efforce de penser le pouvoir en dehors de la domination), elle s’oppose à toute une tradition de penseurs, et en particulier à Max Weber. La domination est une structure de commandement et d’obéissance, qui implique des gouvernants et des gouvernés. Le pouvoir est au contraire une structure plus abstraite et plus impersonnelle. Selon Weber, la domination est la « chance qu’a un ordre d’être obéi » (Weber, 2003). Elle est un cas spécifique du pouvoir, qui prend la forme du commandement. Weber distingue trois formes de domination, qui ne sont pas des moments historiques : la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination rationnelle-légale. Il propose une description de l’organisation et du fonctionnement du pouvoir, en distinguant les formes de pouvoir selon les mécanismes qu’elles mettent en œuvre pour obtenir l’obéissance. L’autorité est un mode de légitimation de la puissance (Macht), par la tradition, par le chef ou par la loi. Elle n’est pas identique à la domination, ni même l’un des types de domination ; elle désigne plutôt une dimension interne à la domination, celle de la validité objective de l’ordre, qui dépend du sens subjectif qui lui est donné par les acteurs qui le reconnaissent comme légitime.
De son côté, Hannah Arendt s’efforce de comprendre le pouvoir en dehors de la relation de domination, c’est-à-dire du commandement d’un homme sur un autre, de la subordination d’une volonté à une autre. Le pouvoir est selon elle « l’aptitude des hommes à agir, et à agir de façon concertée » (Arendt, 1972). Il repose sur le consentement du peuple, selon le modèle des conseils ouvriers par exemple ; les règles y sont acceptées et non imposées. Il diffère en ce sens de la domination (comme de la violence, qui ne peut « que le détruire », mais est incapable de le créer) : loin d’être une forme extrême prise par le pouvoir, la domination signale son échec. Le pouvoir n’est ni instrumental ni hiérarchique.
L’autorité n’est pas de l’ordre de la domination : la relation entre auctores et artificies ne recoupe pas la relation de domination entre un exécuteur et un donneur d’ordres. C’est la fragilité du pouvoir qui conduit à l’autorité. Elle apparaît comme un surcroît dont le pouvoir a besoin ; elle joue le rôle de fondation qui doit augmenter le pouvoir, lui donner la légitimation et la solidité qui lui sont nécessaires, dans la mesure où le consentement instaurateur du vivre ensemble est toujours à refaire (Ricœur, 2004).
Contrainte, force et violence
L’absence de contrainte, et particulièrement de violence et de force, est l’élément distinctif de l’autorité, par rapport aux autres notions de la constellation du pouvoir et de la domination. L’autorité entraîne à l’action ou à la croyance en sollicitant la liberté de la volonté. La force (cette puissance détenue et extériorisée) et plus encore la violence (le fait de déchaîner sa force et de faire du mal) fonctionnent par contrainte, en faisant agir les individus sous la menace, contre leur volonté. L’autorité est au contraire du côté de l’obligation (au sens de se lier soi-même) plutôt que de la contrainte. Elle se différencie des autres formes d’imposition par la dimension de reconnaissance d’une certaine légitimité ou supériorité. Toutefois, l’absence de violence directe ne garantit pas la légitimité de l’autorité, ni l’exercice effectif de la liberté, comme le montre la notion de « violence symbolique », indistinction de la contrainte et du consentement, que Bourdieu définit dans le champ scolaire à l’aide de la notion d’autorité (Bourdieu et Passeron, 2005). Ainsi, le rapport de l’autorité à la contrainte, et plus particulièrement à la force, s’avère ambigu. Si Hannah Arendt considère que l’autorité exclut la contrainte, toute une tradition de philosophie politique s’attache au contraire à penser la complexe articulation entre autorité et force. L’autorité, issue d’une force créatrice, continuerait d’être opérante parce qu’elle serait conservée par cette force, ou qu’elle contiendrait la possibilité du recours à la force. Tel est le sens du terme d’autorité employé au pluriel, qui renvoie au pouvoir en place. L’autorité est bien une force convertie en justice : elle a un « fondement mystique », selon la formule que Pascal reprend à Montaigne, et « qui la ramène à son principe l’anéantit » (Pascal, 2004). Selon Pascal, l’autorité, issue d’un coup de force et de la transformation de la force en droit qui s’accomplit par la croyance et l’imagination, n’a qu’une puissance d’établissement. Elle est attestée et entretenue par les signes extérieurs du pouvoir et les marques de respects. Elle est donc confirmée dans sa légitimité par ses effets, alors qu’elle n’est que relative et contingente. On peut considérer l’ouvrage de Jacques Derrida, Force de loi, sous-titré « Le fondement mystique de l’autorité » (Derrida, 1994), comme un prolongement de cette réflexion sur la violence à l’œuvre dans la justice.
Autorité et souveraineté
La force inhérente à l’autorité vient au jour quand on rapproche la notion d’autorité de celle de souveraineté. La souveraineté est la détention légitime du pouvoir ; elle est liée à l’autorité, car il faut un principe au nom duquel le pouvoir est autorisé à commander. La souveraineté distingue l’État des autres pouvoirs de commandement. Selon Weber, l’État est « un rapport de domination que des hommes exercent sur d’autres en utilisant le moyen de la violence légitime (c’est-à-dire considérée comme légitime) », sa spécificité est de détenir le « monopole de la violence légitime ». La souveraineté correspond donc à la maîtrise du droit positif : l’État est souverain en ce qu’il détient la légalité (c’est ainsi qu’il faut entendre la référence au caractère légitime), c’est-à-dire qu’il a la capacité de prescrire des actes de contrainte. La violence d’État a par conséquent un caractère juridique, c’est son trait distinctif. Le droit n’est pas l’opposé de la violence, mais il la met en forme : le droit est pour Weber l’organisation institutionnelle d’une violence monopolisée, et ce processus caractérise la formation de l’État moderne. On a pu constater l’ambiguïté de l’autorité dans son rapport à la violence et à la force : l’autorité correspond d’un côté au fondement légitime du pouvoir, mais elle rejoint de l’autre la notion de souveraineté comme puissance effective susceptible d’employer la force.
2. Le mystérieux fondement de l’autorité
L’autorité est portée par une personne (qui peut incarner une institution), mais ne saurait provenir de cette personne même, qu’il s’agisse d’un prophète, d’un chef de famille, d’un professeur, d’un psychanalyste ou d’un représentant de la loi. L’ascendant personnel, la vertu particulière ou l’aura énigmatique de ces personnes, ce « surcroît » qu’enveloppe la notion d’autorité renvoie à une source légitimante, antérieure ou transcendante, d’où les personnes ou les institutions tirent leur légitimité : un ordre spirituel, naturel ou historique. La référence disparaît sous le porteur, qui possède l’autorité comme s’il s’agissait d’une qualité personnelle : l’autorité se donne comme provenant directement, presque naturellement, du porteur qui l’incarne, au point qu’il semble s’autoriser de lui-même. Élucider le rapport circulaire sinon paradoxal entre le porteur de l’autorité et la source peut permettre de sortir des apories ouvertes lorsqu’on s’attache à la mystérieuse qualité qui fait l’autorité. Le paradoxe est le suivant : d’un côté, c’est bien un homme singulier qui fait autorité parce qu’il est tel homme ; mais il n’aurait pas d’autorité sans la source d’où il tire sa légitimité. C’est ce qu’exprime Kierkegaard dans son opuscule « Sur la différence entre un génie et un apôtre » (Kierkegaard, 1971). Le « génie » et l’« apôtre » se distinguent qualitativement. Le génie appartient à la sphère qualitative de l’immanence, il est ce qu’il est par lui-même. L’apôtre s’appuie sur une autorité transcendante en vertu de laquelle il est ce qu’il est. Il ne s’agit pas d’évaluer au point de vue philosophique la teneur de la doctrine, mais au contraire, de partir de l’autorité dont on est investi :
« Qu’est-ce donc que l’autorité ? Consiste-t-elle dans la profondeur de la doctrine, dans son excellence, sa richesse spirituelle ? Nullement. Si elle est ainsi simplement une seconde puissance ou une réduplication caractérisant la profondeur de la doctrine, il n’y a pas alors d’autorité ; si en effet un disciple comprend parfaitement la doctrine et se l’assimile, plus rien ne le distingue du maître. Mais l’autorité est chose immuable ; on ne peut l’acquérir par l’intelligence la plus complète de la doctrine. Elle est une qualité spécifique intervenant d’ailleurs et revendiquant la qualité, alors que le fond du discours ou de l’action est indifférent au point du vue esthétique. Prenons un exemple tout simple et cependant capable d’illustrer la question. Quand une personne investie de l’autorité dit à un homme : “Va !” et qu’une autre, sans autorité, dit : “Va !”, le mot exprimé (va !) et sa signification intrinsèque sont dans les deux cas identiques ; au point de vue esthétique, si l’on veut, il n’y a pas de différence, laquelle vient de l’autorité. Si l’autorité n’est pas l’autre chose (to hétéron), si elle désigne simplement une virtualité en puissance au sein de l’identité, il n’y a pas d’autorité. » (Kierkegaard, 1971 : 152-3).
La vérité ne dépend pas ici du contenu du discours, de sa signification universelle, mais de la personne qui le prononce. On ne saurait dès lors demander des preuves sans annuler l’autorité. L’autorité fonctionne de sorte que celui qui enseigne a une prééminence sur ce qu’il enseigne, comme dans le cas des paroles du Christ. Mais le porteur du message est aboli en tant que personne : il n’est qu’un représentant ou un apôtre. Tel est le paradoxe de l’autorité : on tient davantage compte du porteur que du contenu du message, mais le porteur ne possède l’autorité que dans la mesure où il se réduit à un coursier neutre (Zizek, 1993). Toute la difficulté est bien de comprendre de quelle manière se « porte » l’autorité, et de quelle manière elle se confère. Le lien entre le porteur et la source de l’autorité n’est pas concevable comme une représentation juridique (ce n’est pas la manière dont on fait valoir un droit), ni même comme une imputation, mais plutôt comme une attribution presque directe, de sorte que l’autorité présente un caractère d’évidence. De là provient la difficulté d’une critique de l’autorité, qui a pour tâche de montrer comment cette qualification qui semble directe repose sur un système d’attribution construit et inculqué. L’autorité résulte d’une hiérarchie et d’un système de soumission. Le cercle entre le porteur et la source est redoublé par un autre cercle, indiqué par Ricœur, entre l’exigence d’être reconnu et la reconnaissance donnée (Ricœur, 2001). L’autorité d’un ordre objectif dépend de l’adhésion subjective, selon un rapport de renforcement réciproque. Le principe d’autorité, voie d’accès à la vérité révélée, peut au contraire être un obstacle dans la recherche de la vérité rationnelle. L’hétéronomie que suppose l’autorité peut s’opposer à l’autonomie du jugement critique, lorsque la croyance et la foi, plutôt que la raison, sont premières. Celui qui incarne l’autorité peut inspirer des sentiments ou des passions qui engendrent un asservissement. Pour qu’une autorité soit établie comme légitime, il faut ainsi contrôler par la raison le contenu de ce qu’elle impose.
La difficulté est de déterminer la légitimité de l’autorité et de ce qu’elle impose. La soumission à une autorité peut, dans certaines situations, être aveugle et signifier la démission de l’esprit critique. C’est ce que montre Stanley Milgram à l’aide des expériences de psychologie sociale qu’il a réalisées entre 1960 et 1963. Le sujet, venu participer à une expérience sur l’effet de la sanction sur l’apprentissage, se trouve être en réalité l’objet de l’expérience. On mesure jusqu’à quel point un individu peut participer de son plein gré à des actes cruels sur des innocents (administrer ce qu’il croit être des décharges électriques), c’est-à-dire à quel point il peut se plier aux ordres d’une autorité reconnue sans contrainte, quand ces ordres sont en contradiction avec les exigences de sa conscience. Dans les premières expériences, 62,5% des sujets (25 sur 40) menèrent l’expérience à terme en infligeant à trois reprises les électrochocs de 450 volts. L’autorité est, plutôt que l’ordre, le facteur décisif. Lorsqu’il entre dans un système hiérarchique, le sujet tend à abandonner son autonomie et le contrôle de ses actes par sa conscience ; il adopte un « état agentique » dans lequel il renonce à sa responsabilité personnelle et attribue l’initiative de ses actes à la volonté d’autrui. On retrouve notamment dans la bureaucratie ces situations d’obéissance dans lesquelles les sujets croient être couverts par l’autorité et ne se sentent pas responsables.
3. Autorité et modernité
Si l’autorité désigne une relation dissymétrique et s’oppose à l’isonomia qui définit la démocratie, se pose d’emblée la question de sa persistance dans la modernité démocratique. Par sa structure hiérarchique, mais aussi par la référence qu’elle contient à la tradition et à la fondation d’où elle tire sa légitimité, l’autorité était vouée à se transformer, voire à entrer en crise dans la modernité. Les fondements de la croyance en l’autorité sont remis en cause dans la modernité, dans l’ordre politique comme dans l’ordre du savoir – ces deux dimensions concernant l’une comme l’autre la philosophie politique. Selon Leclerc, le concept sociologique d’autorité institutionnelle aurait récemment remplacé le concept philosophique d’autorité énonciative (Leclerc, 1986). Ricœur reprend cette même distinction (qu’il considère comme pédagogique, tant les deux types d’autorité sont liés), en montrant qu’il n’y a pas véritablement remplacement de l’autorité énonciative par l’autorité institutionnelle, mais plutôt la succession de deux configurations du couple énonciatif/institutionnel : celle de la chrétienté médiévale et celle des Lumières françaises (Ricœur, 2001). Dans l’ordre du savoir, l’avènement de la modernité s’accompagne d’une critique virulente du mode d’accès dogmatique à la vérité qu’enveloppe l’autorité, à quoi l’on oppose la puissance du sujet capable de trouver par lui-même la vérité, selon le modèle du cogito cartésien. Si, chez Pascal, c’est seulement dans les matières rationnelles que « la raison seule a lieu d’en connaître » (Pascal, 1993), le mouvement des Lumières radicalise la critique de l’autorité en s’appuyant sur l’autonomie de la raison : on peut citer l’article « Autorité » de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (Diderot et D’Alembert, 1999) ; ainsi que la critique du préjugé de l’autorité de la personne et du grand nombre dans la Logique de Kant (Kant, 1989). L’émancipation politique est solidaire de l’émancipation intellectuelle. On peut dire en termes kantiens que la liberté de penser est la condition de la sortie hors de la minorité.
Autorité et contrat
L’examen des théories du pacte social, et notamment celle de Rousseau, peuvent nous permettre de poser le problème de la persistance et de la modification de l’autorité dans la modernité démocratique. Le contrat est une tentative pour évacuer l’autorité au sens négatif et fonder une véritable autorité politique sur le consentement des sujets réunis en peuple. Si le pacte social hobbesien est un pacte de soumission dans lequel les individus se dessaisissent ensemble de leur droit à se gouverner eux-mêmes et le transfèrent au souverain (qu’ils « autorisent » à endosser leurs droits), le pacte social de Rousseau est un pacte d’association, par lequel le corps politique s’auto-institue. Les citoyens s’engagent envers le corps politique dont ils sont les « parties indivisibles » et aliènent tous leurs droits à la communauté. Dans ce cadre, l’autorité fait l’objet d’un consentement volontaire, et permet donc la vraie liberté, au sens de l’autonomie (c’est-à-dire l’obéissance à la loi que l’on s’est prescrite). La constitution du corps politique témoigne toutefois d’un élément excédant le contrat, et indiquant la persistance de l’autorité : « l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres » (Rousseau, 2001). Le corps collectif créé par le contrat (par l’union des particuliers) excède le consentement des parties. Le contrat est donc irréductible à un acte juridique, il a une dimension métapolitique voire métaphysique (Revault d’Allonnes, 2006). Le recours à la figure du Législateur (Rousseau, 2001, op. cit. : II, 7) confirme la persistance de l’autorité. En effet, le législateur ne détient pas le pouvoir législatif, il est un « homme extraordinaire dans l’État », qui donne un poids aux lois, puisqu’il « faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes » :
« Le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre ».
Enfin, on peut voir dans la religion civile, dont le souverain fixe les articles de foi, une autre forme de ce qui excède le contrat comme association des volontés (Rousseau, Ibid. : IV, 8). L’autorité ne se résorbe donc pas dans l’égalité et le contrat. Qu’elle soit en quelque sorte fabriquée ou simplement rappelée, l’autorité est ce qui donne légitimité au pouvoir, et la question de savoir d’où vient la légitimité du pouvoir continue de se poser.
Peut-on se passer de l’autorité ?
La position anarchiste de M. Bakounine est une critique de l’autorité, considérée comme une entrave à la liberté (Bakounine, 2000). C’est à elle que répond notamment Engels dans l’opuscule Sur l’autorité (Engels, 1973). Il y définit l’autorité comme l’imposition de la « volonté d’un autre sur la nôtre », en la liant à la subordination, mais refuse de la considérer comme absolument mauvaise. La question est de savoir si, comme le souhaitent les anarchistes, on peut se passer de cette relation d’autorité et de subordination, dans les conditions économiques et industrielles de la société actuelle. Engels reproche à l’anarchisme de ne pas voir la nécessité de l’autorité au sens d’un principe d’organisation, lorsque les actions des individus deviennent complexes et liées aux machines. Le nœud du problème est l’avènement de la révolution, qui requiert l’autorité. Engels maintient donc l’idée qu’une révolution est nécessairement autoritaire, contre les anti-autoritaristes qui voudraient détruire l’État tout d’un coup, sans détruire les conditions sociales qui lui ont donné naissance. Les anti-autoritaristes devraient selon lui se borner à s’élever contre l’autorité politique de l’État (dont les socialistes veulent transformer les fonctions en simples fonctions administratives de surveillance des intérêts véritables de la société). Le problème de l’administration et de son devenir autoritaire est l’un des problèmes dont a hérité l’École de Francfort.
4. Transformations et crise de l’autorité
La crise de l’autorité est à la fois une situation historique et à la fois inhérente au phénomène même d’autorité, ambivalence que contient la notion de modernité elle-même. Selon la manière de penser la crise de l’autorité, se révèle la structure de l’autorité – structure fondamentalement violente, transformatrice ou canalisatrice de cette violence, ou structure radicalement hétérogène à la violence. On peut envisager plusieurs diagnostics de cette crise.
Une crise constitutive de l’autorité
Tout d’abord, si l’on suit les analyses de Freud qui analyse l’autorité au sein de la culture, le malaise est bel et bien inhérent à la vie sociale. En effet, celle-ci est issue de tendances à l’union et à la désunion, c’est-à-dire de l’inhibition des pulsions érotiques et de leur détournement vers d’autres buts, ainsi que de l’acceptation de ce renoncement pulsionnel. L’autorité est cette instance qui permet d’imposer le sacrifice des pulsions, voire de le faire accepter. Freud pense l’autorité à partir du principe de destruction, originairement tourné vers le monde extérieur : le surmoi individuel ou collectif, issu de l’introjection de ce principe, donc du retournement des pulsions agressives, est ce qui constitue la subjectivité (Macherey, 2005). Avec Pierre Macherey, suivant Judith Butler, on peut définir l’autorité sociale non comme l’intériorisation du pouvoir, mais comme la « vie psychique du pouvoir », le point d’articulation des normes sociales et des sujets, qui constituent les sujets et fait vivre les normes. En ce sens, le problème de l’autorité se pose du fait même de la vie en société.
L’autorité impersonnelle
Dans la même voie d’une crise de l’autorité en quelque sorte inhérente au phénomène, et révélatrice de la structure foncièrement ambivalente de l’autorité et de son lien à la violence, on peut examiner les travaux de l’École de Francfort. À partir des analyses de Marx sur le fétichisme de la marchandise, de celles de Lukacs sur la réification, et de celles de Weber sur la rationalisation et la domination, l’École de Francfort a développé sa réflexion sur le devenir impersonnel de l’autorité. Schématiquement, le questionnement sur l’autorité se concentre sur la manière dont celle-ci a changé depuis l’avènement de la modernité et la rupture des liens féodaux. Loin d’avoir disparu, elle a continué d’organiser la production pendant la période libérale, mais les progrès qu’elle a rendus possibles se sont renversés en une aliénation accrue. La dialectique de l’autorité est la suivante : la raison, qui a permis de contester l’autorité, a engendré une nouvelle forme d’autorité. L’autorité est devenue de manière croissante autorité des « faits » (Horkheimer, 1936), c’est-à-dire autorité de la situation socio-économique et notamment du marché considéré comme une donnée naturelle. L’autorité prendrait la forme d’une adaptation aux circonstances et d’une conformité à la réalité. La situation du travail et de la production n’étant pas le fruit d’une organisation réfléchie, elle se présente sous la forme de circonstances extérieures ou de « puissances objectives » qui font l’objet d’une reconnaissance factuelle, et non d’une prise en compte par une volonté qui viserait à les transformer. Ainsi, c’est paradoxalement en usant de leur liberté et de leur rationalité que les individus se soumettent à des rapports sociaux de domination qui les aliènent. L’accent est mis non pas sur l’individu qui détiendrait une autorité ou l’imposerait, mais sur l’ordre objectif et sa structure de domination, qui conduit à une socialisation de plus en plus impersonnelle. Les analyses de l’École de Francfort sur l’autorité combinent une théorie de la société d’inspiration marxienne avec les acquis de la psychanalyse, et pensent l’assujettissement des hommes en termes de « caractère autoritaire », saisissant l’autorité du côté de l’identification freudienne (Adorno, 2007). Cela permet notamment d’étudier le totalitarisme à l’aide de la psychologie des foules qui éclaire les mécanismes de soumission collective à un guide. Le surmoi collectif, qui exerce une autorité impersonnelle, peut s’incarner dans un meneur, point d’identification des individus.
Autorité et liberté
Hannah Arendt appréhende de son côté la crise de l’autorité, de l’éducation et plus généralement de la culture, dans le cadre d’une réflexion sur la crise de la modernité. La disparition généralisée de la croyance, au sens de la foi en des états futurs, qui inclut la religion et la tradition (« la religion, et surtout la peur de l’enfer, a été éliminée de la sphère publique ») est la marque spécifique du présent. Selon Arendt, la crise de l’autorité (si l’on comprend l’autorité comme « responsabilité à l’égard du monde », Arendt, 1989), est une perte de la « permanence du monde », qui empêche les hommes de préserver et transmettre un monde « qui puisse demeurer vivable pour les générations qui suivent ». La spécificité de son diagnostic est de lier le constat d’une confusion théorique avec la confusion des expériences, engendrant une mécompréhension du politique et de l’histoire. La confusion qu’il faut éviter selon Arendt est celle entre l’autoritarisme, la tyrannie et le totalitarisme ; elle est sous-tendue par une assimilation de l’autorité à la tyrannie, et du pouvoir légitime à la violence. Cette assimilation empêche notamment de saisir la spécificité de la domination totalitaire – qui ne consiste aucunement pour Arendt en un surcroît d’autorité. Elle est au contraire liée à l’« écroulement plus ou moins général, plus ou moins dramatique de toutes les autorités traditionnelles », atmosphère dont les organisations totalitaires ont su profiter. La source de l’autorité dans le gouvernement autoritaire est toujours une force extérieure et supérieure qui le fonde et en borne le pouvoir. Son trait distinctif est d’être lié par des lois et fondé sur elles plutôt que sur la volonté et l’intérêt propre du tyran. Si l’autoritarisme restreint la liberté, la domination totalitaire abolit jusqu’à la spontanéité. Ayant à l’esprit la question de la préservation de la liberté, Arendt propose trois modèles pour figurer la distinction entre les régimes autoritaires, tyranniques et totalitaires : le gouvernement autoritaire (par exemple le type chrétien de pouvoir autoritaire) correspond à une structure pyramidale, dont la source est en dehors de la structure gouvernementale. Chaque couche successive contient quelque autorité, et toutes les couches sont intégrées à l’ensemble et reliées entre elles. L’autoritarisme, qui incorpore l’inégalité et la distinction comme principe, est la forme la moins égalitaire de toutes. La tyrannie est représentée par une pyramide sans couches intermédiaires : le tyran est seul contre tous. Quant à l’organisation totalitaire, elle est figurée par « la structure de l’oignon dans le centre duquel, dans une sorte d’espace vide, se trouve le Chef ; quoi qu’il fasse, qu’il intègre le corps politique comme dans une hiérarchie autoritaire ou qu’il opprime ses sujets comme un tyran, il le fait du dedans, et non du dehors ou d’en haut » (Arendt, 2002 : 889). Le problème posé par les confusions théoriques se double d’une appréhension problématique de l’histoire. L’assimilation entre autoritarisme, tyrannie et totalitarisme, repose sur une conception de l’histoire comme « processus » soustrait presque par définition à l’initiative des hommes (elle est ce « processus qui, apparemment, a besoin d’être libéré des activités encombrantes et importunes des hommes »).
Pour saisir la spécificité des régimes politiques, il faut au contraire déployer une pensée du politique qui s’oppose au fonctionnalisme, à l’œuvre dans l’assimilation de la violence et de l’autorité, selon l’illusion que l’autorité, en faisant obéir, remplirait la même fonction que la violence.
« Tous ceux qui appellent “autoritaires” les dictatures modernes ou qui prennent le totalitarisme pour une structure autoritaire donnent implicitement pour équivalentes la violence et l’autorité (y compris ceux des conservateurs qui expliquent l’avènement des dictatures dans notre siècle par le besoin de trouver un substitut à l’autorité). » (Arendt, 2002 : 894)
On aperçoit l’importance de la distinction entre autorité, violence et domination : opérer ces distinctions conceptuelles revient, selon Arendt, à prendre une décision sur la nature du politique et à garantir la possibilité de la liberté.
5. Prolongements contemporains : La pluralité de l’autorité
Dans des tentatives contemporaines, l’autorité est pensée dans sa pluralité, mais aussi dans sa positivité, au sens où elle n’est pas la puissance déterminante qui induit une reproduction des conduites et la perpétuation de l’ordre établi. La notion de justification, telle qu’elle est élaborée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot (Boltanski et Thévenot, 2003), nous permet de saisir une transformation de l’autorité : le lieu de la légitimité n’est pas une structure idéologique qui déterminerait les individus à leur insu de l’extérieur, mais dans la logique de justification des individus eux-mêmes. Cette logique fait appel à un ordre, une « cité » dans laquelle vaut un bien commun. L’autorité est donc à chercher dans la manière dont les individus se justifient c’est-à-dire s’autorisent à agir, mais elle n’est pas pour autant simplement individualisée : les cités permettent une référence à un bien commun.
Bibliographie
ADORNO, T. W., 2007 (1950). Études sur la personnalité autoritaire, traduit de l’anglais par H. Frappat, Paris : Allia.
ARENDT, H., 1989 (1961, révisée en 1968). « Qu’est-ce que l’autorité ? », in La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique, traduction dirigée par P. Levy, Paris : Gallimard.
ARENDT, H., 1972 (1970). Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, traduit de l’anglais par Guy Durand, Paris : Calmann-Lévy.
ARENDT, H., 2002 (1956). « Autorité, tyrannie et totalitarisme », in Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, édition établie sous la direction de Pierre Bouretz, Paris : Gallimard.
BAKOUNINE, M., 2000 (1882). Dieu et l’État, Paris : Mille et une nuits.
BENVENISTE, E., 1969. « Le censor et l’auctoritas », in Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2, Paris : Minuit.
BOLTANSKI, L. et THÉVENOT, L., 2003 (1991). De la justification. Les économies de la grandeur, Paris : Gallimard.
BOURDIEU, P. et PASSERON, J.-C., 2005 (1970). La reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris : Minuit.
CICÉRON, 2003. Traité des Lois (vers 52 av. J.C.), texte établi et traduit par G. de Plinval, Paris : Les Belles lettres.
DERRIDA, J., 1994. Force de loi. Le « fondement mystique de l’autorité », Paris : Galilée.
DIDEROT, D. et D’ALEMBERT, J., 1999 (1751-1772). Encyclopédie. Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Cédérom, Redon : Marsanne.
ENGELS, F., 1973 (1873). « Sur l’autorité » (Von der Autorität), Karl Marx/Friedrich Engels Werke, 18.
FREUD, S., 1998 (1929). Malaise dans la culture, traduit de l’allemand par P. Cotet, R. Lainé, Paris : PUF.
GRIMAL, P., 2002 (1960). La civilisation romaine, Paris : Champs Flammarion.
HOBBES, T., 2000 (1651). Léviathan ou Matière, Forme et Puissance de l’État Chrétien et Civil, traduit de l’anglais par Gérard Mairet, Paris : Gallimard.
HORKHEIMER, M. (dir.), 1936. Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris : Librairie Alcan.
KANT, I., 1989 (1800). Logique, traduction L. Guillermit, Paris : Vrin.
KIERKEGAARD, S., 1971 (1849). « Sur la différence entre un Génie et un Apôtre », in Œuvres complètes, vol. XVI, traduction par P.-H. Tisseau, Paris : éditions de L’Orante.
LECLERC, G., 1986. Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance, Paris : PUF.
MACHEREY, P., 2005. « Freud : la modernité entre Eros et Thanatos », Séminaire « La philosophie au sens large » du 12/10/2005, texte en ligne sur le site de l’UMR « Savoirs et textes »
MILGRAM, S., 1994 (1974). La soumission à l’autorité, Paris : Calmann-Lévy.
PASCAL, B., 2004 (1670, posthume). Les pensées, Paris : Gallimard.
PASCAL, B., 1993 (1647). « Préface au Traité du vide », in De l’esprit géométrique. Écrits sur la grâce et autres textes, Paris : GF.
REVAULT-D’ALLONNES, M., 2006. Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, Paris : Seuil.
REY, A. (dir.), 2005. Le dictionnaire culturel en langue française, Le Robert.
RICOEUR, P., 2004 (1989). « Pouvoir et violence », in Politique et pensée. Colloque Hannah Arendt, Paris : Payot.
RICOEUR, P., 2001. « Le paradoxe de l’autorité », in Le Juste 2, Paris : éditions Esprit.
ROUSSEAU, J.-J., 2001 (1762). Du contrat social, Paris : GF.
WEBER, M., 2003 (1921, posthume). Économie et société, 1, « Les catégories de la sociologie », traduction sous la direction de Jacques Chavy et d’Eric de Dampierre, Paris : Plon-Press Pocket.
ZIZEK, S., 1993. L’intraitable. Psychanalyse, politique et culture de masse, traduit de l’anglais par Elisabeth Doisneau, Paris : Anthropos.
Liens : Anarchie – Arendt - Autoritarisme – Boltanski - Domination – École de Francfort - Freud - Kierkegaard - Justice – Pascal - Pouvoir - Reconnaissance - Rousseau - Souveraineté – Totalitarisme – Tradition – Tyrannie – Violence - Weber
Comment citer cet article :
Genel, Katia (2007), « Autorité », in V. Bourdeau et R. Merrill (dir.), DicoPo, Dictionnaire de théorie politique.
http://www.dicopo.org/spip.php ?article50
| Date de publication : | Mercredi le 20 juin 2007 à 15:40 |
| Dernière modification substantielle : | Mercredi le 20 juin 2007 à 15:42 |
| Dernière modification : | Mardi le 7 octobre 2008 à 09:33 |