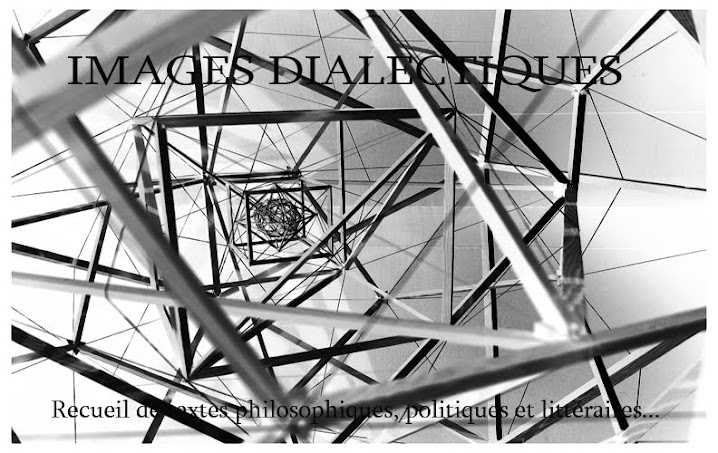Faut-il (encore) s’inquiéter — de l’art ?
Cet article paraîtra, d’ici quelques mois, dans les actes d’un colloque qui était consacré aux « Mutations et adaptations au XXe siècle ». Je me permets de le mettre en ligne en attendant qu’il soit disponible. Je n’ai évidemment pas touché à la moindre virgule, par rapport au texte tel qu’il sera publié, et cela, même si dans l’après-coup, j’aurais souhaité arrondir quelques angles. Deux choses en particulier, que j’indique ici en quelques mots : 1) l’ensemble de mon propos est très critique, pour ne pas dire sévère, avec l’Occident, mais bien que je ne le précise pas suffisamment, il ne s’agit surtout pas de verser bêtement et simplement dans une critique (au plus mauvais sens du terme) de cet Occident, ou même simplement des Lumières, de l’Aufklärung, etc. Au moment même où le plus haut représentant de l’État se permet les attaques pitoyables que l’on sait à l’encontre de l’héritage des Lumières (laïcité, etc.), au moment plus généralement où la religion continue de servir de prétexte aux pires déchaînements des passions humaines à travers le monde, il faut évidemment rappeler combien les noms de Diderot, Rousseau, Voltaire, et bien d’autres, nous demeurent importants. Et rappeler que, toute problématique qu’elle puisse être, nous ne sommes pas prêts à renoncer à la raison. 2) À un moment, par une maladresse de formulation, je semble rejeter d’un même geste l’esthétisation de la politique que pratique le fascisme et la politisation de l’art par quoi entendent y répondre Benjamin et Brecht vers 1935. Bien entendu, même si l’option de Benjamin et Brecht continue de me sembler problématique (et Benjamin lui-même semble très bien le percevoir à partir de 1938), je ne voulais surtout pas donner à croire que l’on pouvait mettre sur le même plan ces deux choses absolument hétérogènes, quand bien même elles procèderaient toutes deux d’une même (mauvaise) articulation entre art, philosophie et politique, qu’un peu plus loin dans le texte j’appelle à désarticuler (à la suite de Lacoue-Labarthe, et, précisément, de Benjamin).
Faut-il (encore) s’inquiéter de l’art ?
Faut-il s’inquiéter de l’art ?
Ou peut-être plutôt : faut-il encore s’inquiéter de l’art ?
La question peut s’entendre en plusieurs sens, qui sont ceux du verbe « s’inquiéter » :
1. Tout d’abord, on ne peut que commencer par là : faut-il s’occuper de, ou s’intéresser à l’art, faut-il s’occuper de la question de l’art ? Cette question est-elle, en soi, importante, déterminante, essentielle ? L’est-elle encore, aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle ? Ou bien est-ce devenu une vieillerie : une question démodée, inactuelle ?
2. En un sens un peu plus précis, on peut entendre également : faut-il prendre des nouvelles de l’art, s’enquérir de sa santé ? S’enquérir de sa santé aujourd’hui : qu’est-il devenu ? C’est-à-dire, à la fois : qu’est devenu, aujourd’hui, l’art du passé et l’art d’aujourd’hui ?
3. De là, on ne peut que dériver vers : faut-il s’inquiéter pour l’art ? Savoir s’il va bien, ou mal ? Et savoir si c’est grave, inquiétant s’il va mal ? Ou, en retournant la question, faut-il encore s’inquiéter pour l’art : depuis le temps que l’on proclame sa mort, ne doit-on pas arrêter de s’en faire ?
4. Mais on ne peut pas ne pas entendre aussi, dans la question : faut-il s’inquiéter, se sentir menacé de ceci qu’il y a (de) l’art, du fait même qu’il y a (de) l’art ? N’y a-t-il pas dans l’art — ou bien est-ce seulement dans l’art (d’)aujourd’hui ? —, quelque chose qui ne tient pas en place, qui ne cesse d’être en mouvement, qui s’agite — puisque c’est aussi un des sens de l’« inquiétude » —, et qui de ce fait nous trouble dans notre quiétude, voire peut-être qui la (qui nous) menace ?
5. Et de là nécessairement se trouverait posée la question (mais c’est aussi la même que la première) : faut-il « s’occuper de » l’art, dans le sens de : lui « régler son compte » (et pourquoi pas, tant qu’on y est : une bonne fois pour toutes...) ?
Je voudrais laisser résonner ces différents sens, ces différentes questions qui n’en forment qu’une : si elles sous-tendent constamment, et toutes en même temps, l’ensemble de ce qui suit, je ne vais pas pour autant les aborder d’emblée, de front, sans autre préalable. Cette question, ces questions, je ne les crois dignes d’être posées que dans l’unique mesure où elles résonnent nécessairement, comme je vais essayer de le montrer, sous une autre qui, pour le coup, est bien plus manifestement un motif d’inquiétude. Ou bien, c’est ici strictement équivalent : dans l’unique mesure où, sous elles, résonne cette autre question.
—
Cette autre question, ce n’est pas uniquement une de celles que nous a léguées le siècle tout juste écoulé : je crois que c’est, ni plus ni moins, la question du XXe siècle, celle qui, d’une façon ou d’une autre, les contient toutes — ce qui ne dit en rien qu’elle les résume. J’entends par là : la question des totalitarismes, qui dans sa forme la plus grave n’est autre que la question de l’extermination, la question d’Auschwitz — au sens de ce mot où l’a entendu Theodor W. Adorno, et quelques autres à sa suite, c’est-à-dire : « tout ce dont Auschwitz doit rester et l’irremplaçable métonymie et l’unique nom propre » (Derrida).
(Il ne s’agit pas, bien évidemment, de prétendre qu’il ne s’est rien passé d’autre, rien d’important, rien d’essentiel, au XXe siècle : bien au contraire. Mais on pourrait montrer précisément que toutes les questions importantes qu’a posées ce siècle peuvent être interrogées depuis le lieu — de ce fait même sans lieu — de sa catastrophe. Et donc qu’en un sens elles doivent l’être — quand bien même ce ne serait pas aussi explicite, quand bien même on aborderait les choses moins frontalement que je ne le fais ici.)
Je suis obligé de m’arrêter un peu ici, et de donner quelques explications, ou bien l’on n’y comprend rien — et l’on court alors le risque (qui, s’agissant de cela, est inadmissible) de toutes les équivoques. Je me bornerai à relever deux aspects, qui me semblent importants (voire essentiels) dans l’analyse [1] de ce qui a eu lieu à Auschwitz — de cet « événement sans réponse » (Blanchot), de ce pur impensable qu’il nous faut penser. Ce qui fonde la singularité absolue de l’extermination des juifs d’Europe, ce en quoi c’est sans répondant dans l’histoire, ne tient pas à sa logique de meurtre de masse : les précédents sont nombreux, y compris dans des visées systématiques, ordonnées à des idéologies racistes ou ethnocidaires. Mais jamais, auparavant, la rationalisation technique n’avait joué un rôle aussi déterminant : plus encore que l’ampleur, terrifiante, que l’évolution de la technique rend possible, c’est la part que prend cette technique dans l’élaboration du projet lui-même qui est inédite — je parle là de ce que l’on a appelé la « fabrication industrielle des cadavres », du fait que les chambres à gaz et les fours crématoires n’étaient en définitive pas des armes, du fait que l’on confiait la « tâche » à des fonctionnaires [2]. En plus de cette essence technique, absolument déterminante mais aussi absolument insuffisante quant à ce qu’il s’agit de penser, l’autre élément que je voudrais souligner est qu’il s’agissait avant tout de l’extermination des juifs, des juifs en tant que juifs [3]. La « menace juive », on le sait bien, n’existait pas, sinon fantasmatiquement : l’extermination des juifs ne relevait d’aucune logique autre que « symbolique », « spirituelle », « métaphysique » — quelque méfiance que l’on puisse avoir quant à ces mots : mais précisément, c’est bien depuis ce moment-là de notre histoire que l’on ne peut plus ne pas avoir de méfiance (d’inquiétude, à son sens le plus fort) à leur sujet, même si certains en auront eu le soupçon avant. Dans cette « logique » — car il y avait bien, et c’est ce qui est terrible, une logique à ce choix « illogique » des victimes, à ce projet « illogique » de leur extermination —, il s’agissait de rien moins que se débarrasser, au motif du fantasme d’une « pureté » du peuple (Volk) allemand — et ce fantasme encore aggravé par le biologisme désastreux de la notion pseudo-scientifique de « race » —, de ce qu’il y avait de supposément étranger au sein même de l’Allemagne et de l’Occident, et qui était censé menacer son identité voire sa survie — au mépris des évidences les plus élémentaires : l’Occident latin a toujours été, indissociablement, (au moins) grec et juif, juif et grec, pour reprendre le mot de Joyce [4]. Ce qui fut, sans mauvais jeu de mots, une véritable crise d’identité de l’Allemagne (et au-delà, de l’Europe) aura conduit à une opération de pure hygiène, de « nettoyage » compulsif d’une « souillure » fantasmée — et ainsi que le rappelle Lacoue-Labarthe, c’est encore une fois Kafka qui en avait eu la sinistre prescience : « Comme Kafka l’avait compris depuis longtemps, la “solution finale” était de prendre à la lettre les séculaires métaphores de l’injure et du mépris : vermine, ordure, et de se donner les moyens techniques d’une telle littéralisation effective » [5].
Il est peut-être permis de penser que les deux éléments que, après d’autres, j’ai mis en avant, que les caractères (les essences ?) technique et « symbolique » d’Auschwitz [6], ne sont pas sans rapport l’un avec l’autre : ce n’est qu’un aspect du projet de domination par l’homme, au moyen de la raison (du logos), sur la nature — du projet de l’Occident tout entier, de l’Occident philosophique, depuis deux millénaires et demi. Et peut-être, plus spécifiquement ou en tout cas plus explicitement, du projet de l’Occident moderne : du projet pour l’homme de se rendre « maître et possesseur de l’univers », ainsi qu’y invitait Descartes, dans son Discours de la méthode — incontestablement, l’un des textes où naissait la philosophie moderne. Mais à n’être qu’un aspect de ce projet, Auschwitz n’en est pas moins son aspect le plus terrible, qui révèle du même coup ce projet pour ce qu’il est essentiellement : un projet de domination autoritaire, par la raison en tant que raison technique, sur la nature.
—
J’en reviens aux cinq questions que je m’étais posées pour commencer. Ce que l’on ne peut manquer de constater, c’est que désormais, passé le XXe siècle et ses heures les plus sombres, on ne peut douter que la première question soit posée. Il est peut-être cynique, voire scandaleux, de continuer de perdre du temps et de l’énergie intellectuelle sur les problèmes que pose l’art, au moment où l’inquiétude générée par Auschwitz nous impose de repenser, de façon urgente mais très délicate, les modèles politiques de nos sociétés occidentales [7], au moment où la « tâche de la pensée » semble bien être ailleurs. On est peut-être, de ce fait, tenté d’aller directement à la cinquième des questions que je posais : faut-il cesser de prêter notre attention à l’art, ou même lui « régler son compte », une bonne fois pour toutes, s’en débarrasser ? De fait, il est difficile de contester à Adorno ce diagnostic :
Auschwitz a prouvé de façon irréfutable l’échec de la culture. Que cela ait pu arriver au sein même de toute cette tradition de philosophie, d’art et de sciences éclairées ne veut pas seulement dire que la tradition, l’esprit, ne fut pas capable de toucher les hommes et de les transformer. Dans ces sections elles-mêmes, dans leur prétention emphatique à l’autarcie, réside la non vérité. Toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique urgente, n’est qu’un tas d’ordure. [8]
Le constat est sévère, énoncé avec la vigueur dont Adorno était coutumier, mais absolument juste : l’échec est « irréfutable ». Non moins sévère, non moins vigoureux, était déjà cet autre constat, énoncé par le même Adorno en 1949, au lendemain de la guerre : « écrire un poème après Auschwitz est barbare » [9] — la formule fit mouche et le tour du monde, non sans subir de nombreuses déformations, non sans donner lieu à de nombreux malentendus (hélas pas toujours dissipés aujourd’hui). De façon assez improbable, les moins avisés des détracteurs d’Adorno crurent, ou firent mine de croire, qu’Adorno voulait « interdire » la poésie ou l’art. Peu importe, pour l’instant, s’il s’agissait évidemment [10] de tout autre chose : je ne vais pas essayer de résumer ici en quelques lignes la position, fort complexe, d’Adorno — ou bien, pour le dire autrement : c’est tout l’ensemble de ce texte qui essaie de penser dans le sillage de cette position. Peu importe, parce qu’au fond, et quoiqu’il ne l’aurait sans doute pas formulé exactement en ces termes, il n’est peut-être pas faux de dire qu’Adorno cherchait bien, en effet, à « interrompre » (quelque chose dans) l’art [11].
Prenons donc la chose au sérieux : qu’y a-t-il de tellement inquiétant dans l’art, qu’il faille s’en débarrasser ? Je ne m’arrête pas pour l’instant sur le fait, au demeurant incontestable, que l’art du XXe siècle aura été, en maintes occasions, « bizarre », inquiétant, dérangeant [12]. Pour en faire un motif suffisant pour se défaire de l’art, il faudrait donner un crédit démesuré à l’une ou l’autre de ces deux idées : soit, sur le mode d’un certain discours dominant : il faut « redonner confiance » (aux « français », aux « gens », voire aux « marchés financiers »...), il faut « remonter le moral » des « ménages », etc. Soit, sur un mode qui se voudrait plus « en souci de son époque » : au moment même où l’on constate que les plaies du siècle écoulé ne sont pas cicatrisées, n’a-t-on pas « besoin d’un peu de douceur » dans ce monde « cruel », etc. : on connaît la chanson. On ne peut résolument prendre la première idée très au sérieux, et quant à la deuxième : je ne crois pas un instant que la vocation de l’art soit de « consoler », et surtout je ne crois pas qu’il faille cicatriser les plaies encore ouvertes du XXe siècle, ou sinon le risque est grand qu’une certaine amnésie ou léthargie — dont on voit poindre parfois, d’ailleurs, les premiers signes inquiétants — permette que le pire advienne de nouveau. Essayons donc de voir la question sous un jour plus recevable : n’y a-t-il pas, précisément quant à ce qui s’est produit au XXe siècle, quelque chose de très inquiétant dans l’art ? Quelque chose de léthargique, justement, dans l’art — ou au moins, dans un certain art ? Il semble bien que l’art, pas moins que la philosophie et les sciences, n’a pas simplement échoué à empêcher la catastrophe, qu’en un sens et dans une certaine mesure il l’a permise. Je pense ici au rôle certain qu’a joué l’art — ou bien, mais c’est quand même très voisin : au rôle qu’on a fait jouer à l’art, et au rôle qu’on a fait jouer, à quelque chose qui n’était pas l’art, en lieu et place de l’art — dans l’évolution vers cette catastrophe : il s’agit tout à la fois d’une esthétisation du politique et d’une politisation de l’esthétique. Par « esthétisation du politique », j’entends ce qui a été au cœur de tous les fascismes : non seulement l’appareil de propagande, la « mise en scène » d’événements de masse (les congrès de Nuremberg, et leur exploitation cinématographique par Leni Riefensthal), mais encore la conception même du projet politique [13]. Incontestablement, le constat de Benjamin et Brecht, qui sont les premiers, au milieu des années 1930, à diagnostiquer cette esthétisation du politique, est d’une parfaite justesse. Mais ce par quoi ils entendent y répondre, la « politisation de l’art », n’est pas moins problématique, et résonne dangereusement avec le « tout est politique » des totalitarismes. L’utilisation, par le reich hitlérien, de la musique de Wagner au sein de l’appareil de propagande, devrait nous en convaincre — et plus encore si l’on perçoit en quoi le projet wagnérien « lui-même » rendait possible cette récupération [14]. Et il faut bien rappeler que les dangers que recelaient une telle politisation explicite de l’art avaient été d’emblée clairement perçus par Adorno : il est possible en particulier de lire sous cet angle le différend qui l’oppose à son ami Benjamin, notamment autour du célèbre essai sur « l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » [15]. Incontestablement, l’art recèle bien, oui, une menace, et l’inquiétude est légitime.
De là, nous n’aurions aucun mal à comprendre qu’il puisse être tentant de répondre « oui » à ma dernière question : débarrassons-nous de l’art, ou au moins appelons la philosophie à se « dé-suturer » du « Poème » — c’est en tout cas ce que semblait penser Badiou à la fin des années 1980 [16]. Et du même coup, on répondrait à ma première question : non, il ne faut plus s’occuper de l’art, l’art n’est plus important, déterminant, essentiel — aujourd’hui. Ce qui ne dit en rien, bien au contraire, que la question de l’art n’est plus importante : Badiou lui-même indique que cette dé-suturation est « l’enjeu principal » et « la difficulté suprême ». Mais en tout cas, toujours selon Badiou, « l’âge des poètes » est clos : autre façon de dire que l’art est devenu démodé, inactuel [17].
—
L’art, démodé et inactuel ? Peut-être bien en effet, mais surtout au sens où le démodé, l’inactuel, c’est aussi l’intempestif : l’Unzeitgemäße de Nietzsche. Et nul doute que l’on aurait quelque intérêt à ne pas trop rapidement se détourner, et qu’il faudrait bien plutôt s’inquiéter (encore une fois, à tous les sens du mot) de ce qui apparaît être à contretemps (puisque c’est là l’un des sens de unzeitgemäß). Il me semble urgent de ne pas arrêter la discussion aux considérations que j’ai esquissées ci-dessus : en somme, je n’ai toujours pas indiqué ce qu’il faut entendre et penser sous le mot « art », et il est probable que là soit l’un des nœuds de l’affaire.
C’est là un très vieux débat : cela fait au moins deux siècles que l’on n’a pas cessé de s’interroger sur « l’essence de l’art », et il ne fait nul doute que le débat a été singulièrement vif, pour ne pas dire violent, au cours du dernier siècle, pour de multiples raisons. Il est évidemment impossible de résumer ici ce débat, et probablement inutile d’en reprendre le fil : je me contenterai donc de quelques indications. Ce que je voudrais donner à voir, fût-ce un peu rapidement et allusivement, c’est que l’art a, en un sens, toujours été pensé comme l’autre de la technique. (Là serait la principale justification du fait que j’ai cru bon, dans la première partie de ce texte, de rappeler les termes les plus importants de l’analyse de ce qu’a été Auschwitz ; là serait, surtout, la principale justification du fait que je crois nécessaire de continuer (à s’interroger sur) l’art.)
Le point de départ le plus évident, pour tenter de montrer cela, serait de rappeler que l’art, en grec, se disait technè, qui voulait dire aussi « savoir-faire » ou même simplement « savoir », « science » : l’art, la technè était ce qui permettait d’avoir accès à la phusis (la nature), et plus encore à la vérité, à l’alèthéia de cette phusis. Il ne s’agit pas uniquement de signaler que, étymologiquement, technè a donné notre « technique », mais bien plus, de comprendre que pour les grecs il n’y avait pas de frontière tranchée entre l’art et la science : l’un et l’autre, aussi bien, étaient au fond langage, logos. Je n’y insiste pas, le français a du reste lui aussi gardé une certaine proximité du mot « art » et de la technique [18], peut-être encore plus évidente dans le mot « artisan » (et de même, par exemple, pour l’allemand « Kunst », qui signifie aussi bien adresse, habileté, artifice, ruse, etc.). Ce sur quoi il est peut-être plus nécessaire d’insister, c’est la façon dont la technè révèle la phusis (laquelle, réputée muette, ne se livre jamais directement : « phusis kruptesthai philei », disait Héraclite — « la nature aime à se cacher ») : « Hè technè mimeitai tèn phusin », la technè (l’art) « imite » la nature, ainsi que nous l’apprend Aristote. Au contraire de l’interprétation classique, au contraire pour tout dire de sa traduction par l’imitatio latine, la mimèsis en question n’est pas simple reproduction : pour faire apparaître la vérité, l’art élabore, mène à bien (epitélei) ce que la nature ne peut accomplir. Cette rationalité mimétique, c’est probablement ce qui s’est le plus perdu [19], un peu plus de deux millénaires après Aristote : la rationalité technique, la raison et la techno-science qui triomphent aujourd’hui et de façon croissante depuis la Renaissance et les Lumières (depuis que nous sommes modernes), s’est dramatiquement égarée, dans son projet de domination sur la nature, et a conduit à la catastrophe du XXe siècle. L’art a conservé, par son travail de reproduction — qui n’est jamais, là encore, « simple » reproduction, simple copie conforme, mais toujours ré-élaboration, mise en forme —, cette rationalité mimétique qu’a oubliée la raison instrumentale ; ce qui conduit Adorno a énoncer :
L’art est la rationalité qui critique celle-ci sans l’esquiver. L’art n’est pas pré-rationnel ni irrationnel, ce qui le condamnerait a priori au mensonge eu égard à l’imbrication de toute activité humaine dans la totalité sociale. [20]
Comprenez : l’art n’est pas une vérité archaïque (« pré-rationnelle »), l’art est pleinement rationnel — nulle esquive —, mais d’une rationalité autre, qui critique l’irrationnel au sein du processus de rationalisation. C’est précisément parce que l’art est l’autre de la raison, l’autre de la technique, qu’il est seul à même de critiquer efficacement celle-ci, aussi radicalement (i.e. autant « à la racine ») qu’il est nécessaire.
Ceci nous conduit assez naturellement à examiner la deuxième de mes cinq questions initiales : une fois posé que l’art est aux prises, par l’intermédiaire de ce rapport mimétique, avec ce qui lui est extérieur, une fois posé que l’art a pour rôle de critiquer le processus de rationalisation ambiant, il est urgent d’interroger la situation actuelle de l’art. Et il est urgent de prendre conscience de ce qui a changé, irrémédiablement sans doute, avec le XXe siècle. Ce qui a changé et qui est très visible, c’est en premier lieu ceci : depuis, par exemple, que Marcel Duchamp a voulu nous faire prendre des urinoirs pour des fontaines, on a perdu toute certitude, toute assise dans nos jugements sur ce qui est ou n’est pas une œuvre d’art, et — passé même le très épineux problème de l’œuvre (sur lequel je ne peux m’étendre ici) — sur ce qui relève ou non de l’art. Ce n’est pas tant que l’on se soit arrêté de juger — on n’a même fait que cela, mais se contredisant sans cesse —, mais c’est que chaque fois que l’on a tenté de donner une assise stable au jugement esthétique, on n’a pu que constater que, perpétuellement, le sol se dérobait. Et il a semblé parfois que c’étaient certains artistes, dits « d’avant-garde », qui organisaient ce travail de sape. Mais à élargir un peu le champ de vision, c’est en réalité l’assise du jugement « tout court », l’assise de n’importe quel jugement — esthétique ou éthique surtout, mais pas uniquement — qui a semblé se dérober. On peut y voir simplement la conséquence d’un effondrement du discours de la totalité, qui se serait produit au début du siècle dans la philosophie (sur des modes très différents : Benjamin, Heidegger, ou encore Wittgenstein) ; on peut aussi considérer que c’est la question des totalitarismes, la question d’Auschwitz, qui a obligé à prendre conscience dudit effondrement. Et dans ce contexte, l’art n’aurait été que mensonge s’il avait prétendu rester indemne de cette secousse : c’est en réalité la possibilité même de l’art qui est devenue bien incertaine, et nul artiste conséquent ne peut éviter de s’y confronter. Quelle que soit la réponse qu’il y apporte, nul artiste ne peut sérieusement démentir Adorno, et nier qu’après Auschwitz soit posée la question.
Pour l’art, la question du XXe siècle, de sa seconde moitié surtout, ne fut donc pas : « l’art est-il possible ? », mais : « l’art est-il encore possible ? » ; et cet « encore » est à entendre à un double sens au moins : l’art est-il encore possible après sa fin prononcée par Hegel, l’art est-il possible après son échec avéré par Auschwitz. Il ne s’agit peut-être là que d’une seule et même question : ce dont Hegel prononçait la fin, c’était à la fois, comme chacun sait, la capacité de l’art à être présentation sensible, effectuation immanente de l’Idée, mais c’était aussi — c’est une seule et même chose — la capacité de l’art à être un art religieux, c’est-à-dire en réalité un art politique. C’est précisément ce verdict que tout le romantisme a cherché à faire mentir, croyant même, au moins une fois, y parvenir (Wagner). Et c’est précisément sur fond de ce romantisme, dégradé entre-temps en vulgate nietzschéo-wagnérienne, que se conçoit le projet « esthético-politique » du national-socialisme, et c’est précisément sous le signe de l’immanentisme analysé naguère par Nancy [21] qu’il faut comprendre la volonté d’effectuation, dans les camps d’extermination, de la sombre « Idée » du projet national-socialiste. Ce que signe la catastrophe d’Auschwitz, c’est donc aussi bien la condamnation de la tentative de ne pas prendre au sérieux le verdict hégélien. Mais pour autant, il est possible de déplacer un peu la perspective, et de comprendre qu’il y a bien en réalité deux questions différentes : si, pour une part, l’impossibilité de l’art après Hegel et l’impossibilité de l’art après Auschwitz sont une seule et même chose, cette impossibilité montre aussi à l’art, après Auschwitz, où réside peut-être sa fragile possibilité, son impossible possibilité [22]. L’art, dans sa prétention au beau (i.e. sa prétention à l’adequatio, à la présentation adéquate de l’Idée dans la forme sensible), est ruiné, définitivement ; ne reste alors que la fragile possibilité du sublime, tel que la troisième Critique de Kant nous avait donné à le penser.
Il ne saurait être question ici de résumer en quelques phrases ce qui se joue au travers de cette notion de sublime, et qui est considérable. Je me contente donc, par économie, de reprendre la formule qu’en a proposée Lyotard : le sublime, c’est la présentation (de ceci) qu’il y a de l’imprésentable. Signe pointé vers l’infini ou « offrande » (Nancy), le sublime n’est pas uniquement la mince chance de l’art désormais, c’est aussi un risque considérable, un motif d’inquiétude extrême : même débarrassé de sa volonté d’effectuation, de l’adequatio, l’art reconduit par le sublime son aspiration à l’infini — et de fait l’art peut difficilement rester art s’il renonce totalement à cela [23]. Mais reconduisant cette aspiration à l’infini, l’art reconduit également une aspiration à la transcendance, c’est-à-dire aussi à une religion : on en sait trop bien les conséquences possibles.
—
La frontière est étroite. L’inquiétude, une fois de plus, est de mise.
L’esthétisation du politique, à son comble dans les entreprises fascistes du siècle dernier, n’a pas un instant délaissé nos sociétés : la « politique-spectacle » est notre réalité médiatique quotidienne. La politisation de l’art, sous la forme que prônaient Benjamin et Brecht ou sous la forme de ses répétitions plus ou moins laborieuses (« engagement » sartrien, entre autres), a montré ses limites, et sans doute aussi ses dangers. La politisation de l’esthétique elle-même, c’est-à-dire du discours philosophique sur l’art, s’est révélée catastrophique : Adorno [24] puis Lacoue-Labarthe [25] ont montré que dans le commentaire heideggérien de Hölderlin s’encryptait, peut-être même plus qu’ailleurs, la surdétermination politique de la pensée de Heidegger, après même que celui-ci avait rompu avec son éphémère engagement dans le mouvement national-socialiste. C’est d’ailleurs de là précisément que s’originaient les prescriptions de Badiou appelant à une « dé-suturation » de la philosophie au poème.
Mais à se détourner d’une question au motif de ce qu’elle recèle d’inquiétant, on ne ferait que reconduire sans le savoir les dangers que l’on veut conjurer. S’il y a bien, oui, à se débarrasser de l’art, il s’agit seulement de quelque chose au sein de l’art, et nul autre que l’art ne peut prendre cela en charge, quand bien même il y risquerait sa survie [26]. S’il y a bien, oui, à déconstruire certaines déterminations du discours esthétique, on voit mal comment cela pourrait se faire depuis ailleurs que l’esthétique. Il faut de fait non pas désarticuler l’art, la philosophie et la politique (on voit mal, du reste, comment ce serait possible), mais repenser entièrement, à nouveaux frais, leur articulation. C’est à cela qu’invite Adorno, dans son projet de théorie esthétique « critique », ou Lacoue-Labarthe, notamment par la lecture qu’il fait de certains textes de Benjamin [27].
Je voudrais, pour conclure, souligner l’un des éléments que Lacoue-Labarthe propose, pour repenser cette articulation. Il s’agit en fait d’un élément qu’il reprend de l’essai de Benjamin sur Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand [28], où Benjamin lui-même est en train de commenter les Remarques de Hölderlin sur Sophocle. En somme, je voudrais commenter brièvement Lacoue-Labarthe commentant Benjamin commentant Hölderlin commentant Sophocle... : il y va, une fois de plus, d’une longue affaire de mimèsis. Lacoue-Labarthe met en avant, pour engager une toute autre politique que celle héritée du romantisme, ce que Benjamin propose lui-même comme une « idée neuve en Europe » : le fait que « l’Idée de la poésie, c’est la prose », c’est-à-dire que l’art des modernes que nous sommes devrait se résoudre au principe de « sobriété » qu’avait analysé Hölderlin [29]. Je veux croire que c’est dans ce sens, et dans ce sens uniquement, que l’art peut survivre à l’aporie que je signalais un peu plus haut au sujet du sublime : sans renoncer au sublime, mais en renonçant à prétendre à l’enthousiasme (grec), l’art pourrait tendre à une « simplicité sublime », dont l’un des meilleurs exemple est incontestablement le poète Paul Celan.
Que resterait-il alors à l’art, pour que cette sobriété ne devienne pas un simple prosaïsme, au plus mauvais sens du terme ?
Il resterait que l’art ne cessera jamais d’être profondément, en son essence, comme nous l’avait déjà appris Freud, das Unheimiche : l’Inquiétant. Et comme chacun sait, l’unheimlich est toujours aussi heimlich, familier : l’art est ce qui peut nous permettre d’accepter l’autre en nous-mêmes — ce que le XXe siècle nous assigne comme tâche la plus urgente.
© B. Renaud, 19 novembre 2007
http://www.tache-aveugle.net/spip.php?article148
[1] Il faudrait s’y arrêter plus longuement : je renvoie donc aux nombreux travaux, de philosophes ou d’historiens, sur la question. En plus des références désormais les plus « classiques », je renvoie en particulier, pour une présentation précise et condensée de l’enjeu le plus proprement philosophique, à l’ouvrage de Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique (Paris, Bourgois, 1987, notamment p. 51-81), auquel j’emprunte l’essentiel des analyses que j’expose dans ce paragraphe.
[2] De cela, Kafka avait eu comme on sait la terrible prémonition : que l’on songe par exemple aux amabilités, aux « écœurantes politesses » qu’échangent les deux « messieurs », dans la scène finale du Procès, avant d’exécuter leur besogne et le tuer (« Comme un chien ! »), non sans ensuite observer « joue contre joue la conclusion ».
[3] L’extermination des Tziganes, des homosexuels, des communistes, n’est évidemment pas moins terrifiante. Comme l’indique Lacoue-Labarthe, l’horreur n’est pas « à son comble si les victimes sont des petits-bourgeois européens, vous ou moi » : « dans l’extermination technique de masse, l’horreur, ou pire encore, est partout à son comble » (La fiction du politique, op. cit., p. 76). Mais cela ne dit pas, pour autant, que la portée « symbolique », la « signification métaphysique » soit nécessairement la même. Il y a manifestement une spécificité de la question de l’antisémitisme, question qui n’est pas seulement celle de l’Allemagne, mais celle de l’Occident, de l’Occident latin et chrétien, dans son entier.
[4] « Jewgreek or greekjew » — une formule sur laquelle Derrida ou Lacoue-Labarthe, entre autres, sont souvent revenus.
[5] La fiction du politique, op. cit., p. 62.
[6] Mais qui sont aussi, il faut y insister, les deux caractères essentiels de toute l’entreprise du national-socialisme, ainsi que l’a montré Lacoue-Labarthe. Encore une fois, il ne s’agit en aucun cas, dans mon propos (ni dans celui d’aucun, à ma connaissance, de ceux qui auront été les penseurs de l’« après-Auschwitz »), de prétendre qu’il n’y a pas d’autres questions, que celle d’Auschwitz : il s’agit bien plutôt de montrer comment les très nombreuses questions du XXe siècle (et bien au-delà) se concentrent — et avec une acuité terrible — dans cet unique événement.
[7] Cf. à ce propos la contribution de Julien Barroche dans ce même volume, qui montre que ce qui fut entrepris après-guerre, sous le nom de « subsidiarité », pour conjurer la menace de l’État totalitaire, pourrait de fait reconduire cette menace sans le savoir — où il se vérifie que, si les motifs d’inquiétude sont bien réels, les réponses à apporter sont souvent loin d’être simples : c’est très exactement ce que, à ma façon, j’essaye de donner à voir ici.
[8] Dialectique négative, Paris, petite bibliothèque — Payot, p. 444.
[9] « Critique de la culture et société », Prismes, Paris, Payot, 1986, p. 26. Notamment du fait de la polémique qui en était née, Adorno pris soin de revenir à plusieurs reprises sur cette formule, pour tenter de s’en expliquer. On se reportera en particulier à Theodor W. Adorno, Métaphysique : concept et problèmes, Paris, Payot, 2006 p. 164-166 et passim, et à Dialectique négative, op. cit., p. 437-451 et passim. (Ajout internet : voir également les quelques notes que j’ai mises en ligne ici.)
[10] Mais que l’on se soit autant mépris sur pareille évidence en dit probablement long, notamment sur la façon dont, au lendemain de la guerre, la célébration de la « culture ressuscitée » opérait un véritable refoulement de ce qui venait de se produire.
[11] J’essaye d’employer ici le verbe « interrompre » au sens que lui donne Jean-Luc Nancy dans La communauté désœuvrée, Paris, Bourgois, 1986. À la même époque, la lecture que fait Lacoue-Labarthe de Paul Celan, dans La poésie comme expérience (Paris, Bourgois, 1986), va également dans ce même sens d’une « interruption » de l’art. Dans le lexique d’Adorno, il s’agirait de quelque chose qui se rapproche d’un « anti-art » ou d’un désart luttant contre la désartification — pour reprendre la double traduction que Lacoue-Labarthe a proposée du concept adornien d’Entkunstung (« Remarque sur Adorno et le jazz », Rue Descartes n° 10, Paris, Albin Michel, 1994).
[12] Dans ce même volume, les contributions de Claire Conilleau et de Katia Schneller en donnent des exemples précis.
[13] En témoigne, entre mille autres exemples, ces quelques lignes de Goebbels, dans une lettre à Furtwängler : « La politique est, elle aussi, un art, peut-être même l’art le plus élevé et le plus large qui existe, et nous, qui donnons forme [je souligne] à la politique allemande moderne, nous nous sentons comme des artistes auxquels à été confiée la haute responsabilité de former, à partir de la masse brute, l’image solide et pleine [je souligne] du peuple. » (cité dans Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, op. cit., p. 93).
[14] Il y a bien, de fait, « récupération », c’est incontestable : je ne prétends aucunement rendre simplement Wagner responsable du wagnérisme, dans ses aspects les plus tragiques. Mais on ne peut non plus, pour autant, disculper entièrement Wagner « lui-même », c’est-à-dire « l’œuvre » de Wagner, sans autre forme de procès. Je renvoie ici à l’Essai sur Wagner d’Adorno et au Musica ficta (figures de Wagner) de Lacoue-Labarthe.
[15] Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, essais — Folio, 2000, p. 67-113 [1935] et p. 269-316 [1939].
[16] Cf. L’être et l’événement (Paris, Seuil, 1988) et Manifeste pour la philosophie (Paris, Seuil, 1989), et à ce sujet l’article de Lacoue-Labarthe : « Poésie, philosophie, politique », in Heidegger : La politique du poème, Paris, Galilée, 2002, p. 43-77.
[17] Et, tant qu’on y est, on pourrait également cesser de faire la fine bouche, au nom de l’art, devant toute une « nouvelle culture », dont on sait trop bien les critiques virulentes dont elle a fait l’objet de la part, en particulier, d’Adorno.
[18] Le dictionnaire de référence Trésor de la langue française donne par exemple, pour première définition du mot « art » : « ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l’homme tend à une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat ». On ne saurait donner de meilleure définition de la technique.
[19] Comme toujours, ce qui se perd est toujours en fait ce qui s’oublie, ce qui s’enfouit le plus profondément et le plus secrètement, et ce qui in fine nous commande le plus fortement et le plus intimement. Après notamment que Benjamin et Adorno en avaient montré, à leur façon, la voie, c’est principalement à la mise au jour de cette « mimétologie fondamentale » qu’a travaillé, sa vie durant, Philippe Lacoue-Labarthe.
[20] Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1995, p. 86.
[21] La communauté désœuvrée, op. cit.
[22] Je renvoie ici à la lecture qu’a faite Derrida du motif de la « possibilité de l’impossible » (das Möglichkeit des Unmöglichen) chez Adorno, dans Fichus, Paris, Galilée, 2002.
[23] Bien que le concept de sublime n’y soit pas explicitement évoqué, c’est exactement ce qui est aussi en jeu dans le différend qui oppose Benjamin et Adorno autour de la notion d’aura, et de l’essai sur l’œuvre d’art. Bien qu’il considère que « dans la situation actuelle, les œuvres d’art honorent l’élément auratique en le refusant » (Théorie esthétique, op. cit., p. 431), Adorno ne peut se résoudre à voir l’art renoncer à l’aura, c’est-à-dire ni plus ni moins à voir l’art renoncer au sublime.
[24] Adorno, « Parataxe », Notes sur la littérature, Paris, Champs – Flammarion, 1999, p. 307-350.
[25] Heidegger : La politique du poème, op. cit.
[26] Ce motif est omniprésent dans la Théorie esthétique d’Adorno. Ainsi par exemple : « L’art est contraint de se tourner contre ce qui constitue son propre concept et il devient, en conséquence, bien incertain. » (p 16) ; ou : « La révolte de l’art [...] est devenue révolte contre l’art. Il est inutile de prophétiser s’il survivra ou non à cela. » (p. 18) ; ou encore : « l’art qui s’en tient à son concept et refuse la consommation se transforme en anti-art. » (p 470).
[27] « Poésie, philosophie, politique » et « Le courage de la poésie », Heidegger : La politique du poème, op. cit., p. 43-77 et p. 117-155 respectivement.
[28] Walter Benjamin, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, Paris, Flammarion, 1986.
[29] Cf. à ce sujet l’article de Lacoue-Labarthe : « L’antagonisme », L’imitation des modernes, Paris, Galilée, 1986, p. 113-131.
© B. Renaud, 19 novembre 2007
http://www.tache-aveugle.net/spip.php?article148