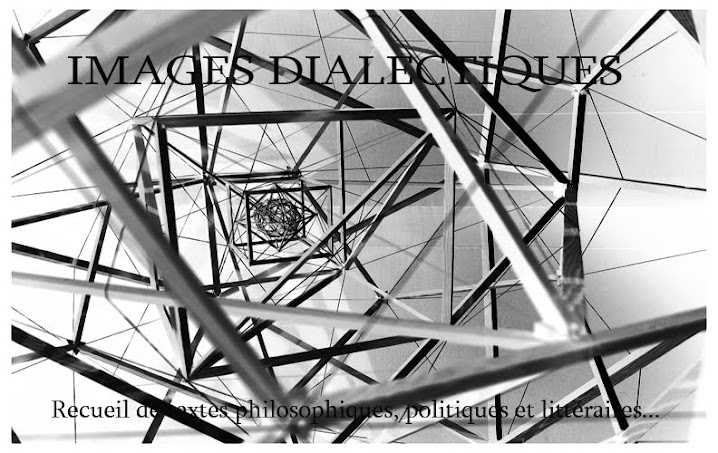23 Kasım 2012 Cuma
Séminaire sur la peine de mort
Critique Séminaire sur la peine de mort, première partie
Par ROBERT MAGGIORI
Mors certa, hora incerta, dit-on. La mort est certaine, mais pas l’heure de sa venue : telle est la fortune des hommes, qui mourraient d’ennui s’ils se savaient immortels, et qui au contraire, sachant indéterminée l’échéance future, donnent signification et valeur à leur vie. Aussi semble-t-il proprement inconcevable qu’on puisse donner la mort. Non pas se donner la mort, car, aussi difficile que ce soit, on peut toujours comprendre qu’au faîte du désespoir, le suicide soit une manière de signer l’absence de sens de son existence ou de lui en donner un qui, rétrospectivement, l’éclaire tout entière. Ni provoquer volontairement la mort de l’autre, assassiner donc, de la façon la plus subtile ou la plus sanglante - car la victime ne la voit pas «venir» comme péremption, écoulement d’un délai déterminé. Mais donner la mort comme on donne un tragique rendez-vous, en la prescrivant à l’avance, c’est-à-dire en fixant, à l’aube d’un matin glauque, la date et l’heure de sa venue. Mors certa, hora certa : de cet «impossible», de l’impossibilité d’une mort exceptionnellement décidée, «arrêtée par un arrêt de justice», mise en scène et exécutée, le pouvoir d’Etat a pourtant fait sa condition de possibilité, le paradigme de la «décision souveraine» par laquelle il devient justement Etat.
«Bruit qui court». A la peine de mort, Jacques Derrida a consacré, outre son enseignement aux universités de Californie (Irvine) et de New York, deux années de séminaire à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), en 1999-2000 et 2000-2001 (trois ans avant sa disparition, le 8 octobre 2004). Ce séminaire s’inscrivait dans un vaste programme de recherche, intitulé «Questions de responsabilité», qui, à partir de 1996, s’est décliné selon les cycles «Hostilité-hospitalité», «Le parjure et le pardon», «La peine de mort» et «La bête et le souverain». Qu’il enseignât à la Sorbonne, à l’école normale supérieure ou à l’EHESS, le philosophe rédigeait presque entièrement ses cours, à la main, puis à la machine et à l’ordinateur. On dispose ainsi «de l’équivalent de quelque 14 000 pages imprimées, soit 43 volumes, à raison d’un volume par années d’enseignement». Leur édition critique intégrale - 40 volumes prévus ! - est donc une entreprise colossale, à laquelle, après la Bête et le Souverain (1), s’ajoute à présent une deuxième pierre, la première partie du séminaire sur la Peine de mort.
En même temps, et en suivant, pourrait-on dire, la corrélation peine-grâce, est publiée une conférence prononcée à Cracovie, Cape Town et Jérusalem, qui résume en quelque sorte la séance d’ouverture du séminaire consacré au parjure et au pardon, Pardonner : l’impardonnable et l’imprescriptible, où Derrida discute les positions de Vladimir Jankélévitch, lequel, dans le Pardon, montre que le pardon, comme forme suprême d’amour, n’est pardon que s’il parvient à pardonner l’impardonnable, et, dans l’Imprescriptible, indique que «le pardon est mort dans les camps de la mort», le déniant alors à «ceux qui n’ont jamais demandé pardon» et qui ont commis l’impardonnable, l’inexpiable (2).
L’œuvre de Jacques Derrida - que «l’Evénement déconstruction», un épais numéro des Temps modernes (avec deux entretiens inédits) éclaire sous tous les angles - est immense, on le sait, et continue à produire dans le monde un nombre infini de commentaires et d’études, philosophiques, esthétiques, littéraires… A Hans-Georg Gadamer, dans une lettre de décembre 1985, reproduite dans le numéro des TM, le philosophe écrit : «Contrairement au bruit qui court, je suis un homme de parole, de cette "parole vive" - comme on croit pouvoir dire - qui met mieux à nu que toute autre expérience ce que j’appelle écriture ou trace.» Cette parole (3), on l’entend évidemment dans les séminaires, bien que le style n’en soit guère «parlé» : aussi, à mesure qu’ils seront publiés, la perception de l’œuvre écrite s’en trouvera-t-elle modifiée, comme cela a été le cas pour celle de Michel Foucault avec l’édition des Cours du Collège de France : il sera, entre autres, bien difficile de seulement songer que la pensée derridienne se plaît aux sophistications des jeux de langage et virevolte dans les espaces éthérés de la haute (anti)métaphysique, tant est évident là son enracinement dans la terre de la politique, de l’éthique, du social même.
Amalgame. En 1972, la Cour suprême des Etats-Unis a décrété que l’application de la peine de mort était en contradiction avec des articles de la Constitution, concernant la discrimination des citoyens devant la justice, et, surtout, ce qui s’y trouve défini comme «unusual and cruel punishment», les peines inhabituelles et trop cruelles, que la charte exclut. Durant cinq ans, nul ne subit l’exécution capitale. Mais en 1977, certaines autorités politiques ou juridiques ont considéré que la mort donnée par letal injection - et non par pendaison, gaz ou chaise électrique - n’était pas cruelle : dès lors elle fut de nouveau appliquée dans de nombreux Etats. A partir de là peut s’enclencher le débat «pour ou contre» la peine de la mort. Mais le séminaire de Derrida ne se réduit pas à ce type de discussion, laquelle, d’ailleurs, ne porte pas sur le principe même de la peine de mort, mais, outre-Atlantique, tourne, chez ceux qui protestent contre son application, autour des éventuelles irrégularités, des erreurs judiciaires, des vices de procédure, de l’insuffisance de preuves risquant de mener à la mort un innocent. S’il est «massivement tourné vers les Etats-Unis de l’an 2000, c’est-à-dire l’un des très rares, voire le seul et dernier grand pays de culture dite européenne et à Constitution dite démocratique à maintenir, dans des conditions que nous étudierons de près et malgré de nombreuses conventions internationales […] le principe de la peine de mort», et s’il inscrit celle-ci «dans une histoire, dans l’histoire du droit et des techniques de mise à mort légale», guerrières, policières, militaires, médicales, chirurgicales, «anesthésiales», le séminaire se présente avant tout comme une déconstruction des principes philosophiques qui fondent le discours juridique, religieux et politique sur la peine de mort, «la déconstruction […] de l’histoire comme échafaudage de cet échafaud». D’où une lecture très serrée des textes canoniques de l’histoire des religions et de l’histoire du droit, de l’œuvre de Platon, de Cesare Beccaria, champion de l’abolitionnisme, de Kant, Hegel, Rousseau, Nietzsche, mais aussi de Jean Genet et Camus, de Hugo, de Maurice Blanchot ou de Michel Foucault.
L’analyse se déploie à partir du «nœud» qui lie indissociablement le concept de peine capitale au concept de souveraineté, lui-même attaché à ceux d’exception, comme Carl Schmitt l’a montré («Est souverain celui qui décide de l’état d’exception»), et de cruauté. Cette notion de souveraineté possède naturellement une ascendance théologique, parce que le souverain, c’est d’abord Dieu, et ensuite le monarque de droit divin qui, par son pouvoir absolu, peut statuer sur la vie et la mort de ses sujets. Mais elle s’est transférée dans les Etats nationaux et les démocraties modernes, dont le «président», malgré la séparation des pouvoirs, possède encore le droit de grâce. C’est donc dans la mixtion du théologique et du politique que doit être cherché le «secret», si on peut dire, de la peine de mort et de sa permanence.
D’une certaine manière, c’est l’inverse qui intéresse Derrida : éclairer certes l’histoire de la peine de mort par la notion de théologico-politique, mais, surtout, chercher à savoir ce qu’est le théologico-politique en suivant le fil de la peine de mort. Dès lors, il suffit d’élargir quelque peu le cadre pour entendre l’extraordinaire actualité de son discours, et réaliser à quel point, selon des modalités manifestes ou absconses, le «droit de tuer» se forge dans l’amalgame subtil du religieux et du politique. Comment est-il possible que, «jusqu’à certains phénomènes récents et restreints d’abolitionnisme», les «Etats-nations de culture abrahamique (juive, chrétienne ou islamique)» n’aient pas trouvé de contradiction entre la peine de mort et le sixième commandement, «Tu ne tueras point», qui garantit un droit absolu à la vie ? Et Dieu lui-même en a-t-il trouvé une, qui dit à Moïse «d’ordonner aux fils d’Israël "Tu ne tueras point", et l’instant d’après, de façon immédiatement consécutive et apparemment inconséquente, "tu livreras à mort celui qui n’obéira pas à de tels commandements"» (Exode, XXI, 12-17) ?
Acmé. Pour illustrer son propos, Derrida commence par mettre en scène quatre «cas», ou personnages paradigmatiques, condamnés à mort : Socrate, Jésus, Hallâj (922) et Jeanne d’Arc (1431). Socrate, selon l’accusation, «n’a pas honoré les dieux (theous), et il a introduit des démons nouveaux (etera de daimonia kaina)». Jésus, dans l’Evangile selon saint Jean (XIV, 6), dit être «le chemin, la vérité et la vie» et proclame que «personne ne vient au Père que par moi». Hallâj, dont le procès «opposa toutes les forces islamiques de l’époque, imâmites et sunnites, fuqahâ et sufis», est condamné pour «s’être enivré jusqu’à l’extase et crié "Je suis la vérité" et à le crier encore du haut du gibet : "Anâ’l-haqq" (me voici, la vérité)». Jeanne, elle, entend directement la voix de Dieu. «Chaque fois un grief, une accusation, une incrimination religieuse visant une offense blasphématoire à l’endroit de quelque sacralité divine, une incrimination religieuse investie, prise en charge, incarnée, incorporée, mise en œuvre, enforced, appliquée par un pouvoir politique souverain, qui marque par là sa souveraineté, son droit souverain sur les âmes et sur les corps, et qui en vérité définit sa souveraineté par ce droit et par ce pouvoir.»
Ce ne sont là que les prémisses du Séminaire, qu’il faut entendre au sens propre, de lieu où est propagée la semence (semen), tant sont nombreux les sillons qu’ouvre Derrida. Le détissage de tous les fils qui constituent la question de la peine de mort laisse voir comment «la sanction pénale administrée par l’Etat dans l’ordre d’un Etat de droit» réussit à s’extraire du champ du «crime» ou de l’«assassinat» pour se poser à l’acmé de la justice. Ainsi, la loi éthique est «enveloppée» ou étouffée par la loi juridique et les décrits politiques qui, dès lors, peuvent considérer la faute punie comme «hors morale», c’est-à-dire inexpiable et impardonnable. Le politique hérite du religieux le pouvoir de mettre à mort, conserve the right of clemency, le droit de gracier, et rend au religieux - mais à Dieu seulement - le pouvoir de pardonner.
(1) Edition de Michel Lisse, Marie-Louise Mallet et Ginette Michaud. Galilée, 2008, 2010. (2) Vladimir Jankélévitch, «le Pardon», Aubier, 1967, et «l’Imprescriptible», Seuil, 1986. (3) Mise en scène par Safaa Fathy, dans le film «D’ailleurs Derrida», DVD, éditions Montparnasse.