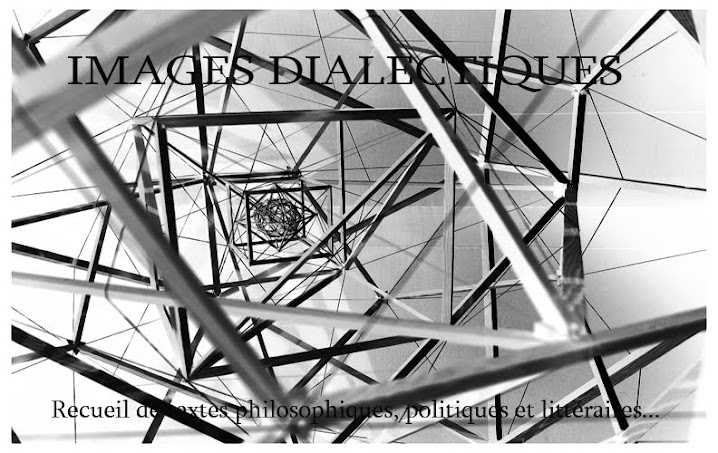Marcel Gauchet
Les tâches de la philosophie politique
• HISTOIRE, DROIT, POLITIQUE
— Généalogie de la modernité
— Les trois révolutions du politique
• DE L’HISTOIRE AU DROIT
— Les raisons d’un retour
— Une fonction de rattrapage
• DU DROIT AU POLITIQUE
— La leçon des totalitarismes
— Un dévoilement par l’évanescence
— La nature de la démocratie
— La nature du politique
La question n’est pas de celles que l’on s’adresse spontanément à soi-même. Vous êtes sollicités d’y répondre ou vous n’y réfléchissez même pas.
C’est le cas. La question m’a été posée, en l’occurrence, par les animateurs du Collège de philosophie, dans le cadre d’un passage en revue du paysage philosophique actuel. Je me suis rendu volontiers à leur invitation, cela dit, parce qu’elle m’obligeait à sortir de mon sillon et à me situer au milieu d’un cadastre compliqué. Même si l’on doit refuser le tableau proposé, on aura du moins une carte d’ensemble par rapport à laquelle s’orienter. L’utilité de l’instrument n’est pas à démontrer, et les propositions ne sont pas si nombreuses.
Conformément aux règles de l’exercice, je m’efforcerai de donner une vue impartiale et compréhensive de ce qui se fait en matière de philosophie politique. J’avancerai, en même temps, une vue plus personnelle de ce qui me semble à faire. Je plaiderai pour la tâche que doit plus particulièrement se proposer la philosophie politique, à mon sens, compte tenu de la situation qui est la nôtre, en la situant par rapport aux autres tâches qu’elle poursuit légitimement.
Pourquoi la philosophie politique ? On lui reconnaît volontiers une actualité, qu’elle aurait conquise petit à petit au cours des vingt ou trente dernières années. Que peut vouloir dire une telle actualité ? La politique est un trait permanent de la condition humaine. En ce sens, depuis qu’il y a philosophie, il y a philosophie politique. Il y a au minimum des propos de philosophes sur la politique. Il faut parler d’une inactualité de la philosophie politique, sous cet aspect. Elle n’empêche pas qu’il y a des moments où la philosophie politique acquiert un relief, une urgence, une centralité, une correspondance ou une consonance plus marqués avec les interrogations collectives. Il y a de bonnes raisons de penser que nous nous trouvons, en effet, dans un tel moment.
Écartons tout de suite le cliché facile selon lequel il s’agirait d’une « mode ». La durée, le caractère diffus et très modérément grand public du phénomène suffisent pour tordre une bonne fois le cou de ce piètre canard.
On a affaire à une inflexion intellectuelle en rapport avec les évolutions de nos sociétés depuis la crise économique des années soixante-dix. Elle a directement à voir avec les transformations sociales et la métamorphose idéologique que l’on peut observer depuis lors. Trois traits paraissent plus particulièrement à retenir.
L’actualité de la philosophie politique, pour commencer, a un lien flagrant avec le dépérissement de l’idée révolutionnaire, la remise en question du marxisme et la percée politique de l’antitotalitarisme. La chose, j’imagine, ne sera disputée par personne. Mais ce sont les conséquences de fond de ce basculement idéologique qui sont à considérer. Il impose à l’attention de tous la question surgie avec les régimes totalitaires : le marxisme ne rend pas compte de ce qui s’est établi en son nom. Comment rendre compte de la forme politique construite sous l’égide du matérialisme historique et qui a l’intéressante propriété d’en démentir les prémisses ? Corrélativement, comment penser la démocratie comme fait politique si elle ne se dissout pas dans l’économie capitaliste et dans les rapports de force de la société bourgeoise ? Interrogations bien connues, mais rarement soutenues, ce pourquoi je me permets de les rappeler. Si l’on doit se débarrasser définitivement et radicalement du marxisme, que met-on à la place ? C’est de cette inquiétude qu’est d’abord faite la conjoncture de la philosophie politique.
Il est à noter ensuite qu’elle accompagne un aspect frappant de la transformation de nos sociétés depuis une trentaine d’années : la montée du droit. Une montée idéologique – il n’est que de penser aux droits de l’homme. Une montée pratique, confiant un rôle de plus en plus étendu à la régulation juridique. Une montée politique qui ne se réduit pas à l’ascendant conquis par les cours constitutionnelles, mais qui concerne plus largement la place dévolue au contrôle et à l’arbitrage judiciaire par rapport au processus politique. Cette montée du droit est sociologiquement liée à l’affirmation de l’individu.
Intellectuellement, enfin, l’actualité de la philosophie politique doit beaucoup à la crise des sciences sociales, à la crise du concept de société, de ses pouvoirs explicatifs et de ses capacités à guider l’action publique.
Il en résulte une résurgence du point de vue normatif dont l’objectivisme des sciences sociales prononçait la disqualification. Nous voyons renaître le point de vue moral comme le point de vue de la légitimité prescriptive.
On revient à l’interrogation sur ce que les choses doivent être en raison et en droit.
HISTOIRE, DROIT, POLITIQUE
J’aurai en fait à parler de trois choses : d’histoire, de droit et de politique au sens strict – en termes plus développés et plus explicites : d’histoire de la philosophie politique, dans ses liens avec l’histoire tout court, puis de philosophie du droit politique, et, enfin, d’application de la philosophie à la chose politique.
J’examinerai, en premier lieu, à quelles conditions l’histoire de la pensée politique qui se fait de toute façon, par la vitesse acquise de l’institution, pourrait acquérir sa signification ou sa portée véritables, et à partir de quelles questions.
J’essaierai, en deuxième lieu, de comprendre la signification du phénomène central que représente la renaissance du droit politique dans la période récente, puisqu’aussi bien c’est cette théorie du droit politique qui constitue le gros de ce qu’on met sous le nom de philosophie politique. Pourquoi le problème de la fondation en droit de l’ordre politique revit-il aujourd’hui ?
Qu’est-ce que cela veut dire ? Quels sont les apports de cette démarche fondationnelle ? Que peut-on en attendre ? Quelles sont ses limites ?
Je plaiderai, en troisième et dernier lieu pour une philosophie du politique, la branche de loin la moins représentée dans la production, la filière minoritaire du domaine, et pourtant, à mon sens, à la fois la plus nécessaire civiquement, et plus féconde philosophiquement.
Généalogie de la modernité
Impossible de ne pas remarquer tout de suite que ces trois entrées correspondent à ce que nous pouvons repérer, d’emblée, comme les trois grandes nouveautés caractéristiques de la modernité dans le domaine politique. Trois nouveautés qu’il est possible et commode de raccrocher aux trois noms de Machiavel, de Hobbes et de Hegel – trois noms d’initiateurs et, partant, trois noms à valeur de symbole. La modernité commence, en effet, avec l’irruption d’une vue réaliste de la chose politique au XVIe siècle; elle se marque dans l’apparition d’un nouveau regard sur la réalité de la politique, à la mesure d’une réalité politique nouvelle. La modernité passe, ensuite, par l’introduction, au XVIIe siècle, d’une démarche nouvelle de fondation en droit de l’ordre politique, sur la base d’une conception du droit elle-même essentiellement renouvelée. La modernité consiste enfin dans l’émergence, début XIXe siècle, du point de vue de l’histoire, point de vue qui modifie entièrement le statut et l’intelligence du politique – doublement, d’abord en faisant du politique un problème à résoudre dans et par l’histoire, ensuite en soumettant le politique à une critique radicale au nom de l’illusion qu’il représenterait.
Si je procède à ce rappel, c’est afin de débanaliser mon premier point, autant que faire se peut, de lui ôter ce qu’il a de trop prévisible et ce qu’il peut paraître annoncer d’académisme stérile. Il faut pourtant bien en passer par là : la première tâche de la philosophie politique, c’est de faire sa propre histoire. On s’en doute, ne manquera-t-on pas de me dire. On ne le sait même que trop, en particulier dans une université française, qui tend à confondre philosophie et histoire de la philosophie, et qui n’a enfourché le cheval de la philosophie politique, depuis peu, que pour l’empailler aussitôt, en s’empressant de réduire l’entreprise à l’étude des auteurs et des œuvres– et encore, d’un corpus d’auteurs et d’œuvres soigneusement délimité comme corpus légitime, selon des critères très contestables.
C’est contre cette pente fatale qu’il est utile de rappeler les raisons que nous avons de nous intéresser à cette histoire, les questions vives qu’elle soulève et les enjeux qui s’y attachent. Au demeurant, la tâche est peut-être plus facile sur ce terrain qu’un autre. L’histoire de la pensée politique est somme toute moins menacée d’oublier sa raison d’être, peut-on croire, que l’histoire de la philosophie en général. Il est sans doute plus difficile d’oublier pourquoi nous en faisons et ce en quoi nous en avons besoin. Elle paraît moins exposée au risque de s’ossifier en devenant une fin routinière en soi.
Il ne suffit pas, cela dit, de déplorer cette involution aberrante qui étouffe la pensée vivante sous la mémoire antiquaire. Il faut comprendre les raisons auxquelles elle obéit, qui sont puissantes. Elle est la rançon de ce que notre situation intellectuelle a de plus spécifique par rapport à celle de nos devanciers. Nous ne sommes plus capables d’accéder à nous-mêmes, à notre identité, à la vérité de notre condition que par le détour du passé dont nous sortons et dont nous nous éloignons. Une situation inédite dont nous sommes loin d’avoir pris la mesure et qui ne cesse de nous jouer des tours. J’en prends un exemple approprié à notre sujet. Il m’est fourni par l’un des courants intellectuels les plus influents de la philosophie politique d’aujourd’hui, le courant issu de Leo Strauss. Ses représentants nous exhortent à nous délivrer de l’illusion moderne de l’histoire pour retrouver la vérité de la nature en politique dont les anciens auraient su capter le secret. Ils n’en passent pas moins leur vie, par une admirable contradiction, à nous relater en grand détail les voies par lesquelles s’est joué historiquement cet exil de la nature. Ils dénoncent l’histoire, et ils ne font que de l’histoire. Ils sont en cela bel et bien modernes, quoi qu’ils en aient et quoi qu’ils disent. Alors, autant l’être en sachant qu’on l’est et en s’efforçant de l’être de manière conséquente. Il nous faut apprendre à assumer en conscience ce nouvel élément où notre réflexion est contrainte d’évoluer et qui nous distingue inexorablement de nos prédécesseurs. C’est pour n’avoir pas réfléchi suffisamment à ses impératifs et à ses pièges que nous en subissons les expressions pathologiques. Faute d’une juste appréciation de ses ressources et de ses difficultés, nous sommes ballotés entre l’hypermnésie et une amnésie réactive. D’un côté, nous sommes en proie à un souci du passé qui écrase le présent, mais de l’autre côté, à mesure que le poids du passé s’accuse, que le musée, la bibliothèque, les archives gagnent en extension, la tentation grandit de vivre sans eux et de faire comme s’ils n’existaient pas. Jamais nous n’avons été aussi obsédés par le passé; jamais nous n’avons pu vivre à ce point dans le présent comme si nous n’avions pas de passé. Si, en de certains lieux, le passé menace de remplacer le présent, en d’autres, la menace est plutôt de vivre dans un présent sans passé. Les deux périls font système.
Dans le cas de l’histoire de la philosophie politique, peut-être avons-nous une chance plus grande qu’ailleurs d’échapper à cette double malédiction. Parce que, contre l’obsession antiquaire, le souci du présent y est plus fort et plus facile à plaider qu’ailleurs. Parce que, contre l’enfermement dans le présent, la dimension généalogique y est plus tangible qu’ailleurs :
ce qui nous tourne vers la pensée du passé, c’est l’indispensable recherche de nos commencements.
Nous vivons dans des régimes qui ont la particularité de se réclamer d’une légitimité qui n’est ni traditionnelle, ni naturelle, ni transcendante.
Ce ne sont ni les ancêtres, ni l’ordre cosmique des choses, ni les dieux qui nous dictent nos lois. Depuis deuxsiècles, pas davantage, temps très court à l’échelle des cinq millénaires documentés par l’écriture, pour s’en tenir à eux, nos régimes présentent cette singularité, non seulement d’avoir leur physionomie fixée dans des constitutions écrites, mais surtout de se réclamer de principes de droit, de s’appuyer sur des normes juridiques qui font de la volonté humaine le ressort du lien politique.
Une situation historique qui possède cette originalité supplémentaire de nous renvoyer à une genèse livresque – grande différence, soit dit au passage, avec les anciens. La pensée politique a anticipé sur l’histoire réelle.
Elle a préparé cette révolution dans la légitimation. De Grotius à Rousseau, on voit se déployer sur un siècle et demi une problématique des droits des individus et de l’ordre politique juste devant découler de ces droits subjectifs qui a fini par sortir des livres pour se faire histoire effective. À partir des révolutions des droits de l’homme de la fin du XVIIIe siècle, la refondation en droit de la communauté politique méditée par les théoriciens entre dans les mœurs et les données de nos sociétés. Il a fallu deux siècles pour que cette incarnation s’opère pleinement, mais nous y voici parvenus.
C’est la marque distinctive de notre présent.
Il s’ensuit naturellememnt un triple chantier problématique.
1. Comment ces démarches et pensées de la fondation sont-elles nées, avec leur charge de rupture ? Il paraît difficile, dès à première vue, de les isoler de ce que l’âge politique moderne amène de réalités politiques nouvelles : d’abord un nouveau rapport de la religion avec la politique, à partir de la réformation de Luther ou parallèlement à elle, comme dans le cas de Machiavel; ensuite une consistance nouvelle des États souverains au-dedans et au-dehors. Elle se forge en réponse aux défis des guerres de religion, au-dedans; elle s’affirme en réponse aux défis de la révolution militaire et de la politique d’équilibre des puissances, au-dehors.
2. Comment ces pensées de la fondation ont-elles trouvé à s’incarner, dans le sillage des révolutions américaine et française qui mettent leurs principes à l’ordre du jour, à la fin du XVIIIe siècle ? Par quels chemins sont-elles entrées dans la réalité au XIXe siècle et jusqu’à nous, cela dans des conditions hautement paradoxales, puisqu’au travers d’un élément, l’histoire, qui paraît d’abord en démentir, voire en ruiner sans appel, l’ambition rationalisatrice ? Dans un premier temps, l’histoire, telle que sa conscience s’impose à compter du début du XIXe siècle, semble porter avec elle la dénonciation du droit, en tout cas dans ses ambitions fondatrices. S’il y a histoire, alors il n’y a pas de fondation en droit possible, le droit étant lui-même une création de l’histoire. Au bout de deuxsiècles, nous voici arrivés à une intéressante inversion de problématique : c’est le droit, matérialisé dans sa portée fondatrice, par l’histoire, qui en vient à dénoncer l’illusion de cette dernière. Mais au prix de quelles altérations cette concrétisation des droits de l’homme s’est-elle effectuée ? Jusqu’à quel point est-elle devenue effective ?
3. Cette généalogie directe appelle, au-delà, une réflexion sur notre situation et sur nos origines de plus vaste portée historique. En quoi au juste cette situation moderne et contemporaine qui est la nôtre nous éloigne-t-elle ou nous sépare-t-elle de nos plus lointains ancêtres, grecs et romains ? Car, pour très inédite qu’elle soit, cette situation qui est la nôtre ne fait pas perdre toute pertinence aux auteurs anciens, bien au contraire. Si nous sommes aujourd’hui, par un côté, dans le moment où les droits de l’homme sont devenus pour de bon la pierre de touche de la légitimité politique, par l’autre côté, nous pouvons aussi bien dire que nous sommes au moment où la politique d’Aristote acquiert une nouvelle pertinence à nos yeux. C’est un élément de notre réalité, qui justifie jusqu’à un certain point – tout étant dans la mesure de ce point – les « retours aux anciens », contre les illusions modernes, proclamés et mis en œuvre par quelques éminents auteurs. Notre généalogie est double. Nous procédons de deux commencements, un commencement interrompu, le commencement antique – lui-même double, et fort complexe, en sa dualité d’aspect – et puis un second commencement, avec lequel nous sommes en continuité, le commencement moderne, qui reprend maints éléments du premier, mais qui les change profondément et qui introduit à côté d’eux des éléments essentiellement nouveaux, qui nous emmènent très loin des anciens et de leur intelligence de la chose politique et juridique, mais sans cependant couper tous les ponts avec eux. Toute la question étant, dès lors, de faire le départ entre provenance et réinvention, entre ce qui nous arrive d’eux directement ou indirectement, mais selon toutefois un fil continu, et ce qui fait que de l’intérieur de notre monde dans ce qu’il a de plus éloigné du leur, nous retrouvons les anciens.
Les trois révolutions du politique
En d’autres termes, l’enjeu central de l’histoire de la philosophie politique, c’est la mesure de la modernité, en elle-même et par rapport à ses précédents. C’est maintenant vers cette mesure interne que je voudrais me tourner, après avoir décrit le déploiement des interrogations généalogiques qui surgissent du plus simple constat que nous puissions faire relativement à la singularité de notre condition politique. Nous évoluons à l’intérieur d’un ordre constitutionnel-légal. La politique se présente à nous comme encadrée et réglée par des normes juridiques bien définies. De là toute une série de questions relativement au contenu de ces normes, à l’installation de cette situation et à son originalité en regard des périodes antérieures de l’histoire. On pourrait prolonger ces observations par quelques réflexions supplémentaires relativement aux conditions de l’exécution. De par son objet, cette anamnèse soulève quelques exigences de démarche et de méthode qu’il n’est pas inutile de souligner. Je les laisserai provisoirement de côté, pour me concentrer sur l’inventaire systématique de la modernité politique. Celui-ci nous y ramènera obliquement. En évoquant ce que recouvrent les trois noms de Machiavel, de Hobbes et de Hegel, nous aurons inévitablement à indiquer une manière de traiter leurs œuvres et de les inscrire dans leur temps. Il n’y aura pas besoin de beaucoup y insister pour faire ressortir qu’une certaine mise en contexte des œuvres paraît la condition pour leur faire rendre la plénitude de leur sens, mais pas n’importe quelle mise en contexte.
La modernité politique se déploie en trois « vagues », en effet, pour reprendre l’expression fameuse de Léo Strauss en lui donnant un autre contenu. Pour le dire autrement, elle prend la forme de trois révolutions du politique qui vont successivement introduire des nouveautés décisives en matière, pour commencer, de concepts de la politique, puis en matière de justification de la politique, enfin en matière de milieu dans lequel se donne et se réalise la politique.
1. Première vague, donc, celle que nous pouvons identifier au nomsymbole de Machiavel, soit ce qui est communément reconnu comme l’apparition d’une politique pure, une politique réalistement regardée en elle-même et sans autre fin qu’elle-même, hors de toute considération religieuse et morale. En fait, il faut tenir l’irruption du « réalisme » machiavélien pour le premier moment ou pour l’enclanchement d’un vaste mouvement de redéfinition du politique qui traverse tout le XVIe siècle et qui court jusque loin avant dans le XVIIe siècle. Un mouvement qui se déploie parallèlement à la révolution religieuse du XVIe siècle – la réformation de Luther est exactement contemporaine de la rédaction des œuvres politiques majeures de Machiavel. Le Prince et les Discours sont écrits entre 1513 et 1519. Luther affiche ses thèses à Wittenberg en 1517. Un mouvement qui va trouver sa forme finale en incorporant dans la définition du politique les fruits de la révolution théologique dont il est contemporain, à la faveur d’une situation qui mérite d’être tenue pour la matrice de la conscience moderne. En face des divisions religieuses introduites par la Réforme et des situations de guerre civile qui en résultent, s’affirme un parti des « politiques » – et l’on peut bien dire un parti du politique, au sens de la prééminence du politique sur la religion –, parti pour lequel l’autorité souveraine s’impose comme la seule chance de paix. Le « magistrat civil », le monarque, le prince, bref le pouvoir politique, comment qu’il se présente et comment qu’on l’appelle, doivent passer au-dessus des autorités ecclésiastiques et se subordonner les « choses sacrées ». En quoi la révolution religieuse du début du XVIe siècle se prolonge, à la fin du XVIe siècle, dans une révolution religieuse du politique dont sont issus les concepts politiques spécifiquement modernes, à commencer par le concept cardinal d’État. L’État émerge comme notion en tant qu’État de la raison d’État, c’est-à-dire l’État fondé à se soumettre la religion. C’est au titre de ce rôle qu’il se définit par la souveraineté. Il est doté d’une suprématie métaphysiquement absolue, à l’échelle de la sphère humaine, puisqu’elle commande même aux ministres du divin.
La première mesure de la modernité consiste ainsi dans la mesure de l’inédit dans la mise en forme du politique dont la décantation s’opère autour de 1600 et qui achève de prendre corps vers 1650. Elle passe en particulier par la mesure de l’inédit des notions qui servent à désigner et à penser ces figures émergentes du pouvoir et du commandement.
2. Deuxième vague, celle que je rapportais au nom de Hobbes, plus décisif que celui de Grotius, qu’il serait aussi légitime d’employer, d’un point de vue historique. Deuxième vague étroitement dépendante de la première.
C’est une fois qu’on a éclairci le surgissement de l’État souverain de droit divin, de l’État de la raison d’État, au sortir de la révolution théologico~politique du XVIe siècle, que l’on comprend comment se déclare un problème de légitimité de ce nouvel ordre politique. L’invocation d’un religieux d’audelà des religions constituées n’y suffit pas. Le nouvel ordre demande à être étayé par en bas; il exige une nouvelle fondation en droit. C’est à ce problème que va répondre le déploiement du droit naturel moderne. On peut parler, à propos de cette entreprise, d’une révolution juridique du politique, puisqu’il va s’agir de redéfinir entièrement le lien politique sur la base d’une nouvelle source et norme du droit, la source constituée par les droits subjectifs des individus.
Hobbes introduit un nouveau principe de composition, en droit, de toute communauté politique concevable, qui se résume en une très simple proposition : il n’y a que des individus. C’est à partir de ce principe qu’il faut penser la genèse juridique du politique. Ce principe de composition emporte comme sa conséquence capitale la subjectivation du domaine politique. On a enfermé, en général, l’avènement moderne du sujet dans le domaine de la connaissance. Il ne concerne pas moins, en réalité, le domaine de la politique. L’enjeu philosophique du droit naturel moderne, de Grotius et Hobbes à Rousseau et à Hegel, va être la redéfinition du politique selon le sujet, doublement, du côté de l’élément politique, le citoyen, sous l’aspect du sujet de droit individuel, mais aussi du côté de l’ensemble politique, de la communauté politique, sous l’aspect du sujet politique collectif. C’est cette double détermination qui va constituer l’originalité de la démocratie des modernes par rapport à ses précédents antiques.
3. Troisième vague, celle que je liais au nom de Hegel et qui correspond à ce formidable événement dont nous n’avons qu’à peine encore effleuré les conséquences : l’apparition d’un nouvel ordre de réalité pour la conscience humaine, l’histoire. Elle s’effectue en peu d’années, quelque part autour de 1800. Hegel est le premier à lui donner son expression pleinement développée en théorie. Mais il faut préciser aussitôt que l’on ne tient avec Hegel qu’un commencement. Il y a un déploiement continué de l’idée d’histoire au-delà de Hegel. Il y a une histoire de l’élargissement et de l’approfondissement de la conscience historique, au XIXe et XXe siècle, qui reste à écrire.
L’apparition de l’histoire modifie entièrement, de nouveau, le statut du politique et la manière de le considérer, de telle sorte que nous pouvons parler d’une révolution historique du politique. Il est spécialement nécessaire d’en prendre une exacte mesure, parce qu’elle est le facteur qui conditionne de la manière la plus directe et la plus lourde, aujourd’hui, le problème philosophique du politique.
Pour résumer son impact d’une phrase : l’irruption du point de vue de l’histoire entraîne la secondarisation du politique. Le droit naturel moderne, la philosophie individualiste et artificialiste du contrat, en dépit de la rupture qu’ils représentent, restent en continuité avec la pensée ancienne sur un point crucial. Ils reconduisent la présupposition du primat explicite du politique.
Le point de vue du politique est le point de vue de l’organisation d’ensemble de la communauté humaine. Si l’on veut penser une communauté humaine comme telle, il faut l’appréhender sous l’angle du politique, qui est l’élément au travers duquel elle s’ordonne et se définit. L’histoire amène avec elle une nouvelle notion englobante du collectif humain. Le concept de société s’impose en lieu et place de celui de corps politique. Au sein de la société, le domaine politique ne représente plus qu’un secteur particulier, ce pourquoi je parle de « secondarisation ». Le politique n’est plus qu’une subdivision des affaires humaines à côté d’autres, il n’apparaît plus immédiatement comme ce qui les ordonne ou les coordonne. Qu’on le tienne pour un facteur dérivé, qui s’explique par d’autres facteurs jugés davantage structurants, comme l’économie ou la division de classes, ou qu’on le tienne pour un facteur irréductible, exprimant une dimension permanente et indépendante de la vie de l’homme en société, la secondarisation de son rôle est pour finir la même.
C’est cette évidence devenue la nôtre qui constitue aujourd’hui le principal défi, le mot n’est pas trop fort, pour une philosophie du politique. Le politique n’est-il vraiment que cela, que ce domaine rentré dans le rang où la révolution de l’histoire nous a conduits à le cantonner depuis le début du XIXe siècle ? Ou ne faut-il pas lui reconnaître, au-delà de ces apparences, une puissance d’organisation, une fonction d’institution, désormais cachées dans nos sociétés, mais non moins agissantes pour être dissimulées ? Ce qui impliquerait de renouer d’une certaine manière, à l’intérieur du monde historique qui est devenu le nôtre, avec l’entente ancienne et classique du politique. S’il ne peut plus être question de primat ordonnateur explicite du politique, le politique ne demeure-t-il pas, tout en étant passé dans l’implicite, le facteur englobant et instituant qu’une longue tradition y a vu ? Mais ce passage dans l’implicite ou dans l’inconscient d’un rôle jadis placé au premier rang exige évidemment, dans tous les cas, de le repenser. Je crois que ce problème de l’identification du politique et de la place qu’il occupe dans nos sociétés est le problème le plus profond posé à la philosophie politique aujourd’hui.
Il est à remarquer que Hegel se situe exactement à la charnière, du point de vue de cette discontinuité. Il maintient encore l’idée ancienne du primat organisateur du politique. Sa pensée s’inscrit toujours à l’intérieur de cette présupposition. Ce par quoi il continue d’appartenir à l’univers intellectuel du droit naturel moderne. En même temps, il est celui qui, dans ce cadre maintenu, amène au jour les instruments intellectuels qui vont permettre de le renverser. Sous cet angle, Marx accomplit bel et bien le mouvement de renversement amorcé par Hegel. Mais un renversement préparé d’abondance par les penseurs libéraux des premières décennies du XIXe siècle, un Constant, un Guizot, un Bentham, soucieux de consacrer l’indépendance de la société civile et de ses libertés et de limiter l’emprise du pouvoir politique. C’est chez les libéraux d’abord que le pouvoir est expressément déchu de son ancien statut de cause pour être assigné au rang d’effet, que le politique cesse d’être conçu comme organisateur pour n’être plus considéré que comme un produit second de la société. Marx ne fait que radicaliser ce renversement libéral en le transportant à l’intérieur de l’histoire et de son développement dialectique tel que Hegel en a promu l’idée. C’est chez lui que le détrônement du politique atteint son point extrême avec sa relégation au rang de superstructure essentiellement répressive par rapport à l’infrastructure constituante représentée par le mode de production.
L’apparition de l’élément historique ne modifie pas seulement, de la sorte, le statut du politique, elle disqualifie en outre la problématique de la fondation imposée par le droit naturel moderne. Une fois qu’on apprend à penser dans les termes de l’histoire, ce qui compte, c’est le mouvement, c’est-à-dire d’un côté, l’identification du moteur de ce mouvement, et de l’autre côté, l’identification de sa direction. Toute démarche de retour à l’origine et de détermination de ce qui doit être à partir de composantes natives et de normes primordiales apparaît irréelle, en regard. Tant la possibilité de cerner de tels termes initiaux que la perspective normative se vident de sens.
Le droit lui-même ne peut être qu’un produit du développement historique.
Le point essentiel ne réside pas dans sa capacité à signifier un devoir-être dans l’abstrait, mais dans les conditions concrètes de la réalisation d’un tel devoir-être, conditions qui ne peuvent être fournies que par le mouvement de l’histoire. Cela, même si l’on accepte de reconnaître une consistance à part entière au droit, de même qu’à la politique.
Je l’ai déjà suggéré, la pensée politique selon l’histoire admet au moins deux versions et non pas une seule : une version libérale et une version radicale. On pense toujours à la thèse révolutionnaire selon laquelle le droit n’est qu’un leurre et le masque d’une domination politique réduite au rapport de forces, domination qui ne s’explique elle-même que par une division des classes dictée par le régime de la propriété et les rapports de production. Mais à côté de cette thèse radicale, il y a la thèse modérée qui se refuse à voir dans le droit une illusion et dans la politique un pur rapport de forces. Elle leur prête au contraire une réalité indépendante et un rôle positif. Elle n’en repose pas moins, pour ce qui nous intéresse, sur les mêmes présupposés et sur la même version de la marche du collectif. Elle aussi loge le primum movens dans la société civile et la libre activité des individus qui la composent. À ceci près qu’elle regarde cette situation comme un progrès historique, progrès dont le couronnement est le système représentatif qui entérine enfin la vérité de la politique en faisant formellement du pouvoir l’expression de la société. Ce qui est et doit être premier, c’est le social, que le politique est destiné à servir par le canal de la représentation et à réguler par le moyen du droit. À la base de l’option libérale, on retrouve le même renversement du primat du politique en primat du social que dans le socialisme révolutionnaire. Le libéralisme est tout aussi critique que lui vis-à-vis de l’illusion du politique et du droit dans leur prétention ancienne et classique à normer a priori l’existence en commun. La différence est qu’il reconnaît la réalité propre de la politique et du droit et qu’il se refuse à en envisager la résorption. Il s’en tient à leur limitation instrumentale, là où le socialisme vise à leur complète réappropriation dans le gouvernement du social par lui-même. Mais il partage avec lui le refus d’attribuer à la politique et au droit la puissance d’institution et de définition qui leur était traditionnellement prêtée.
C’est ainsi que le XIXe siècle est le théâtre d’une vaste dénonciation de l’illusion politique, portée par l’expansion de l’histoire. Il est traversé par une critique radicale de l’entente héritée du politique comme principe ordonnateur et dans sa ligne, du droit politique comme droit fondateur. Elle a ceci de remarquable qu’elle coïncide avec le développement de la politique, comprise comme la sphère des activités liées à la formation et au contrôle du pouvoir dans le cadre du régime représentatif. L’expansion pratique de la politique (et parallèlement du droit) est parfaitement corrélée avec la secondarisation théorique du politique, avec la disqualification de l’ancienne portée explicative qui lui était reconnue. L’histoire alimente la perspective d’une science de la société en rupture avec les anciens modes de pensée de la chose collective. Elle nourrit l’ambition d’une science objective de la réalité sociale, d’une science des faits sociaux, en un mot, délivrée des illusions normatives qui étaient au cœur tant de la politique ancienne que des philosophies du droit naturel moderne. Ce sont l’histoire et la société qui sont capables d’expliquer la politique et le droit, en aucun cas le contraire.
Il faut avoir à l’esprit les termes de cette problématique archihégémonique jusqu’il y a peu pour prendre la mesure du renversement de tendance que nous sommes en train de vivre depuis une trentaine d’années. Nous sommes en train de nous désillusionner de l’histoire qui avait elle-même paru en son temps nous désillusionner de la politique et du droit. Nous prenons distance avec la perspective historique et sociale – ou plutôt nous découvrons que l’histoire et la société sont autre chose en vérité que ce qu’on croyait –, et cet écart nous ramène au droit et au politique. Tout se passe comme si nous refaisions le parcours à l’envers et en accéléré : l’histoire nous ramène au droit et le droit nous ramène au politique. C’est cet étonnant parcours qui définit l’actualité de la philosophie politique.
DE L’HISTOIRE AU DROIT
Nous assistons à la résurgence du droit politique, c’est-à-dire de la théorie de la fondation en droit de la communauté politique. Cette résurgence se produit à l’intérieur de l’élément intellectuel de l’histoire et de la société. Car on n’est évidemment pas en présence d’un mouvement de bascule qui nous ramènerait en arrière et qui réinstallerait le droit politique en majesté à la place de l’élément historique, comme si celui-ci n’avait jamais existé. L’acquis en la matière est irréversible. Mais l’acquis change. Un certain exclusivisme du point de vue de l’histoire et de la société a fait long feu. Il s’est produit une transformation de la conscience historique, qui autorise, dans son cadre, un nouveau déploiement de la démarche de fondation en droit. Le règne sans partage des sciences sociales n’est plus de mise.
Alors qu’il semblait avoir définitivement vidé de sens l’idée d’une approche normative de la chose collective, chaque jour montre un peu mieux qu’il laisse place à une philosophie de la règle avec laquelle il doit, en réalité, composer au sein d’un nouveau partage des tâches. La sociologie se pénètre et se nourrit du point de vue du droit.
C’est l’actualité la plus visible de la philosophie politique que cette renaissance normative à côté et en liaison avec la science sociale objective.
La théorie du droit politique tient la vedette incontestée dans le domaine, à tel point qu’elle se confond avec lui aux yeux de beaucoup, et qu’elle en épuise la définition. Tel n’est pas le cas, à mon sens, comme on verra, mais cette contestation ultérieure ne doit pas empêcher de reconnaître l’éminente signification du phénomène.
La réapparition du droit politique est à coup sûr l’un des grands événements intellectuels de notre histoire récente. Nous pouvons lui donner une date : la publication en 1971 de la Théorie de la justice de John Rawls. L’immense écho qu’a rencontré l’ouvrage, l’énorme postérité qu’il a eue en font un repère et un symbole. On peut compléter le tableau en rappelant la publication en 1981 d’un autre ouvrage séminal, la Théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas. Il donne une version « continentale » du mouvement, plus soucieuse d’intégrer les acquis de la pensée critique du derniersiècle, mais il confirme la direction. Nous voyons renaître, après deuxsiècles d’éclipse, la problématique de la fondation comme problématique vivante en matière politique.
Les raisons d’un retour
Je formulerai trois observations à propos de cette résurgence, afin de cerner les caractères nouveaux que revêt cette problématique de la fondation par rapport à ses expressions antérieures.
1. Il est impossible de ne pas noter la corrélation de ce retour du droit avec la mutation planétaire des économies et des sociétés à l’œuvre depuis le début des années soixante-dix. On s’aperçoit chaque jour un peu plus, avec le recul, que ce qui s’est manifesté d’abord comme une « crise économique » aura été une métamorphose sociale totale, et mondiale, qui n’aura laissé intact aucun aspect de la vie de nos sociétés. Son impact idéologique est bien connu. Parallèlement aux transformations de l’industrie et de l’économie, ces années ont été marquées par le frappant dépérissement de l’espérance révolutionnaire. C’est sur fond de ce déclin que s’opère la percée de la réflexion anti-totalitaire, de concert avec un ralliement généralisé aux principes et aux valeurs démocratiques, le tout associé à une poussée massive d’individualisation au sein de nos sociétés. Mais sous ces évolutions superficiellement ressassées, il y va d’un déplacement des conditions d’intelligibilité de nos sociétés, d’une refonte du système des repères en fonction desquels les acteurs peuvent penser leur monde dans le temps. C’est un changement de rapport à l’histoire qui s’est joué là. Il a pris la forme d’une crise de l’avenir dont l’évanouissement de l’idée révolutionnaire n’a été que le symptôme le plus voyant. Avec la possibilité de se représenter l’avenir, ce qui entre en crise, c’est la capacité de la pensée de l’histoire de rendre intelligible la nature de nos sociétés sur la base de l’analyse de leur devenir, et sa capacité à leur fournir des guides pour leur action transformatricesur elles-mêmes, au titre de la prévision et du projet.
La pensée selon le droit revient et s’impose en tant que réponse au double déficit théorique et pratique creusé par la crise de l’avenir. Elle correspond à une autre manière pour nos sociétés de répondre à la question de ce qu’elles sont et de ce qu’elles ont à être. Elle leur procure une autre manière de s’identifier : ce que nous sommes, ce n’est pas le devenir qui nous emporte qui peut nous le dire, ce sont nos principes fondateurs. Elle leur ouvre une autre façon de se projeter et de se vouloir : ces principes nous disent par la même occasion ce vers quoi nous devons tendre, où nous devons aller. Le droit fondationnel s’est réintronisé, de la sorte, en tant qu’instrument d’intelligibilité et en tant que moyen d’action, comme vecteur politique du changement social.
2. Si la transition a pu se faire aussi facilement, de l’histoire au droit, c’est que l’opposition était en trompe-l’œil pour une bonne partie, décou-vrons-nous rétrospectivement. Il nous faut relire sous cet angle l’histoire du XIXe siècle et du premier XXe siècle. Nous nous apercevons après coup que cette période placée sous le signe de la critique des illusions et des mensonges du droit naturel, invalidé pour son artificialisme, son rationalisme abstrait, son formalisme, a été en réalité une période de lente concrétisation du point de vue de l’individu et de ses droits. Elle s’est opérée au travers même de ces réalités collectives massives que l’on prétendait opposer à son abstraction : le peuple, la nation, l’État, les classes, le travail comme processus collectif. Le XIXe siècle et le premier XXe siècle se sont voulus l’âge du réalisme social, par opposition à l’idéalisme juridique des Lumières.
Sauf que tous ces collectifs réels mis en avant par la pensée du socialhistorique ont fonctionné comme autant de vecteurs d’individualisation. Ils ont été les incubateurs grâce auxquels cette créature effectivement fort « abstraite », sinon chimérique, encore dans le monde de la fin du XVIIIe siècle, l’individu, est devenue très concrète. C’est de ce travail de matérialisation historique et sociologique que la pensée selon le droit a pu solder le compte, à un moment donné, pour repartir armée d’une nouvelle crédibilité. C’est parce qu’il y a eu ce long travail pour produire et construire socialement l’individu doté de droits qu’il est devenu possible de faire fond sur lui pour repenser l’ensemble social.
3. Cette situation permet de comprendre en quoi nous ne sommes plus dans l’espace intellectuel du droit naturel, même si formellement nous en retrouvons la logique fondationnelle. La similitude des démarches ne les empêche pas de revêtir des significations différentes. La pensée du droit naturel procède par rationalisation mythique de l’origine. Elle projette dans le passé abstrait de l’état de nature, passé hors histoire, la recherche d’une norme primordiale en elle-même intemporelle quant à la composition du corps politique. L’avènement du temps de l’histoire dénonce ce passéisme abstrait et l’intemporalité de cette fondation en nature. Il est clair que nous ne revenons pas, avec l’actuelle résurgence du point de vue du droit, à cette vision anté-historique du temps. La différence cruciale de la philosophie de la fondation telle que nous la voyons revivre aujourd’hui, par rapport à sa devancière du XVIIe et du XVIIIe siècle, c’est qu’elle évolue à l’intérieur de l’élément historique. Nous sommes au-delà de l’opposition classique entre droit naturel et histoire. Ce que nous pouvons exprimer en disant : si retour du droit il y a, c’est un droit sans la nature. Nous avons le contenu du droit subjectif sans le support qui a permis de l’élaborer.
Il en résulte un changement notable dans son mode d’application. Le rapport entre l’être et le devoir-être n’est plus le même. Ce qui d’un côté se présente comme fait dans l’histoire peut être appréhendé de l’autre côté sous l’angle normatif. Ce sont deux angles de vue sur la même réalité. Décrire nos sociétés telles qu’elles sont et les décrire telles qu’elles devraient être, ce ne sont pas deux tâches radicalement différentes – d’autant que les décrire telles qu’elles sont, c’est les saisir telles qu’elles s’efforcent de se faire être dans un travail incessant sur elles-mêmes pour se réformer. L’appel à la fondation revenait initialement à se réclamer d’une base idéale logée en deçà du temps historique qui, si elle avait pu prévaloir, aurait installé la communauté politique dans une forme définitive, à l’abri des vicissitudes corruptrices du devenir. Il est devenu une façon de donner un visage à l’avenir, de définir un idéal régulateur pour l’acteur historique. Il est dans tous les cas conçu dans une relation immédiate à la possibilité de sa réalisation. L’être de nos sociétés, pour autant qu’il est historique, est fait de devoir-être, d’anticipation. C’est en ce sens que le point de vue du droit fonctionne comme un substitut à la prévision défaillante.
Une fonction de rattrapage
Une fois qu’on a établi de la sorte la fonction civique et politique qu’a retrouvée le droit, on comprend ce qu’a été depuis les années soixante-dix et ce que demeure à ce jour la tâche intellectuelle de ces pensées renouvelées de la fondation. Cette tâche est essentiellement une tâche de rattrapage.
Elle les distingue là aussi de leurs ancêtres. Les philosophies jusnaturalistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, nonobstant leur passéisme formel, ont été historiquement des pensées anticipatrices. Elles ont inventé et élaboré une idée nouvelle de la société des hommes, de ses bases, de sa norme et de ses fins, à l’intérieur d’une société qui restait encore largement traditionnelle et religieuse. Rien de pareil pour nous. Le rôle dévolu à la pensée de la fondation est d’expliciter une légitimité latente, qui s’est peu à peu installée dans nos sociétés, à mesure que se matérialisaient en pratique les garanties individuelles et les libertés démocratiques. Légitimité latente à laquelle il s’agit d’apporter son fondement après coup, dans les termes de la légitimité fondamentale des droits de l’homme, alors que, comme dans le cas exemplaire de l’État-providence, il s’est agi d’entreprises qui se sont conçues comme la réalisation de compromis politiques et sociaux auxquels il s’agissait d’assurer une base technique, au moyen de procédures d’assurance ou de redistribution.
Pour le dire autrement, nous avons appris petit à petit, au cours des deux derniers siècles, à tirer d’autres conséquences en pratique des droits de l’homme que celles que leurs premiers formulateurs avaient aperçues.
Nous en sommes venus à envisager autrement l’incarnation de la liberté et de l’égalité primordiales des individus. Il s’agit de procurer à ces développements leur assise en théorie. Nous sommes au moment où il nous est demandé d’aligner les principes explicites de notre droit sur la forme de nos sociétés qui se cherche implicitement, de procurer à des faits ou à des exigences confusément perçues comme légitimes leurs bases de droit, alors qu’ils se sont installés, souvent, au nom d’autres justifications.
Ce rattrapage, cette traduction, cette explicitation et cette fondation du sens commun en matière de légitimité trouvent à s’exercer dans les trois registres qui étaient traditionnellement ceux de la philosophie du droit naturel. Elles s’appliquent en premier lieu au droit de la nature proprement dit, ce qu’on appellera plutôt aujourd’hui la sphère des droits fondamentaux.
Elles s’appliquent en deuxième lieu au droit politique; elles s’emploient à tirer les conséquences de ces droits fondamentaux sur toute forme légitime concevable d’ordre politique. Elles s’appliquent, enfin, en troisième lieu, au droit des gens, selon l’expression consacrée, entendons le droit qui prévaut entre les communautés politiques et les nations, on dira plus justement aujourd’hui, en reprenant l’expression kantienne, le droit cosmopolitique.
1. Premier registre, donc, la nature des droits fondamentaux, la manière de les comprendre, leur signification, qui change beaucoup d’aspect, dès lors qu’on ne recourt plus à la fiction d’un ancrage en nature pour les établir. Mais à côté de leur signification se pose aussi la question de leur extension. À cet égard, la question principale reste celle des droits sociaux – la question de leur existence d’abord, et celle ensuite de leur teneur exacte. Quid, en droit fondamental, du point de vue des droits de l’homme, de l’État protecteur qui s’est tant bien que mal établi dans le cadre des démocraties libérales, qui en constitue désormais une dimension cruciale, et qui en fait des démocraties libérales-sociales ? Faut-il y voir un fait qui n’emporte pas de droit ? C’est la thèse commune aux purs libéraux, pour lesquels il ne saurait exister de tels droits sociaux, et aux marxistes révolutionnaires, pour lesquels il faut voir là un compromis social de classes et non un développement de droit des régimes bourgeois. Ces thèses demeurent relativement minoritaires. Le sentiment dominant, le sens commun prévalent est dans nos sociétés qu’il y va là, au contraire, d’un point de droit fondamental, et même de la vérité des droits de l’homme. Au-delà du contrat politique entre des individus libres et égaux et des conséquences qui en résultent quant à la souveraineté du peuple et quant aux libertés publiques, nous nous accordons communément à penser que ce contrat comporte en outre des conséquences relativement à la justice sociale devant régner à l’intérieur d’une telle communauté politique. Nous pressentons intuitivement que ces conséquences ont directement à voir avec le noyau des droits primordiaux des individus. Mais quelles conséquences au juste, pourquoi, jusqu’à quel point ? C’est très exactement le problème du premier Rawls, le Rawls de la Théorie de la justice.
Mais est apparue plus récemment, au-delà des droits sociaux, une question des droits culturels, qui soulève des difficultés peut-être encore plus redoutables. Comment définir les droits qui regardent l’identité des personnes, dont nous devinons qu’ils représentent en effet des composantes de leur dignité, mais nous discernons aussi combien il est malaisé de les objectiver ?
2. Rattrapage, explicitation et fondation, ensuite, dans le registre du droit politique. Le déploiement de l’expérience démocratique a fait apparaître, sur ce terrain-là également, d’autres visages de ce que nous pouvons tenir pour un régime légitime.
Nous avons vu se développer, par exemple, de nouvelles exigences en matière de pluralisme, et, conséquemment, en matière de formes de la coexistence collective et du rôle de l’autorité publique. Le phénomène modifie le regard qu’on pouvait porter sur la neutralité libérale de l’État. On en était resté à une image négative de l’abstention nécessaire de l’État dans le domaine des croyances et des modes de vie – il doit surtout ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. On en vient à une image positive de son rôle dans l’organisation du pluralisme. Il lui est demandé une reconnaissance active des options religieuses, philosophiques ou existentielles dans leur diversité. La liberté se donne à repenser, au-delà de son image classique de la liberté de conscience, en fonction de son incarnation sous les traits d’un pluralisme social créant à la puissance publique de nouvelles obligations et de nouvelles limitations. C’est la question du second Rawls, le Rawls du Libéralisme politique.
Mais nous avons vu semblablement se développer de nouvelles exigences en matière de délibération, de participation à la préparation des décisions et de garanties procédurales relativement à la manière dont sont effectués les choix publics. Impératifs que l’on traduit en jargon savant en parlant de la préséance nouvelle de la procédure sur la substance. De fait, un nouveau formalisme démocratique s’est inventé et se cherche. Que doit être en droit le processus démocratique ?
3. Rattrapage, enfin, en matière de droits cosmopolitiques, dans un monde en voie d’unification, (de « globalisation »), de rapprochement des États, d’abaissement des frontières, de mélange des populations. Comment penser les droits de l’homme à l’heure de la formation de quelque chose comme une société civile mondiale ? On ne peut plus se contenter, dans le domaine, du droit des nations entre elles, il faut envisager les droits des individus au milieu des nations. Droits des minorités, droits des individus par rapport aux États, dans l’espace international, droits de la société internationale des États sur les États particuliers qui la composent : toutes vieilles questions, mais auxquelles le mouvement du monde requiert aujourd’hui d’apporter de nouvelles réponses en droit.
Je n’ai envisagé, sous ces trois aspects, le travail de rattrapage, d’explicitation d’une légitimité latente, de fondation du nouveau sens commun démocratique, que sur le plan du contenu du droit. Mais je crois qu’on pourrait parler semblablement de rattrapage sur le plan de la formephilosophique de la problématique fondationnelle. Chez Rawls ou chez Habermas, il s’agit aussi de redéfinir ou de remplacer la problématique contractualiste (redéfinir chez Rawls, remplacer chez Habermas), par rapport à ses versions héritées. Il s’agit de repenser l’engendrement de la légitimité collective, résultant des droits des individus et consacrant ces droits, à la lumière des acquis critiques de la philosophie contemporaine vis-à-vis du grand rationalisme classique dans lequel cette problématique fondationnelle a pris sa première forme. Comment concevoir des droits subjectifs, c’est-à-dire des droits absolument inhérents à la personne, hors de toute référence à un état de nature ou à une nature humaine ?
Comment concevoir un contrat social sans passage d’un état de nature à un état social ? Faut-il sortir du cadre de référence centré sur l’individu, ou faut-il y rester ? Ne faut-il pas partir plutôt de l’intersubjectivité et de la communication, afin d’éviter l’illusion monologique ou égologique ? Il ne peut pas s’agir seulement d’actualiser la teneur du droit, il s’agit forcément en outre de rendre la philosophie du droit politique philosophiquement contemporaine, la difficulté ici étant de s’orienter au sein de ce que veut dire contemporain.
DU DROIT AU POLITIQUE
Encore une fois, ce n’est pas la société de demain qui s’invente dans ce retour aux fondements, c’est le présent qui s’éclaircit. Il ne se dessine rien comme une légitimité alternative à la faveur de cet effort d’élucidation; nous apprenons juste à être plus cohérents avec nous-mêmes. À la différence de l’âge héroïque où les abstractions des théoriciens faisaient surgir une autre façon de penser la politique, nous sommes dans une société où les droits de l’homme sont institutionnalisés dans leur rôle de fondement, de source et de référence. Ils sont d’ores et déjà pour partie incarnés; ils sont reconnus dans leur vocation à s’incarner toujours davantage. Il ne s’agit que de rendre ce travail de concrétisation plus judicieux et plus systématique.
D’accord, m’objectera-t-on, mais il y a toujours très loin de la promesse des principes à l’existence sociale effective. Les droits de l’homme ont beau être admis en théorie, leur réalisation reste un horizon infini. En quoi la philosophe du droit politique, même si elle n’a plus le pouvoir qui fut le sien de dessiner un autre monde, reste un instrument critique irremplaçable, un moteur, un idéal régulateur, voire notre dernière utopie.
Je ne songe pas à méconnaître cette capacité d’entraînement. Je crois cependant qu’on ne peut pas ne pas poser la question de ses limites, à la fois intellectuelles et pratiques. Jusqu’à quel point la logique du droit nous per-met-elle de comprendre la nature de la démocratie, c’est-à-dire du régime se proposant et autorisant la matérialisation progressive des droits de l’homme ?
Jusqu’à quel point cette logique du droit nous permet-elle, au-delà de la critique et de la protestation légitime, d’agir sur la démocratie pour la transformer ? Le problème crucial que soulève cette dynamique critique et utopique du droit, c’est qu’elle ne permet pas de penser ses propres conditions de réalisation. Le point de vue du droit ne permet pas de rendre compte du cadre où peut régner le droit. C’est ici qu’il faut passer au point de vue du politique.
Il est appelé par la mesure des limites des pensées de la fondation en droit.
Non seulement, ainsi, il y a résurgence du droit, mais il y a, dans son sillage, résurgence du politique. Un phénomène qui nous fait remonter encore une étape plus haut, historiquement parlant, vers la strate la plus profonde des assises de la modernité. Une certaine crise de la pensée selon l’histoire et la société nous a ramenés à la pensée selon le droit. De là, une certaine crise de la pensée selon le droit nous renvoie à la pensée du politique. Plus le point de vue du droit s’imposera, plus la nécessité de retourner, en deçà de lui, au point de vue du politique se fera sentir.
Le politique renaît à nos yeux comme problème sous l’effet des limites auxquelles se heurte ou que fait apparaître l’entreprise de fondation en droit.
Elle se révèle suspendue à l’intervention d’un principe qui lui échappe.
Elle suppose pour se déployer un socle qu’elle est incapable de concevoir par ses propres moyens. Elle demande en d’autres termes à être fondée. Il ne s’agit pas d’un problème théorique à l’usage des abstracteurs de quintessence. Il s’agit d’un problème tout ce qu’il y a de pratique, qui représente le foyer des incertitudes de la démocratie d’aujourd’hui. C’est en ce point très précisément que s’opère le passage au politique. Du droit politique, nous sommes renvoyés à la réflexion sur le politique comme ce qui rend possible la réalisation du droit tout en la limitant ou en la contraignant. C’est en ce sens que le retour au droit politique entraîne avec lui un retour au politique tout court, retour qui en constitue la critique au sens le plus fort du terme, puisqu’il revient à en fonder les prétentions, en même temps qu’à en limiter la pertinence.
C’est le lieu de dire quelques mots, avant d’entrer en matière, sur la distinction entre le politique et la politique. Je l’ai marquée et utilisée depuis le départ de mon propos, d’une manière, je l’espère, claire et rigoureuse, mais sans la définir. Le moment est venu de combler cette lacune. La distinction prend tout son sens dans une perspective historique. Toutes les sociétés comportent une dimension politique. Dans une seule société, la nôtre (avec l’exception relativement brève et très circonscrite des démocraties antiques), il s’est développé un domaine politique à part, où les acteurs sociaux ont la latitude de faire de la politique. Le domaine des libertés démocratiques où les citoyens se réunissent pour débattre de la chose publique et peser sur elle dans le cadre d’une compétition ouverte pour le pouvoir.
Je propose de réserver le politique à la désignation de l’essence politique de l’ensemble des sociétés humaines et de garder la politique pour désigner la spécificité de la politique démocratique, avec sa différenciation caractéristique d’un secteur à part des autres activités sociales, axé sur la formation et le contrôle des gouvernements. Nous pouvons dire dès lors : la politique est le visage que prend le politique dans notre société. La question étant de savoir si tout le politique est absorbé dans la politique démocratique, ou s’il n’y a pas du politique, ou une part du politique qui subsiste irréductiblement en dehors de la part remodelée sous l’aspect de la politique. En quoi la société démocratique, c’est-à-dire la société où le politique connaît ce formidable changement qui le fait devenir de la politique, l’objet et la matière de l’activité délibérative des citoyens, reste-t-elle néanmoins une société politique comme les autres ?
Poser ces questions revient à formuler d’une autre façon les interrogations auxquelles nous sommes aujourd’hui renvoyés à partir du droit. Car le domaine de la politique, domaine de la manifestation des opinions, du débat public, de la désignation des gouvernants par le suffrage, est également le domaine de l’application et de la réalisation du droit. L’activité politique est le moyen, tandis que le droit définit les fins que ces moyens doivent servir. On débat au fond, en démocratie, de la meilleure façon de concrétiser le droit, et l’objet civique de la théorie du droit politique est d’éclairer ce débat : quelles sont les bonnes manières de traduire dans les faits les normes fondatrices que nous reconnaissons ? Nous pouvons ainsi reformuler la question que je soulevais. Je demandais : jusqu’à quel point la politique démocratique absorbe-t-elle le politique ? Il est possible de convertir l’interrogation dans cette autre : jusqu’à quel point le droit (comme doctrine des bases et des fins de la politique démocratique) peut-il se soumettre le politique ? Voilà toute la question exposée sous nos yeux par la marche même de nos sociétés et qui est destinée à nourrir pour un bon moment la réflexion.
La leçon des totalitarismes
À dire vrai, il y a des antécédents à cette interrogation sur le politique.
Il ne serait pas exact de la faire procéder toute des questions de l’heure soulevées par la concrétisation du droit et des droits de l’homme. Elle reconnaît au moins un grand précédent dans notresiècle. La réflexion sur le politique a reparu d’abord à l’épreuve de la tragédie qui se noue en août 1914. Elle a resurgi sous l’effet de l’enchaînement des totalitarismes issus de l’apocalypse des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ce sont les tyrannies totalitaires qui ont réimposé, les premières, le point de vue du politique à la pensée. Elles représentent une résurgence brutale du politique à l’intérieur du monde « bourgeois », autrement dit, du monde libéral qui secondarise et subordonne le politique au profit des intérêts économiques et de la politique représentative. Ce retour violent du refoulé politique se manifeste sous deux visages opposés et complémentaires. Il prend l’allure, avec le nazisme, d’une ressaisie avouée, revendiquée, affichée du politique, sous son aspect le plus barbare, celui de la domination pure, ouvertement ancrée, qui plus est, dans la division raciale de l’humanité et destinée à s’épanouir dans la guerre. Tout au rebours, il prend les traits, avec le communisme soviétique, d’un retour dénié du politique, et d’un retour d’autant plus parlant qu’il est le fait du régime qui se réclame du primat de l’économie. Il s’apporte, en acte, le plus cinglant démenti à sa propre doctrine dont il soit possible de rêver. Le régime qui s’installe au nom du primat de l’infrastructure économique est le régime qui démontre par le fait le primat structurant de la supposée superstructure politique. L’appropriation collective des moyens de production, loin de déboucher sur le dépassement de l’exploitation capitaliste et de la domination bourgeoise, s’avère engendrer une nouvelle structure de domination politique dans laquelle l’extorsion économique se réintroduit à partir de l’organisation politique.
Le totalitarisme apparaît comme une forme politique irréductible à quelque explication économique que ce soit – on n’explique pas davantage le nazisme par les besoins du « grand capital », il ne paraît pas nécessaire de s’y étendre. Une forme politique pathologique, qui oblige en regard à repenser la démocratie libérale également comme une forme politique. Ce qui est pertinent, ce n’est pas l’opposition propriété privée/propriété collective, ou l’opposition capitalisme/socialisme, c’est l’opposition démocratie/totalitarisme, c’est-à-dire une opposition où le politique se révèle bel et bien premier et organisateur. En face du totalitarisme, la démocratie apparaît comme cette forme paradoxale où le politique est dissimulé dans son rôle premier et organisateur, au profit de la politique et de la primauté ostensible de la société civile et de ses intérêts. Le politique laisse jouer au premier plan d’autres forces que lui-même, de manière indépendante, à commencer par l’économie, au point de créer l’illusion d’optique que c’est l’économie qui prime, la politique selon la représentation se bornant à en réguler l’hégémonie. En réalité, le politique est toujours là dans une configuration où son rôle n’est plus prééminent. Mais c’est lui qui conditionne à l’arrière-plan le libre jeu de l’économie et des forces de la société civile, comme le fait ressortir par contraste son retour pathologique au poste de commandement dans les totalitarismes.
Telle a été la première leçon de politique que nous a infligée le XXe siècle, au prix fort. Tel a été le premier démenti, terrible, qu’il a apporté à notre intelligence spontanée de la chose politique, à notre manière immédiate de la comprendre, telles qu’elles découlent de la révolution historique du politique et de la secondarisation du politique par laquelle elle s’est traduite.
Leçon brutale, massive, démenti irréfragable. Leçon tellement scandaleuse, en même temps, pour nos cadres de pensée ordinaires, que le phénomène a pu rester cinquante ans sous le regard de tous sans être ni vu ni compris.
Si la leçon a fini par être tirée, c’est a minima, sur un mode purement pragmatique et moral. La liberté dite formelle est préférable, dans tous les cas, aux tyrannies bien réelles. C’est le message essentiel, je ne songe pas à en disconvenir. Mais ce n’est pas sans un certain vertige que l’on est obligé de constater, avec le recul, maintenant que l’affaire est jugée et irrévocablement jugée, que la leçon de fond de l’expérience totalitaire n’a pas pénétré.
Nous avons de bonnes raisons de penser que nous sommes sortis de l’âge des totalitarismes, ils font désormais l’objet d’une réprobation à peu près unanime, mais le souci de leur signification est resté ultra-minoritaire. Ils sont condamnés et bannis, mais ils resteront sans avoir été collectivement compris. Nous aurons vécu cette atroce épreuve d’une certaine manière pour rien – à moins que l’expérience ne se mette à faire l’objet, à retardement, d’une anamnèse et d’une élaboration rétrospectives. Cela laisse mélancolique et perplexe sur la capacité de nos sociétés à s’entendre elles-mêmes.
On ne peut s’empêcher d’y songer à l’heure où se dessine une seconde leçon de politique, d’un genre tout à fait différent, il est vrai, mais dont on se demande si nos sociétés seront mieux armées pour y faire face. À la lumière du passé, on est tenté d’en douter.
Un dévoilement par l’évanescence
Nous voyons reparaître aujourd’hui, en effet, le politique comme problème, sur un autre mode, aux antipodes de l’univers de la violence totalitaire. Il resurgit dans le moment et dans le prolongement du triomphe des principes démocratiques, en fonction même de cette victoire, par une suite imprévue du retour du droit. La redécouverte contrainte et forcée du politique à laquelle nous sommes de nouveau conduits s’effectue, ce qui la distingue heureusement de sa devancière, de l’intérieur des démocraties, au titre de la critique interne des illusions de la démocratie sur elle-même, et de la critique des dysfonctionnements inattendus que provoquent ces illusions.
C’est au titre de la recherche de ce qu’est véritablement la démocratie, de ce qui lui permet d’exister, de ce qu’elle peut devenir que s’impose ici et maintenant pour nous le retour à la question du politique. Il naît et il trouve sa nécessité dans la crise d’un genre nouveau vers laquelle se dirigent nos démocraties triomphantes. Rien à voir avec la contestation par l’extérieur de leur nature et de leur forme qu’elles ont connue à l’âge totalitaire, soit sous l’aspect d’un rejet passéiste, soit sous l’aspect de tentatives de dépassement futuristes. La crise s’insinue ici par le canal de la mise en œuvre des principes démocratiques eux-mêmes. Celle-ci s’avère déboucher, à un moment donné, sur une dévitalisation de la démocratie, si ce n’est, plus profondément, sur une dissolution de son cadre et de ses instruments d’exercice. Dans son mouvement d’expansion, dans le déploiement de ses principes de droit, la démocratie en vient à s’attaquer elle-même. En avançant, la concrétisation de ses normes de droit en vient à se retourner contre ses conditions politiques d’exercice; elle se met à les ronger insidieusement. Ce pourquoi, si la crise est sourde, diffuse, si elle est aussi éloignée que possible des paroxysmes de l’âge totalitaire dans ses expressions, elle n’en est pas moins d’une profondeur comparable dans son principe.
C’est l’analyse de cette crise en train de s’installer qui nous oblige à nous réinterroger sur le politique sous un angle où nous ne le connaissions pas. C’est ce problème interne à la démocratie qui définit l’actualité de la philosophie politique comme philosophie du politique. C’est autour de cette contradiction en train de se révéler entre la face visible et la face cachée de la démocratie, entre le droit dont elle se réclame et le politique qui la sous-tend, que la réflexion sur le politique va prendre pour un bon moment ses quartiers.
Ainsi rapportée au problème qui lui confère son actualité essentielle, la philosophie politique se trouve confrontée à deux grandes questions : la question d’abord de la nature de la démocratie, comme mixte de politique et de droit, mixte qui autorise et qui borne la réalisation du droit; la question, ensuite, de la nature du politique.
Il lui revient, pour commencer, de tirer de l’ombre ce que la démarche de fondation de l’ordre politique en droit laisse échapper, à savoir son propre fondement. Cela, ce n’est pas une déduction abstraite qui peut nous le livrer, mais l’analyse de notre situation concrète. Elle fait apparaître des données qu’aucune démarche théorique n’eût pu dégager par ses seuls moyens.
Au point où nous sommes du mouvement historique de concrétisation de notre droit fondateur – les droits subjectifs des individus –, au degré que nous avons atteint de la dynamique intrinsèque de ces droits, il apparaît une certaine contradiction entre droit et politique. Elle émerge à deux niveaux.
En premier lieu, cette poussée du droit rend le contenu de la démocratie problématique. Elle détermine une inflexion de la marche des démocraties dans le sens d’une démocratie minimale, d’une démocratie conçue comme coexistence d’individus, de groupes et de communautés tous libres de poursuivre leurs buts propres et garantis dans leur droit de le faire. L’objet de la démocratie, c’est l’organisation et la gestion du « pluralisme raisonnable », étant entendu que tout ce qui est fins substantielles est reporté du côté des individus et des groupes, le régime politique ne pouvant consister que dans l’aménagement du cadre et la définition des règles procédurales assurant la coexistence harmonieuse de cette pluralité de libertés. Or cette entente de la démocratie est unilatérale. Elle tend à nier une autre dimension nécessaire de la démocratie. Il est entendu que la démocratie est et doit être la gestion juridique de la coexistence et du pluralisme.
Mais elle est et doit être aussi autre chose. Elle est et doit être le gouvernement de la collectivité par elle-même dans son ensemble et pas simplement dans ses parties. Elle est et doit être autogouvernement de la communauté politique comme telle, sauf de quoi les prérogatives de droit des membres et des composantes de cette communauté se révèlent à terme illusoires. La démocratie des droits est une démocratie tronquée, qui perd de vue la dimension proprement politique de la démocratie; elle oublie le fait de la communauté politique, fait au niveau duquel se joue en dernier ressort l’existence de la démocratie. Nous en avons l’abondante vérification avec l’inexorable dessaisissement oligarchique dont se paie son progrès. L’installation du sujet individuel de droit dans la plénitude de ses prérogatives entraîne l’occultation du sujet politique collectif de la démocratie.
En second lieu, à un niveau plus profond encore, cette poussée du droit entre en collision et en contradiction avec ses conditions d’existence effectives. Elle se met à saper ses propres bases. Il y a, en effet, une utopie du droit, ou plus précisément une dynamique et une logique utopiques des droits de l’homme – l’utopie d’une juridisation intégrale et sans reste de l’espace social. L’utopie d’une résorption progressive des données du politique dans le droit. Pour aller au terme du mouvement qu’elle dessine, l’utopie que le pouvoir, les conflits, les frontières, les bornes et les contraintes de collectivités historiquement constituées, les nations, autrement dit, avec leurs États, se dissolvent peu à peu au sein d’une société civile mondiale de purs individus, sans politique ou sans autre politique que la gestion juridique de la coexistence des individualités et des particularités. La démarche de fondation en droit, poussée au bout, conduit paradoxalement à une crise des fondements de la démocratie, crise qu’on voit se dessiner et qui ne fait que commencer. En un certain point de son expansion, la logique du droit se retourne contre la forme politique qui a permis son déploiement. Elle aveugle la démocratie sur ce qui la rend possible, en la suspendant en quelque sorte dans le vide.
C’est par rapport à cette occultation et à cette menace d’autodestitution que la philosophie politique trouve aujourd’hui sa fonction civique en même temps que sa nécessité philosophique. Elle tire son interrogation primordiale de ce vertige intérieur qui retourne les démocraties contre leur support historico-politique et les ferme à l’intelligence à la fois de leurs bases et de leurs limites. Qu’est-ce qui a rendu les démocraties possibles ? L’évidence de leurs principes de droit tend à leur masquer la question, désormais, en les entraînant dans un processus d’autodestruction. Quelle mise en forme du politique a pu rendre concevables ces choses hautement improbables, à l’aune de ce dont les millénaires de l’histoire humaine nous offrent le spectacle : un pouvoir démocratisable, un pouvoir appropriable par la collectivité au lieu de s’imposer à elle, et un lien collectif individualisable, alors que ce que nous voyons fonctionner partout, c’est le lien contre l’individu, un lien qui précède et assujettit les personnes ? Comment est-ce qu’a pu se créer cette réalité que toute l’histoire qui nous précède ferait juger contradictoire dans les termes : un espace social et politique juridisable selon le droit des personnes ? Juridisable dans une certaine mesure, jusqu’à un certain point, le problème étant qu’il ne l’est pas intégralement, que le droit suppose autre chose que lui-même pour régner et s’incarner. Le droit transforme radicalement le politique et ses conditions d’exercice, mais il ne saurait se le soumettre entièrement; il n’est pas en mesure d’en faire son pur et simple instrument. Dans la démocratie, il continue d’y avoir du pouvoir, du conflit, de l’appartenance, toutes dimensions qui, par un côté, contre-disent la pure logique de la liberté et de l’égalité des individus, mais toutes dimensions hors desquelles, par l’autre côté, cette logique resterait sans théâtre d’application.
Il ne s’agit pas d’opposer tout uniment droit et politique, de contester la pertinence du droit au nom du politique. Il s’agit de comprendre l’articulation du politique et du droit. Il s’agit de saisir comment le politique peut porter l’expression du droit tout en la limitant. Il s’agit, en d’autres termes, d’établir la pertinence du droit, en éclaircissant les conditions qui ont permis cette chose extraordinaire, la juridisation du lien social sur la base des droits subjectifs des individus. Que suppose dans le registre du politique l’installation des droits de l’homme comme source et norme des rapports entre les personnes ? Mais établir de la sorte la possibilité de la fondation de l’ordre politique en droit, c’est aussi devoir critiquer les effets de méconnaissance qui en sont inséparables, devoir définir les limites à l’intérieur desquelles cette démarche de redéfinition en droit est susceptible de s’appliquer.
La nature de la démocratie
Double interrogation, donc; une interrogation d’abord sur le politique historiquement constitué tel que nous le rencontrons dans notre monde et tel que nous sommes portés à le redécouvrir à la base de la démocratie; une interrogation, ensuite, sur le politique en général, au-delà ou en deçà des mises en forme au travers desquelles nous l’appréhendons.
Quelle est la forme du politique qui correspond à la démocratie ? Comment caractériser la forme extrêmement particulière de communauté politique à l’intérieur de laquelle a pu apparaître la démocratie ? En d’autres termes, quelle est la forme du politique qui permet la constitution de la politique ? La constitution de la politique, cela veut dire la formation d’un pouvoir appropriable par la communauté politique, d’un pouvoir en lequel la collectivité peut se projeter et se reconnaître, à l’opposé de la formule des anciens pouvoirs qui se présentent et s’exhibent sous le signe du dissemblable et de l’hétéronomie. Mais la constitution de la politique passe en outre par l’apparition d’une autre forme du lien politique autorisant la participation des acteurs-citoyens à cette compétition pour le pouvoir, un lien politique individualisé, c’est-à-dire un lien dont les termes liés sont posés antérieurement au lien, de telle sorte que le lien ne peut procéder que de leur volonté de se lier, au rebours là encore de ce qu’on observe à travers toute l’histoire, qui nous montre le lien posé avant les termes liés, et s’imposant à eux, sans qu’ils aient prise sur sa teneur. Le contenu du lien tombe d’avant et du dessus. Les acteurs existent parce qu’ils sont liés, d’un lien qui les précède et les englobe. Nous autres nous posons au contraire qu’ils existent d’abord et qu’ils se lient ensuite. Ils naissent libres et également libres, selon la formule des droits de l’homme, en conséquence de quoi le lien qui les unit ne peut procéder que de leur libre volonté. Qu’est-ce qui a pu permettre l’émergence d’une telle formule du lien social ?
Si l’on interroge cette émergence, sous l’angle du politique, il faut répondre : ce qui a permis l’apparition de cette liberté à l’intérieur du lien des hommes, c’est en fait la possibilité d’un lien plus profond dans l’implicite. Ils sont liés de fait, ils sont tenus ensemble, mais d’une manière qui ne leur apparaît pas, qui ne les contraint pas directement, de telle sorte qu’ils disposent d’une marge de manœuvre pour définir leurs rapports dans l’explicite, selon le droit. Nous sommes amenés à concevoir une forme du politique où le politique se cache, ou passe au second plan, de telle manière qu’il libère très réellement un espace pour la politique au premier plan. Les citoyens sont liés d’un lien invisible qui leur laisse la liberté de définir leurs rapports en conscience, comme s’ils n’étaient pas liés au départ, dans la limite où cette définition explicite n’entame pas la réalité de leur lien implicite. De la même façon, le pouvoir dans la démocratie reste un pouvoir à l’instar de ce qu’il a été dans les sociétés antérieures, avec cette différence que, tout en restant cela, il se présente tout autrement. Il se donne comme un pouvoir appropriable, avec la liberté de l’établir, d’en désigner les titulaires et d’en définir explicitement les missions, comme s’il s’agissait à chaque fois de le constituer. Mais dans la limite, en réalité, où cette opération instituante n’entame pas sa réalité de pouvoir.
Nous apprenons quelque chose d’essentiel sur le politique à partir de la manière des plus surprenantes qu’il a de se présenter dans notre monde.
Loin de représenter une réalité invariante se donnant selon des lois univoques, il est une réalité éminemment plastique, puisque nous le rencontrons sous une forme paradoxale où, au lieu de peser de manière directe et expresse, il se dissimule en laissant libre cours à de la politique dont le mode de déploiement, jusqu’à un certain point, le contredit. Un paradoxe que nous retrouvons dans la formule de composition de notre société : une société d’invididus, c’est-à-dire une société qui prend le risque ou qui se paie le luxe de ne pas se présenter comme une société une, cohérente, supérieure à ses membres, à l’exemple de toutes celles qui l’ont précédée dans l’histoire, une société qui met en avant la déliaison de ses membres, mais qui n’en reste pas moins, à un niveau profond, implicite, une société. La particularité inouïe de notre forme de société et de notre forme de communauté politique réside dans ce dédoublement entre le dire et le faire, entre le politique implicite et la politique explicite. C’est la condition de notre liberté en même temps que sa limite.
Le problème de la démocratie apparaît ainsi, historiquement, comme le problème de l’installation de cette forme de communauté politique où le politique passe dans l’implicite en libérant un espace de la politique explicite. Cela nous renvoie à la révolution religieuse et métaphysique du politique des XVIe et XVIIe siècles où s’est inventé, avec « l’État » en possession de son concept, le corps politique moderne.
Le problème de la démocratie apparaît d’autre part, auprésent, comme le problème du mixte entre le politique et la politique – la politique comme le domaine de la réalisation du droit – qui se réalise en elle à tous les moments.
Comment est-ce que s’articulent sa part visible et sa part cachée ? Il ne s’agit pas simplement de faire une théorie réaliste de la démocratie qui s’opposerait à l’idée consciente que la démocratie se fait d’elle-même ou aux principes dont elle se réclame. La tâche, autrement subtile, est d’élaborer une théorie de la démocratie capable de rendre compte de ce qu’elle se raconte et de la validité effectuante de cette idée qui modèle dans une mesure toujours plus large la réalité de nos régimes. Mais une théorie capable, simultanément, d’articuler cette part revendiquée avec une autre part, dissimulée celle-là, qui à la fois porte et contraint la part consciente. Une théorie véritablement réaliste de la démocratie est une théorie qui intègre ensemble les réalités coexistantes, conniventes et contradictoires du droit et de la politique.
Il est possible d’exprimer l’idée autrement encore, dans une perspective comparative. Penser la nature de la démocratie sous l’angle du politique, c’est devoir penser deux choses en même temps. C’est penser à la fois ce qui la différencie de toutes les formes politiques qui l’ont précédée, et ce qui l’apparente néanmoins à l’ensemble des formes politiques connues.
C’est penser la transformation du politique qui le fait devenir en grande partie de la politique et qui ce faisant l’ouvre à une juridisation toujours plus poussée, à une redéfinition en droit toujours plus exigeante et plus approfondie. Mais une transformation du politique qui ne l’empêche pas, toute-fois, de rester au fond ce qu’il fut dans l’ensemble des sociétés connues.
La nature du politique
Dernière question, après la question de la nature de la démocratie, la question de la nature du politique lui-même. Qu’est-ce que le politique, tel que le mouvement récent des démocraties le donne à interroger sous un jour où nous ne le connaissions pas ? Un jour qui n’annule pas les précédents éclairages sous lesquels il s’est donné à voir, mais qui s’y ajoute pour déplacer le regard que nous pouvions jeter sur lui et peut-être le rendre plus perçant.
La difficulté consiste en ceci qu’il n’est pas possible, pour cerner le politique et son rôle, de se contenter des critères habituels permettant de circonscrire un secteur particulier de l’expérience sociale – un système différencié des autres systèmes ou sous-systèmes sociaux par ses critères spécifiques, pour parler comme Luhmann, comme l’économie par exemple, ou la science, ou encore l’éducation. Car la vérité est qu’il y va au travers de ce domaine particulier de ce qui permet à quelque chose comme une communauté humaine d’exister, et à des hommes de se constituer comme hommes à l’intérieur de cette communauté. Pour le dire d’un mot très lourd, mais qui est le plus approprié : l’enjeu du politique est transcendantal.
Il nous est demandé de retrouver d’une certaine manière le point de vue des anciens. Le politique est ce qui organise les communautés humaines en dernier ressort. Nous pouvons même franchir un pas de plus en risquant une proposition qui n’eût pas eu de sens pour les anciens : le politique est ce qui permet à une communauté humaine de tenir ensemble. Mais le problème est que nous ne sommes plus dans le monde des anciens. Nous ne vivons plus sous le signe du primat explicite du politique, et nous ne pouvons pas faire comme si tel était le cas, en nous réfugiant dans une sorte d’exil anachronique par rapport à notre temps. Nous avons à être modernes, en nous gardant de croire que nous pouvons ne pas l’être à volonté. Nous avons à sauver quelque chose de l’intelligence ancienne du politique dans un monde où le politique a irrémédiablement l’allure d’un phénomène secondaire et dérivé. Il l’a par structure, en raison de ces dimensions constitutives de l’ordre social que sont les droits reconnus aux individus et, corrélativement, l’indépendance de la société civile que les individus sont reconnus libres de former entre eux. Non seulement la société civile s’organise en dehors de l’État, à l’abri de la subordination politique, mais elle est première, du point de vue de l’ordre politique : l’État est au service de ses fins. Il n’a de consistance légitime que celle qu’il tire de la représentation de la liberté des citoyens et des intérêts organisés au sein de la société civile. Il ne s’agit pas que d’un principe : c’est la donnée structurante de notre monde. Elle peut permettre de conclure qu’il n’y a plus de politique, que le politique n’existe plus, qu’il n’y a plus que de la politique. Il y a des auteurs pour franchir le pas, comme Luhmann, justement, par exemple. C’est une illusion d’optique, à mon sens, mais une illusion pleine de sens qui repose sur une part importante de réalité, qu’on ne peut songer à nier.
La juste appréciation consiste à dire : le politique est dissimulé dans la politique, il y a du politique caché dans et derrière la politique. Nous sommes dès lors soumis à une double obligation : l’obligation, d’un côté, de rendre compte de ce fait que nous ne pouvons songer à récuser, la métamorphose bien réelle du politique dans la politique, et l’obligation, de l’autre côté, d’expliquer que le politique, au-delà de la politique, reste instituant, de manière invisible ou implicite. Il reste instituant sans être déterminant, en tout cas de manière ouverte. Il ne dicte pas sa loi à la communauté politique.
La grande nouveauté du moment où nous sommes, par rapport aux problématiques antérieures, réside dans cette dissociation entre institution et détermination, que nous devons assumer jusqu’au bout. Dans les totalitarismes, précisément, le politique redevient déterminant. Sur ses confins, il est révélateur de voir un auteur comme Carl Schmitt dénoncer la « dépolitisation » libérale-bourgeoise au nom d’une expérience où le politique redevient déterminant, à savoir la guerre, étrangère ou civile, dans la tension de laquelle se dissout l’illusion de la politique. La démystification prétendue égare, en réalité, comme souvent, en confondant la suspension d’un ordre de phénomènes avec son inconsistance intrinsèque. Nous avons à reconnaître toute sa réalité à la politique, en tant que transformation du politique, tout en reconnaissant le rôle spécifique du politique. Il n’est pas, il n’a plus à être ce qui commande l’ordre de la communauté, il est ce qui l’institue, ce qui lui permet d’exister comme communauté. Il ne lui dicte pas sa manière d’être, il la fait être. Il existe, du reste, un fait d’expérience massif, au sein de notre monde, qui est de nature à nous mettre sur la piste de ce politique devenu impensable alors que nous en avons une attestation gigantesque sous les yeux. Il n’est que de songer à l’anomalie flagrante que représente la croissance de l’État dans le monde libéral. Pourquoi le pouvoir n’a-t-il jamais été aussi étendu, aussi prosaïquement puissant que dans le monde où le politique passe à l’arrière-plan ? Parce que dans cette société qu’il ne domine plus, il n’en remplit pas moins un rôle instituant. Il ne le remplit plus sur le mode ostentatoire qui s’attachait à son ancienne fonction d’ordre; il le remplit en secret au travers de ses fonctions matérielles de service envers la collectivité.
Ce vers quoi nous mène cette manière de comprendre la place et le rôle du politique, je l’ai suggéré, c’est ni plus ni moins une réactivation de la question transcendantale sur un autre terrain que celui où nous sommes accoutumés à la rencontrer et où elle s’est d’abord formulée. Elle s’est imposée d’abord dans le registre de la connaissance : qu’est-ce qui nous permet de connaître et jusqu’à quel point pouvons-nous connaître ? Nous la retrouvons ici dans un tout autre domaine d’expérience : qu’est-ce qui permet à une communauté humaine d’exister et de tenir ensemble, compte tenu du fait que cette cohésion n’est ni de l’ordre d’une donnée de nature, ni de l’ordre d’une création délibérée, même si elle comporte des traits des deux ?
Qu’est-ce qui autorise une société à exister, de telle sorte qu’elle devienne une société de personnes, dotées d’une disposition d’elles-mêmes qui interdit de jamais les réduire aux parties d’un tout, mais de telle sorte aussi que cette société ait globalement et collectivement prise sur elle-même ? Le politique est seul à même de fournir la réponse à la question.
Pour conclure en suggérant une voie d’approfondissement sous forme d’une proposition abrupte : l’humanité est politique en ceci qu’elle se présente toujours et partout sous l’aspect d’une pluralité de communautés autonomes. Ce dernier mot est pour désigner le fait que ces communautés ont à se définir les unes par rapport aux autres, en même temps que le fait qu’elles ont intérieurement puissance sur elles-mêmes. Elles s’appliquent à elles-mêmes, elles s’organisent elles-mêmes, non pas de manière délibérée et consciente, mais de manière processuelle. Le politique consiste dans les dimensions spécifiques par lesquelles passe cette autonomie processuelle.
Il en existe au moins trois : le pouvoir, le conflit, la norme. Trois dimensions qui font que les communautés humaines, à la différence des sociétés animales, possèdent une disposition pratique d’elles-mêmes, se réfléchissent en acte et se gouvernent processuellement. Elles disposent d’elles-mêmes et se gouvernent infrastructurellement, inconsciemment, même lorsque c’est pour se dénier cette capacité, comme ce fut le cas sur la plus longue durée de leur histoire au travers de la religion. Nous pouvons définir celle-ci, dans cette perspective, comme l’usage de l’autonomie processuelle pour poser l’hétéronomie explicite. Car c’est encore une façon de disposer de soi, ô combien, que de poser qu’on ne dispose pas de soi, que c’est à d’autres, ancêtres ou dieux, antérieurs et supérieurs, qu’on doit d’être ce qu’on est. Mais aussi bien, dans l’autre sens, cette autonomie processuelle est-elle ce qui peut fonder la volonté explicite de l’autonomie. Elle apporte un support effectuant à l’ambition démocratique, aux antipodes du renoncement religieux. Le péril devenant dans ce nouveau cadre, où nous avons basculé depuis peu, que la poursuite explicite de l’autonomie, au travers de la politique, ne se retourne contre ce qui la rend possible, l’autonomie processuelle assurée par le politique. Tel est exactement le point où nous sommes parvenus, point à partir duquel le politique se donne à concevoir en fonction de son recouvrement et de son oubli.
Un dernier pas, dans la ligne de ces suggestions : la question transcendantale relativement à ce qui permet à de l’être-ensemble d’exister se confond ultimement avec la question de ce qui permet à quelque chose comme un être-soi d’advenir et de fonctionner. Nous sommes des personnes parce que nous vivons dans des communautés politiques. Les dimensions qui produisent la disposition de soi au niveau collectif ont leur pendant, au niveau individuel, dans les structures qui donnent chacun de nous à lui-même. Ce ne sont pas les mêmes, mais elles sont du même ordre et elles s’articulent.
Le politique est le correspondant, à l’échelon de l’être-ensemble, de ce qui constitue l’être-soi, en procurant à la personne sa possession réfléchie et sa détermination irréfléchie d’elle-même. La réflexion sur le politique est un moment dans une anthropologie transcendantale plus vaste.