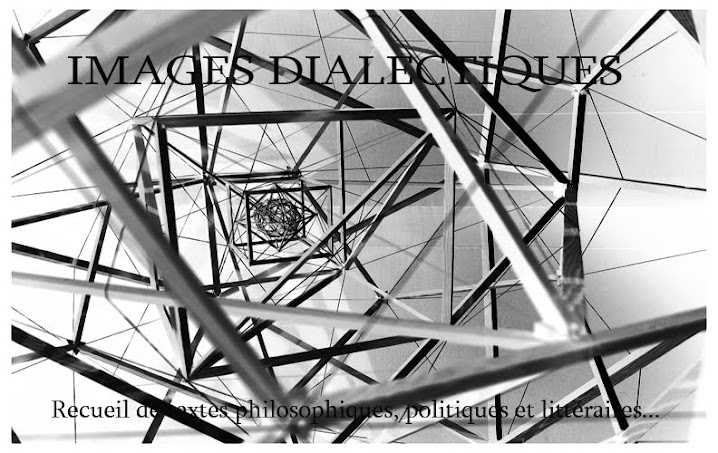Subsidiarité
par Julien Barroche
En première approximation, la subsidiarité peut se définir comme une règle de proximité : tout ce que les individus, seuls ou en groupe, peuvent accomplir par eux-mêmes, ne doit pas être transféré à l’échelon supérieur. Pourtant, cette simple proposition, dans son apparente limpidité, n’épuise pas le sens du mot subsidiarité. Utilisé le plus souvent dans l’expression « principe de subsidiarité », il dispose d’un fort pouvoir d’intimidation, qui décourage toute tentative de définition de la chose. Un moyen efficace, pour la théorie politique, de surmonter cette difficulté est d’avoir recours à l’histoire sémantique : quels sont les différents contextes d’apparition du mot ? Que disent-ils de la chose ? Pour répondre à ces questions, la reconstitution d’une généalogie lexicologique peut permettre, d’une part, d’identifier les diverses significations qu’on impute au terme « subsidiarité » et, d’autre part, de dégager des propriétés communes parmi toutes les occurrences du mot.
I. Dans la langue française, l’adjectif « subsidiaire » et l’adverbe « subsidiairement » sont anciens (les lexicologues les datent respectivement de 1355 et 1536). Les deux mots sont issus d’une même racine latine – sub (sous) et sedere (être assis) – qui a donné le nom subsidium et l’adjectif subsidiarius. Dans le langage militaire romain, les subsidiarii étaient les troupes de réserve dont on ne se servait pas en temps normal, qui constituaient un appoint en cas de défaillance exceptionnelle et pour la seule durée de cette défaillance (en français, on parle plus couramment de supplétifs). Le substantif « subsidiarité » est, quant à lui, tout à fait récent ; son année de naissance varie selon les grandes langues occidentales, mais les spécialistes s’accordent à la situer au XXe siècle. Comme l’indique la distance chronologique, un saut s’opère dans le passage du qualificatif au substantif, qui ne doit pas faire croire à une simple évolution endogène et naturelle du vocable. Le mot subsidiarité dispose en effet d’une vie propre dont il faut s’attacher à cerner les contours.
À considérer l’histoire du mot expressis verbis, le mieux est peut-être d’embrasser d’abord l’itinéraire par ses deux extrémités afin de mettre en regard point de départ et point d’arrivée. Tout commence, dans les années 1930, en 1931, avec l’encyclique Quadragesimo anno promulguée par le pape Pie XI (1857-1922-1939) pour célébrer le quarantième anniversaire de Rerum novarum (1891). Le syntagme latin "subsidiarii" offici principio est alors très loin de résumer le cœur même du texte pontifical ; il n’en est qu’un élément parmi d’autres, mais ses conditions de naissance sont déterminantes pour comprendre son contenu. Cette matrice originelle aide à mieux saisir l’archéologie de la notion. Car il ne faut pas se contenter d’une sémantique contextuelle, il faut y ajouter une archéologie ou génétique du sens. Ici, en cette période troublée de montée des totalitarismes et de tensions grandissantes entre Mussolini et le Vatican, le pape tient précisément à rappeler l’importance du message de la doctrine sociale telle qu’elle a été mise à l’honneur par Léon XIII (1810-1878-1903), initiateur du renouveau thomiste : l’État doit laisser vivre les corps intermédiaires à l’œuvre dans la densité sociale et respecter le domaine propre des personnes (Nell-Breuning, 1990). Il n’a pas à agir mais à régir, c’est-à-dire à contrôler, à réglementer et à promouvoir, tout en intervenant chaque fois que les personnes, seules ou en groupe, sont défaillantes, selon l’idée – naturaliste – d’une complémentarité organique des différentes communautés (Utz, 1970).
Certes, l’époque contemporaine n’a vraisemblablement pas oublié cette signification première de la subsidiarité ; force est pourtant de constater qu’elle entre en concurrence directe avec une autre acception, celle du droit communautaire européen, dont les propriétés communes avec la précédente sont tout sauf évidentes. L’expression « principe de subsidiarité » est entrée dans le répertoire juridique de l’Union européenne par touches successives. C’est néanmoins le traité de Maastricht en 1992 qui l’élève véritablement au rang de règle positive destinée à régir la répartition des compétences partagées entre les États membres et la Communauté ; cette dernière ayant une compétence dite subsidiaire, à savoir que son intervention n’est requise que si « les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante et peuvent […] être mieux réalisés au niveau communautaire » (article 5 du traité de Maastricht). Au-delà des ambiguïtés contenues dans la formulation même du texte – tension entre efficacité politique et proximité démocratique, contradiction entre efficacité relative (« suffisante ») et efficacité maximale (« mieux ») –, la nature proprement juridique du principe de subsidiarité a été très discutée (Dehousse, 1992 ; Estella, 2002). Si l’on examine, en effet, le contexte de la rédaction du traité, il apparaît clairement que le contenu de la subsidiarité n’est pas tant juridique que politique : c’est-à-dire signifier aux eurosceptiques et aux Länder allemands que la Commission n’entend pas s’immiscer sans motifs dans les affaires internes des États, tout en préservant – là réside le paradoxe – les conditions de possibilité d’un éventuel fédéralisme européen (Constantinesco, 1991).
II. Pour débrouiller cet écheveau complexe de significations et dépasser ce simple constat phénoménologique d’une polysémie somme toute très ordinaire, il faut retracer l’itinéraire du mot entre ces deux points. C’est que la signification de la subsidiarité n’est pas à rechercher dans l’essence propre d’un concept, mais dans ses usages nécessairement divers et contrastés. Trois étapes peuvent à cet égard être identifiées.
1. Le catholicisme et le fédéralisme allemands tout d’abord. De nombreux exégètes du texte de Quadragesimo anno ont insisté sur le rôle joué par le père Oswald von Nell-Breuning (1889-1991) dans la rédaction de la première version de l’encyclique qui a servi de support au travail pontifical. Membre du groupe d’économistes de Köningswinter, Nell-Breuning incarne un courant majeur de la tradition jésuite allemande, héritière du solidarisme de Heinrich Pesch (1854-1926) et fortement inspirée par la figure tutélaire de Mgr Emmanuel von Ketteler (1811-1877) – chez qui Léon XIII a voulu voir son précurseur et sous la plume duquel on peut lire dès le XIXe siècle l’expression prémonitoire subsidiäre Recht/droit subsidiaire (Millon-Delsol, 1992). Les linéaments du principe dégagé en 1931 sont ainsi posés dès le milieu du siècle précédent, alors qu’on assiste sur le plan intellectuel à une restauration ou un réinvestissement du thomisme. Parce que le mot subsidiarité charrie avec lui un idéal qui rejoint en tous points le modèle germanique du Moyen Âge, la notion trouvera à s’épanouir très facilement outre-Rhin. Ketteler, évêque de Mayence, apologiste du catholicisme rhénan, avait abondamment parlé de cette rencontre du christianisme et du génie allemand. C’est à ce carrefour qu’émerge le mot. Aussi, analyser les conditions de naissance de la subsidiarité suppose avant tout de comprendre ce qu’elle doit à l’Allemagne catholique du XIXe siècle.
D’abord issu d’une matrice spécifiquement catholique, le vocable s’est ensuite greffé sur l’ancienne tradition du fédéralisme allemand (Isensee, 2001), notamment remise à l’honneur par Otto von Gierke (1841-1921), le célèbre théoricien du droit associatif. Peu à peu, en effet, le mot sort de son contexte catholique d’origine pour être utilisé par la doctrine juridique allemande, en dehors même des cercles chrétiens. Héritière des constitutionnalistes du XIXe siècle, elle voit là l’expression d’un retour salvateur à une expérience politique ravagée par le nazisme. Aussi n’est-il pas étonnant qu’après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les Allemands cherchent à refonder leur expérience politique, la discussion sur le fédéralisme fasse une place importante au thème de la subsidiarité. Pour autant, le mot n’est pas utilisé par les rédacteurs de la loi fondamentale de 1949 en raison de son enracinement trop marqué dans la tradition catholique. Le terme ne fait d’ailleurs son entrée dans le droit positif qu’avec la révision constitutionnelle consécutive au traité de Maastricht, en 1992 (article 23-1). Il est longtemps resté confiné dans un cercle de spécialistes imprégnés de doctrine catholique pour ensuite pénétrer plus largement le débat européen.
2. La doctrine sociale de l’Église telle qu’elle est exposée dans les textes officiels et le moment conciliaire de Vatican II (1962-1965) ensuite. Classiquement écrite en latin comme la plupart des textes catholiques qui s’adressent au monde, Quadragesimo anno a fait l’objet de traductions dès 1931. Alors que le latin "subsidiarii" offici principio est traduit en allemand par Subsidiaritätsprinzip, la langue française, faute disposer du substantif subsidiarité, l’assimile à la notion de supplétivité (principe de la fonction supplétive). Il faudra que le mot subsidiarité se diffuse d’abord en Allemagne et en Suisse pour qu’il soit ensuite progressivement consacré dans la langue française, et 1992 pour voir la subsidiarité faire son entrée officielle dans les dictionnaires français. Même en s’en tenant au français et à l’anglais, il est quasiment impossible de dater l’apparition du mot de manière certaine ; pour autant, quelques éléments tangibles ont leur importance. D’après les dictionnaires usuels, subsidiarity apparaît dès 1936, et l’année n’est pas innocente dans la mesure où on le trouve sous la plume de théologiens allemands qui ont fui le nazisme aux Etats-Unis. Quant à son équivalent français, il découle lui aussi directement de la pensée catholique allemande via la Suisse où on le trouve dès le début des années 1950. Il faut cependant attendre la fin de la décennie pour voir figurer le mot subsidiarité d’abord sous la plume de partisans du fédéralisme intégral en Europe, et le début des années 1960 pour qu’il soit repris par des théologiens catholiques plutôt progressistes.
Vatican II marque un moment important dans l’histoire du mot. La revendication d’une subsidiarité ecclésiale se fait alors très fortement ressentir et va d’une certaine manière présider aux grands débats discutés lors du concile (Legrand et al., 1988) : défense d’une théologie de l’Église locale, insistance sur le rôle des évêques et des conférences épiscopales, appel à une plus grande collégialité, critique du centralisme romain et du poids de la Curie dans la prise de décision au sein de l’Église. Il reste que le mot n’apparaît dans les documents conciliaires qu’appliqué aux rapports État/société dans la continuité de Quadragesimo anno et non sur les questions ecclésiologiques du rapport entre Églises locales et Église de Rome. D’où ce paradoxe souvent relevé : pourquoi l’Église catholique ne veut-elle pas s’appliquer à elle-même un principe qu’elle considère pourtant comme fondamental et indépassable pour la structuration de toute vie sociale ?
3. Le discours des analystes et des acteurs politiques enfin. La diffusion complète du mot doit principalement à la construction européenne. La culture démocrate-chrétienne des élites européennes a beaucoup contribué à faire de ce mot une base de dialogue et de consensus culturel. Si, à partir de la fin des années 1950, la thématique de la subsidiarité est surtout l’apanage d’une certaine littérature militante sur le fédéralisme européen (Denis de Rougemont, Alexandre Marc, Guy Héraud, Henri Brugmans, Bernard Voyenne), c’est depuis 1992, effet de la construction européenne oblige, que le mot subsidiarité est utilisé plus largement – et non dans les seuls cercles militants – par les observateurs du système politique de l’Union européenne, qui, nécessairement amenés à reprendre les termes du droit positif communautaire, débattent de la justiciabilité du principe de subsidiarité comme règle de répartition des compétences entre le niveau européen et le niveau national. Pour autant, le mot n’en reste pas moins marqué par la période antérieure : chez de nombreux juristes et politistes, faire référence au principe de subsidiarité, c’est avant tout marquer son engagement en faveur du fédéralisme européen. De là, une intrication problématique entre registre descriptif et registre normatif. Aujourd’hui, le terme assume de plus en plus la fonction de catégorie descriptive, à tel point que, même en l’absence de textes juridiques officiels faisant expressément mention du vocable, les politistes n’hésitent plus à l’invoquer dans leurs analyses, sans nécessairement prendre le soin de préciser sa portée explicative. La subsidiarité peut alors servir aux spécialistes des politiques publiques et de l’administration locale pour interpréter les dynamiques de territorialisation en cours. C’est le sens qui a été donné en 2003 au nouvel article 72-2 de la constitution de la Ve République.
De manière concomitante, la philosophie de provenance chrétienne a continué d’utiliser le terme. Dans une perspective s’efforçant de marier conservatisme social et libéralisme économique, des auteurs invoquent par exemple la subsidiarité comme un argument spécialement dirigé contre l’Etat-providence et parfois contre l’Etat lui-même, toujours soupçonné de vouloir étendre son emprise sur la société. Dans les années 1980, la thématique subsidiariste a été réinvestie par des penseurs plus explicitement libéraux et/ou conservateurs qui voient dans la subsidiarité le sens même de la pensée d’un John Stuart Mill ou d’un Alexis de Tocqueville. A l’opposé, on trouve la tendance personnaliste-sociale voire socialiste, qui, invoquant Emmanuel Mounier, fait se rencontrer la subsidiarité (importance des communautés naturelles, des corps intermédiaires, protection de la personne contre les prétentions omnipotentes de la puissance publique) et certains thèmes classiques du socialisme chrétien : l’autogestion et la démocratie de proximité. Si le mot subsidiarité est utilisé de manière très parcimonieuse dans les cercles de la « deuxième gauche », l’indice est bel et bien là d’une sorte de consensus par recoupement entre le discours chrétien, le discours socialiste et le discours libéral, qui tend à réinvestir l’idée de nature, contre celle – suspecte – de volonté politique, en donnant à la thématique originellement conservatrice de la subsidiarité toutes les apparences du progressisme.
III. Comment à partir de cette histoire sémantique dégager les propriétés communes de la subsidiarité dans le champ de la théorie politique ? Il convient vraisemblablement d’assumer le caractère flottant de la définition qui en découle. Car, en définitive, il s’avère que la subsidiarité a plus tendance à identifier des problèmes qu’à leur donner des réponses précises. Quelles sont, alors, les questions que pose la subsidiarité, les enjeux politiques qu’elle soulève ? Il semble possible d’en répertorier trois principaux (Delpérée, 2002).
1. La question du rapport entre État et société (subsidiarité horizontale et/ou fonctionnelle). La subsidiarité ne répond pas définitivement à cette question et autorise deux réponses selon la configuration : l’ingérence de l’État si l’action des personnes ou des communautés est insuffisante (subsidiarité positive) ou la non-ingérence de l’État si elle est suffisante (subsidiarité négative). La détermination de cette suffisance (ou insuffisance) réclame un critère – à défaut d’instance tierce apte à décider –, celui naturaliste du bien commun. Certes, l’État doit intervenir chaque fois que nécessaire, mais il n’est pas maître de cette nécessité, encore moins de ses critères qui trouvent leurs fondements dans la nature. Par là, la subsidiarité ne fait pas que souligner l’importance des corps intermédiaires, elle rappelle la puissance publique laïque à son statut second et supplétif. D’où un anti-volontarisme qui réagit au positivisme du droit moderne. Pour autant, la subsidiarité ne voit pas dans la cité une seule fonction de suppléance, un mal nécessaire, elle y voit aussi un supplément d’être, selon une perspective qui rappelle Aristote. La subsidiarité ne se réduit pas à une philosophie de la personne qui défend ses attributions naturelles contre les empiètements des pouvoirs publics, elle est aussi une philosophie de la communauté (D’Onorio, 1995). Mais, dans le moment même où l’Église catholique s’est plus ou moins ralliée aux droits de l’homme, la subsidiarité a subi une reformulation qui, subrepticement, l’a fait glisser du naturalisme ancien au jusnaturalisme moderne.
La question du rapport Etat/société est au fondement même du contexte d’apparition du mot. Si cette innovation sémantique n’apporte en définitive rien de véritablement nouveau à la pensée pontificale – déjà bien constituée en 1931 –, elle révèle cependant une préoccupation nouvelle à l’heure où sévissent le communisme et le fascisme : l’hostilité vis-à-vis du politique. Il ne suffit pas de démontrer que la subsidiarité est née des totalitarismes ; il faut considérer en quoi elle conserve la marque indélébile de ses conditions de naissance. Où la mémoire du mot resurgit : en condamnant les excès de la souveraineté étatique, la subsidiarité invite, d’une certaine manière, à considérer le volontarisme de l’Etat moderne à travers le seul prisme du totalitarisme, à qui il reviendrait d’avoir révélé et confirmé la nature profondément maligne de la politique. Au rebours du principe de souveraineté, le principe de subsidiarité s’attache en effet à affirmer le caractère prioritaire des droits et des capacités des personnes sur les structures de pouvoir, sur les institutions organisatrices de la vie en société, donc le caractère second des institutions publiques. En ce sens, l’hypothèse peut être avancée que l’Etat subsidiaire serait le paradigme de la sortie de l’Etat totalitaire, figure ultime de l’Etat souverain.
2. La question du rapport des différents niveaux de décision au sein même de la puissance publique (subsidiarité verticale et/ou territoriale). La confusion est ici souvent de mise entre subsidiarité, fédéralisme et décentralisation ; confusion qui a tendance à réduire la subsidiarité à une simple présomption de compétence en faveur de la plus « petite » entité (Stadler, 1951 ; Nell-Breuning, 1990). D’un point de vue théorique, cette interprétation est doublement contestable. 1°, la décentralisation suppose un centre qui, selon une logique descendante, consent à la délégation de certaines compétences à des échelons inférieurs (qui dépendent directement de lui). La hiérarchie prime alors, et n’est pas sans rappeler le vieil adage de minimis non curat praetor. 2°, la subsidiarité s’inscrit, elle, dans un autre paradigme – ascendant plus que descendant – qui trouve à s’éclairer s’éclairer eu travers de la notion théologique de périchorèse, comprise comme immanence réciproque. Notion par laquelle la religion catholique souligne la présence des trois personnes divines l’une dans l’autre ou par laquelle il est rappelé, notamment depuis Vatican II, la présence de l’Église locale dans l’Église universelle et vice versa (principe de l’in quibus/ex quibus). Ici, la compénétration remplace la hiérarchie : car s’il n’y a pas d’extériorité entre la personne et la communauté, il n’y a pas de hiérarchie possible (c’est-à-dire pas de distinction entre un supérieur et un inférieur, un haut et un bas). La communauté n’absorbe pas la personne de même que la personne ne prime pas la communauté. Ce schéma de la subsidiarité emprunte totalement au modèle périchorétique (Leys, 1995) et donne une coloration très particulière au fédéralisme traditionnel.
C’est là un enseignement central de la subsidiarité. Il est courant de comparer les systèmes fédéraux en ne considérant la question que sous l’angle de l’ingénierie institutionnelle : le fédéralisme est-il coopératif, dualiste, centralisé ou plus horizontal ? On n’interroge pas assez les cultures politiques sur lesquelles s’appuient ces dispositifs (Burgess, Gagnon, 1993). D’une certaine manière, la subsidiarité est une variante du fédéralisme, mais une variante très différente du fédéralisme politico-institutionnel d’un Madison ou d’un Hamilton (Voyenne, 1981 ; Hueglin, 1999). Avec la subsidiarité, le fédéralisme est « sociétal » et culturel, il considère la vie sociale dans son intégralité en dehors même de la question de l’État (Héraud, 1976). Il fait signe vers des auteurs comme Althusius (1557-1638) et Proudhon (1809-1865), vers la théorie néo-calviniste de la souveraineté « dans sa propre sphère » d’un Abraham Kuyper (1837-1920), vers le personnalisme d’un Alexandre Marc (1904-2000) ou d’un Denis de Rougemont (1906-1985). Aussi, dans cette orientation fédérale singulière, la subsidiarité emprunte-t-elle autant au calvinisme qu’à la doctrine de l’Église catholique qui, d’ailleurs, depuis la rupture de son lien privilégié avec le pouvoir temporel, a rejoint l’idée protestante d’une secondarisation du politique. Où l’on peut aussi parler, non sans certaines précautions, d’une dimension augustinienne du principe, en tension avec le thomisme foncier dans lequel il s’est originellement défini. La subsidiarité devient, en un certain sens, le mot par lequel l’Église catholique signifie – et se signifie à elle-même – que tout pouvoir à l’œuvre dans le monde terrestre est nécessairement relatif. C’est ainsi que, du point de vue de la théorie catholique de l’Etat, l’absolutisme (français) fait place au fédéralisme (européen).
3. La question du caractère opérationnel du principe dans l’ordre juridique de l’Union européenne. A n’en pas douter, la réponse à cette question est négative. Pour deux raisons complémentaires. D’une part, on a voulu attribuer des implications pratiques et techniques à ce qui est d’abord un concept philosophique – lui-même difficile à stabiliser. La théorie juridique use alors du terme dans un sens très restrictif, celui d’une norme de régulation des compétences ; elle le transforme immanquablement en une notion instrumentale. Aussi, cette inscription juridique du principe conduit à opposer un sens philosophique et un sens juridique, dont le seul point de contact devient le fédéralisme. Or, on a vu que subsidiarité et fédéralisme ne se superposent pas, loin s’en faut. Faute de caractère réellement opérationnel, la subsidiarité n’a pas pu se frayer un chemin entre des notions déjà bien installées : la proportionnalité, la proximité, la gouvernance. D’autre part, les acteurs de la construction européenne eux-mêmes ont profité de l’absence de signification juridique du principe pour l’instrumentaliser politiquement. La volonté initiale des rédacteurs du traité de Maastricht n’était-elle pas de faire de la répartition des compétences entre Communauté et Etat une question purement technique (selon un rapport coûts/avantages entre proximité démocratique et efficacité politique) ?
Cependant, si la subsidiarité n’a pas d’opérationnalité juridique avérée, elle n’en éclaire pas moins d’un jour très suggestif le projet européen. Ce qui importe en définitive dans la subsidiarité communautaire, c’est moins son effectivité ou sa justiciabilité que sa signification symbolique et son horizon métaphorique – horizon à partir duquel peut s’exercer une critique du système existant. Philosophiquement, la subsidiarité fait référence à un modèle de société dans lequel les capacités de chaque personne et de chaque instance sont conçues comme naturelles et à l’intérieur duquel, donc, l’attribution des compétences ne fait pas débat. Rien de tel dans le fonctionnement institutionnel de l’Union, ou pas encore. Dans la conception catholique, le fondement du principe de subsidiarité est le caractère prioritaire des droits et des capacités des personnes sur les structures de pouvoir, sur les institutions organisatrices de la vie en société, donc le caractère second des institutions publiques. En passant de la subsidiarité catholique à la subsidiarité européenne, on glisse inévitablement d’une logique naturaliste vers une logique utilitariste, dans la mesure où ce qui fonde cette dernière est un argument d’efficacité et de maîtrise de l’action publique.
La subsidiarité n’est ni un principe de droit ni une catégorie d’action, mais plutôt l’expression d’une certaine conception de la politique qui affirme l’antériorité de la personne et de ses groupes d’appartenance par rapport à toutes les structures institutionnelles issues de la volonté humaine. Elle aide à isoler des questionnements fondamentaux de la science politique mais n’y répond pas définitivement en ce qu’elle autorise deux types de réponse partiellement contradictoires, qui révèlent une tension intrinsèque entre un pôle social et un pôle libéral, entre une version positive et une version négative.
Bibliographie
BOUVIER, M. 1986. L’État sans politique. Tradition et modernité, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence.
BURGESS, M., GAGNON, A. G. (éd.), 1993. Comparative Federalism and Federation : Competing Traditions and Future Directions, New York, London : Harvester Wheatsheaf.
CONSTANTINESCO, V., 1991. « Le principe de subsidiarité : un passage obligé vers l’Union européenne ? », L’Europe et le droit. Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris : Dalloz.
DEHOUSSE, R., 1992. « La subsidiarité et ses limites », Annuaire européen, Dordrecht, Boston, London : Martinus Nijhoff, 40 : 27-46.
DELPEREE, F. (dir.), 2002. Le Principe de subsidiarité, Bruxelles : Bruylant, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence.
D’ONORIO, J. B. (dir.), 1995. La Subsidiarité. De la théorie à la pratique, Paris : Téqui.
ESTELLA, A., 2002. The European Union Principle of Subsidiarity and Its Critique, Oxford : Oxford University Press.
HERAUD, G., 1976. « Un anti-étatisme : le fédéralisme intégral », Archives de philosophie du droit, 21 : 167-180.
HUEGLIN, T., 1999. Early Modern Concepts for a Late Modern World. Althusius on Community and Federalism, Waterloo : Wilfrid Laurier University Press.
ISENSEE, J., 2001. Subsidiarität und Verfassungsrecht, Berlin : Duncker/Humblot.
KERSBERGEN (VAN), K., 1995. Social Capitalism. A Study of Christian Democracy and the Welfare State, London, New York : Routledge.
LEGRAND, H., MANZANRES, J., GARCIA Y GARCIA, A. (dir.), 1988. Les Conférences épiscopales. Théologie, statut canonique, avenir, Paris : Le Cerf.
LEYS, A., 1995. Ecclesiological Impacts of the Principle of Subsidiarity, Kampen : Kok.
MILLON-DELSOL, C., 1992. L’État subsidiaire. Ingérence et non-ingérence de l’État : le principe de subsidiarité aux fondements de l’histoire européenne, Paris : Presses universitaires de France.
NELL-BREUNING (VON), O., 1990. Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität, Freiburg im Breisgau : Herder.
RIKLIN, A., BATLINER, G., Hrsg., 1994. Subsidiarität. Ein interdisziplinäres Symposium, Vaduz : Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft.
STADLER, H., 1951. Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus, Freiburg im Breisgau : Universitätsbuchhandlung.
STADLER, H., 1988. Synode extraordinaire. Célébration de Vatican II, Paris : Le Cerf.
UTZ, A., Hrsg., 1953. Das Subsidiaritätsprinzip, Heidelberg : Kerle.
UTZ, A., 1956. Formen und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips, Heidelberg : Kerle.
UTZ, A., 1970. « Subsidiarität, ein Prüfstein der Demokratie » ; « Der Mythos des Subsidiaritätsprinzips », Ethik und Politik, Stuttgart : Seewald.
VOYENNE, B., 1981. Histoire de l’idée fédéraliste, III, Les lignées proudhoniennes, Nice : Presses d’Europe.
Liens : Décentralisation - État - Fédéralisme - Société -Souveraineté
Comment citer cet article :
Barroche, Julien (2007), « Subsidiarité », in V. Bourdeau et R. Merrill (dir.), DicoPo, Dictionnaire de théorie politique.
http://www.dicopo.org/spip.php ?article61