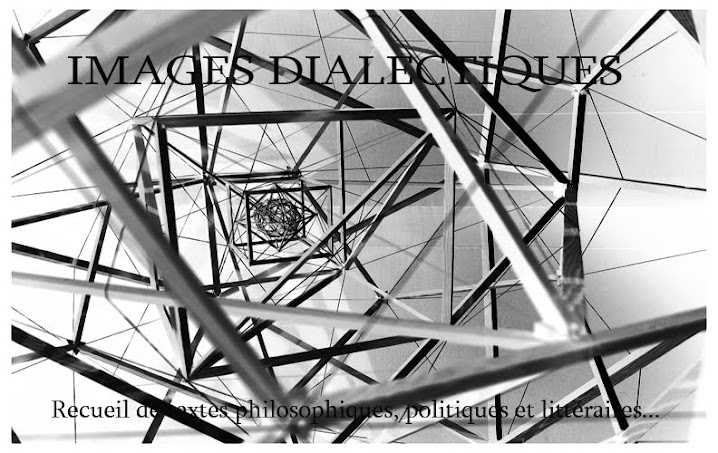Puissance américaine, faiblesse européenne, par Robert Kagan
LE MONDE | 26.07.02 | 13h07
Il faut cesser de faire comme si Américains et Européens avaient une vision commune du monde, voire comme s'ils vivaient sur la même planète. Sur la question capitale de la puissance (quelle est son efficacité ? est-elle morale ? faut-il y aspirer ?), les points de vue divergent. L'Europe est en train de se détourner de la puissance ou, plus exactement, elle se dirige vers un au-delà de la puissance, vers un monde bien distinct de l'autre, où règnent la loi, la réglementation, la négociation et la coopération entre nations : en somme, elle est en train d'accéder au paradis post-historique où tout n'est qu'apaisement et prospérité, à l'idéal kantien de "paix perpétuelle".
Les Etats-Unis, en revanche, restent embourbés dans l'histoire, déployant leur puissance dans le monde anarchique décrit par Hobbes, où l'on ne peut se fier aux lois et règles internationales, et où la véritable sécurité ainsi que la défense et la promotion d'un ordre libéral dépendent toujours de la possession de la puissance militaire et de son utilisation.
C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, sur les grandes questions stratégiques et internationales, les Américains sont des habitants de Mars et les Européens de Vénus : ils ne sont que très rarement d'accord entre eux et se comprennent de moins en moins.
En tant qu'Américain vivant en Europe, il m'est plus aisé de percevoir cette opposition. Les Européens sont plus conscients qu'auparavant de l'aggravation des différences, sans doute parce qu'ils les redoutent de plus en plus (...). Selon eux, les Etats-Unis sont plus prompts à utiliser la force et moins patients que l'Europe dans le recours à la diplomatie. Les Américains croient volontiers que le monde est divisé en bons et méchants, amis et ennemis, alors que, selon l'Europe, le tableau est bien plus complexe. Face à des adversaires réels ou potentiels, les Américains préféreraient la coercition à la persuasion, le bâton à la carotte. Dans les affaires internationales, ils penseraient en termes de résultats définitifs : les problèmes doivent être résolus, les menaces éliminées. Enfin, les Américains seraient de plus en plus enclins à agir unilatéralement, et de moins en moins favorables aux actions entreprises sous l'égide d'institutions internationales comme l'ONU, ou à la coopération avec d'autres nations pour atteindre des objectifs communs, ils seraient plus sceptiques sur les bienfaits du droit international et préféreraient agir en dehors de lui quand ils l'estiment indispensable, voire simplement avantageux.
Quant à leur propre approche des problèmes, les Européens se plaisent à dire qu'elle est plus nuancée et plus habile : eux cherchent à influencer l'autre, indirectement, subtilement. Ils supporteraient mieux l'échec, et manifesteraient une plus grande patience quand la solution tarde à venir. Leurs préférences vont avant tout aux solutions pacifiques, à la négociation plutôt qu'à la coercition. Ils en appellent plus volontiers au droit international, aux accords internationaux et à l'opinion internationale pour juger les contentieux. Ils cherchent à utiliser les liens commerciaux et économiques pour lier les nations les unes aux autres (...). En dépit de ce que pensent de nombreux Européens et certains Américains, ces différences de culture stratégique ne sont pas une émanation naturelle du tempérament national des deux côtés de l'océan. Après tout, l'attitude pacifique que les Européens mettent aujourd'hui en avant est, du point de vue historique, tout à fait nouvelle. Elle est en rupture totale avec la culture stratégique opposée qui a dominé l'Europe pendant quatre siècles, et au moins jusqu'à la première guerre mondiale. Les gouvernements européens (sans oublier les peuples) qui se sont lancés avec enthousiasme dans ce conflit embrasant tout un continent étaient des partisans déclarés de la Machtpolitik. Alors que les racines de l'actuelle vision européenne de la politique internationale (comme les racines de l'Union européenne elle-même) remontent aux Lumières, la politique des grandes puissances de l'Europe pendant trois cents ans n'a guère suivi les préceptes visionnaires des philosophes et des physiocrates.
De même, dans le cas des Etats-Unis, ni leur actuelle insistance sur le rôle de la force dans les relations internationales ni leur goût prononcé pour l'unilatéralisme ou leur répugnance à signer des accords internationaux ne sont le fruit d'une longue tradition. Les Américains sont eux aussi des enfants de la pensée des Lumières, et, dans les premiers temps de leur indépendance, ils se sont montrés d'ardents apôtres de son credo. Les dirigeants américains du XVIIIe et du XIXe siècles tenaient un langage très voisins de celui des Européens d'aujourd'hui (...). Deux siècles plus tard, Américains et Européens ont échangé leurs statuts et leurs points de vue. Cela s'explique en partie par la spectaculaire modification de la géographie du pouvoir intervenue au XXe siècle : auparavant, quand les Etats-Unis n'étaient pas une grande puissance, ils prônaient la recherche d'accommodements, ce qui est la stratégie du faible. Aujourd'hui qu'ils sont les plus forts, ils se comportent comme les grandes puissances l'ont toujours fait. Quand les grandes puissances européennes dominaient la scène, elles affichaient un culte de la force et de la gloire des armes. Aujourd'hui, l'Europe voit le monde avec les yeux du faible (...). En constituant une unique entité politique et économique (exploit historique du traité de Maastricht en 1992), nombre d'Européens espéraient bien renouer avec la grandeur passée de l'Europe, mais sous une forme politique d'un nouveau type : l'" Europe" allait devenir la seconde superpuissance, non seulement économiquement et politiquement, mais aussi militairement ; elle réglerait les crises survenant sur son continent, tels les conflits ethniques dans les Balkans, et retrouverait un rôle de premier plan sur la scène internationale. Dans les années 1990, les Européens pouvaient affirmer avec confiance que la puissance d'une Europe unie finirait par restaurer cette "multipolarité" que la fin de la guerre froide avait détruite. Et la plupart des Américains, avec des sentiments mélangés, acceptaient cette idée d'une superpuissance européenne en voie de constitution. De Harvard, Samuel P. Huntington prédisait que la création de l'Union européenne serait le maillon le plus important de la réaction mondiale à l'hégémonie américaine et ferait du XXIe siècle une époque véritablement "multipolaire".
Mais ces prétentions européennes, comme les appréhensions américaines, se sont révélées infondées. Les années 1990 ont vu non pas l'ascension de l'Europe vers un statut de superpuissance mais la mise à nu de sa relative faiblesse. Au début de la décennie, le conflit en Bosnie-Herzégovine a révélé l'incapacité militaire de l'Europe et son impuissance politique ; à la fin de la décennie, le conflit du Kosovo a mis en pleine lumière l'infériorité européenne en matière de technique militaire et de capacité à mener une guerre moderne, laquelle ne pouvait aller qu'en se creusant. (...) Dans le meilleur des cas, son rôle se limitait à fournir des troupes pour le maintien de l'ordre après que les Etats-Unis, avec leurs seules forces ou presque, avaient mené à bien les phases militaires décisives de l'opération et stabilisé la situation. Comme le disaient certains en Europe, il y avait division du travail entre les Etats-Unis, qui "faisaient le dîner", et les Européens, qui "faisaient la vaisselle".
Cette incapacité n'aurait pas dû être une surprise puisque c'était cette réduction de puissance qui avait contraint l'Europe à perdre de son influence internationale dès l'après-guerre. Ceux des Américains et des Européens qui assignaient à l'Europe la mission d'étendre son rôle stratégique au-delà de ses frontières lui fixaient un objectif déraisonnable. Au cours de la guerre froide, le rôle stratégique de l'Europe avait été de pourvoir à sa propre défense. Il était irréaliste de penser qu'elle pourrait retrouver un statut de superpuissance, à moins que les populations européennes ne soient prêtes à amputer fortement les programmes d'aide sociale au profit des programmes militaires. Or il était clair qu'elles ne le souhaitaient pas du tout. Non seulement les Européens n'étaient pas prêts à payer pour retrouver une capacité d'intervention militaire hors d'Europe, mais, après la fin de la guerre froide, ils se refusaient même à financer une force militaire suffisante pour conduire des opérations sur leur propre continent sans l'aide des Américains. (...) En moyenne, les budgets de la défense des Etats européens sont passés en dessous de 2 % du PIB. (...) De l'autre côté de l'Atlantique, la fin de la guerre froide avait eu des conséquences très différentes, même si les Américains comptaient bien, eux aussi, encaisser quelques dividendes de la paix. -Aujourd'hui- l'actuelle puissance militaire américaine et notamment sa capacité à intervenir en n'importe quel point du globe sont sans aucun précédent dans l'histoire. (...) Cette soudaine " unipolarité" a donc eu une conséquence totalement prévisible : les Etats-Unis ont montré de plus en plus d'inclination à utiliser leur force militaire à l'étranger. Puisqu'il n'y avait désormais plus d'URSS pour freiner, l'Amérique était libre d'intervenir où elle le voulait et quand elle le voulait. (...) La fin de la guerre froide, en accroissant l'écart, a exacerbé les désaccords. Contrairement à l'opinion répandue qui voudrait que les tensions entre l'Europe et l'Amérique aient commencé avec l'entrée en fonctions de George W. Bush en janvier 2001, elles étaient déjà patentes sous Clinton et remontent même à la présidence de George H. W. Bush.
Ce désaccord naturel entre les forts et les faibles, constant dans l'histoire, se retrouve aujourd'hui dans la querelle sur l'unilatéralisme entre les deux rivages de l'Atlantique. Les Européens sont convaincus que leur hostilité à l'unilatéralisme américain est la preuve de la supériorité de leur conception idéale de l'ordre mondial à créer, et ils ne sont guère prêts à admettre que ce rejet de l'unilatéralisme est aussi dicté par leur intérêt. Ce que les Européens redoutent dans l'unilatéralisme américain, c'est qu'il perpétue un monde hobbésien, où eux-mêmes risquent de devenir de plus en plus vulnérables. L'hégémonie américaine est peut-être bienveillante, mais aussi longtemps que ses actes retardent la création d'un ordre mondial garantissant davantage la sécurité des pays plus faibles, elle est objectivement dangereuse. C'est là une des raisons pour lesquelles, ces dernières années, un des principaux objectifs de la politique étrangère de l'Union a été, selon la formule d'un observateur européen, de "multilatéraliser" l'Amérique. Non que les Européens soient en passe de monter une coalition contre l'hégémonie américaine (comme Huntington et bien des théoriciens de la Realpolitik le soutiennent) en se dotant d'une puissance militaire qui puisse égaler la sienne : ils n'en font rien. Leur tactique, comme leur objectif, est celle des faibles : ils espèrent contenir la puissance de l'Amérique sans avoir à déployer des moyens égaux. Selon une tactique qui pourrait bien être l'exploit suprême de l'attaque oblique, ils cherchent à maîtriser le monstre en faisant appel à sa conscience.
usqu'ici, la tactique s'est révélée judicieuse. Car les Etats-Unis sont un monstre doté d'une conscience. Rien à voir avec la France de Louis XIV ou l'Angleterre de George III. Même entre eux, les Américains ne justifient jamais leurs actes par la raison d'Etat. Les Américains n'ont jamais accepté les principes de l'ancien ordre européen ni adopté les idées de Machiavel. Les Etats-Unis sont jusqu'au bout des ongles une société libérale et progressiste, et s'ils croient en la puissance, c'est comme moyen de faire avancer les principes d'une civilisation de liberté et d'un ordre du monde libéral. Les Américains partagent même les aspirations européennes à un système mondial plus ordonné, fondé non pas sur le jeu des puissances mais sur le règne d'un droit international, celui-là même qu'ils appelaient de leurs vœux quand l'Europe célébrait encore les lois de la Machtpolitik.
Les Européens prétendent souvent que les Américains ne sont pas raisonnables quand ils exigent une sécurité "parfaite", celle que leur a apportée pendant des siècles la barrière protectrice de deux océans. Les Européens assurent qu'ils savent, eux, vivre avec le danger et côtoyer le mal, car telle est leur histoire depuis toujours. D'où leur plus grande tolérance face aux menaces que peuvent représenter l'Irak de Saddam Hussein ou l'Iran des ayatollahs. Selon eux, les Américains exagèrent le danger que ces régimes représenteraient. Même avant le 11 septembre, l'argument sonnait assez creux. Dans les premières décennies de leur existence, les Etats-Unis ont connu l'insécurité, entourés qu'ils étaient par des puissances européennes hostiles, et constamment menacés de voir l'Union éclater sous le choc de forces centrifuges encouragées de l'extérieur : l'état d'insécurité de la nation est au cœur du discours d'adieu de George Washington. Quant à la prétendue tolérance européenne face à l'insécurité et au mal, on ne saurait la surestimer. Longtemps, l'Europe catholique et l'Europe protestante ont préféré s'entretuer que se tolérer, et les deux derniers siècles n'ont pas été marqués par une grande tolérance mutuelle entre Français et Allemands. (...) Une fois encore, on expliquera beaucoup mieux par la relative faiblesse de l'Europe sa plus grande tolérance de la menace extérieure. Et cette tolérance est une politique très réaliste, car l'Europe, en raison de sa faiblesse, est moins exposée aux menaces que la très puissante Amérique. (...) C'est cette réaction psychologique parfaitement normale qui est en train de brouiller les Etats-Unis et l'Europe. Cette dernière a conclu, assez raisonnablement, que la menace incarnée par Saddam Hussein est plus tolérable pour elle que le risque de renverser son régime par la force. En revanche, dans le cas de l'Amérique, parce qu'elle est plus forte, le seuil de tolérance face à Saddam et à son dangereux arsenal est, non moins raisonnablement, plus bas, surtout après le 11 septembre. (...) Les Américains peuvent envisager une invasion réussie de l'Irak qui renverserait Saddam Hussein, ce qui explique que 70 % d'entre eux soient apparemment favorables à une telle entreprise. On ne sera pas surpris d'apprendre que les Européens trouvent un tel projet à la fois inimaginable et effrayant.
L'incapacité à répondre aux menaces ne débouche pas seulement sur la tolérance mais parfois aussi sur la dénégation : il est normal de tenter de chasser de son esprit ce contre quoi l'on ne peut rien faire. Selon un bon observateur de l'opinion européenne, c'est sur l'idée même de menace que s'opposent souvent les gouvernements de part et d'autre de l'Atlantique : Washington, nous dit Steven Everts, parle de "menaces" étrangères telles que la prolifération d'armements nucléaires, le terrorisme et les "Etats voyous" ; mais les dirigeants Européens voient surtout des "problèmes", tels que les conflits interethniques, les mouvements migratoires, le crime organisé, la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Comme le fait remarquer Everts, la différence fondamentale tient pourtant moins à une question de culture et de philosophie que de capacité à agir. (...) Néanmoins, ces divergences dans la perception de la menace ne relèvent pas seulement de la psychologie. Elles sont également fonction d'une réalité pratique qui, elle aussi, est une conséquence de la disparité des forces : il est incontestable, objectivement, que l'Irak et les autres "Etats voyous" ne représentent pas le même niveau de menace pour l'Europe et pour l'Amérique. Pour commencer, il faut prendre en compte le fait que les Américains garantissent la sécurité de l'Europe depuis soixante ans, et qu'ils ont pris pour eux le fardeau de maintenir l'ordre dans ces régions éloignées du monde, de la Corée au golfe Persique, dont les puissances européennes se sont en grande partie retirées. Les Européens considèrent le plus souvent, qu'ils l'admettent clairement ou non, que si l'Irak devait soudain devenir une menace réelle, et non plus seulement potentielle, les Etats-Unis interviendraient, comme ils l'ont fait en 1991. (...) Quand on regarde les choses au niveau le plus pragmatique, c'est- à-dire quand il s'agit de planifier véritablement une stratégie, ni l'Irak, ni la Corée du Nord, ni aucun autre "Etat voyou" n'est avant tout un problème pour l'Europe. La tâche de contenir Saddam Hussein revient avant tout aux Etats-Unis, et non à l'Europe : tout le monde est d'accord sur ce point, y compris Saddam Hussein lui-même. (...)
Robert Kagan, ancien haut fonctionnaire du département d'Etat américain, est chercheur au Carnegie Endowment for International Peace. Cet article, dont nous publions des extraits, est paru dans le no 113 de Policy Review. Il sera publié intégralement dans le numéro de rentrée de la revue Commentaire.
Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Bardos.